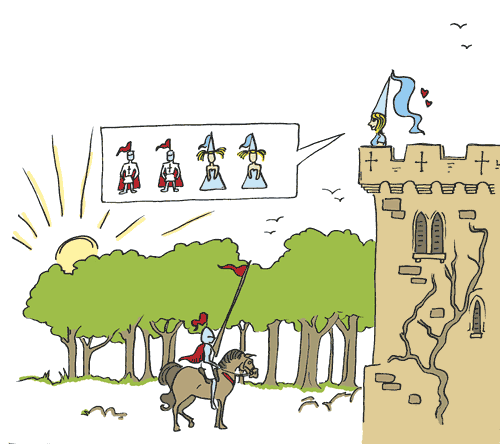Ils vécurent heureux… et n’eurent pas d’enfants
Christophe Jasmin
« Le mini baby-boom se poursuit », « Pour la cinquième année consécutive, le nombre de naissances est en hausse au Québec », « Le Québec, paradis des familles ». Voilà le genre de titres qu’on peut apercevoir dans les médias québécois depuis quelques mois. « Enfin une bonne nouvelle pour le Québec ! » s’exclament les uns. « Un succès pour la politique nataliste de la province !» exultent les autres. Bref, de quoi se réjouir vous direz-vous.
Et si cette politique nataliste, ces généreux et louangés programmes de congés parentaux, ces crédits d’impôt et toutes ces garderies à sept dollars par jour n’étaient que des moyens de propagande, voire d’oppression ? Si, en récompensant de manière si généreuse la maternité et en la promouvant de tous bords, de tous côtés comme il le fait, l’État québécois entravait le succès des femmes qui ont des enfants, tout en stigmatisant celles qui n’en ont pas.
Évidemment, l’idée peut sembler quelque peu extrémiste, à la limite de la théorie féministe du complot. De plus, on peut avoir une vague impression de déjà vu : une élite à la tête de la société québécoise qui fait pression sur les familles pour qu’elles enfantent et qui dénonce fortement celles qui « empêchent la famille ». Ça fait un peu Back to the Future qui rencontre la Grande Noirceur tout ça, non ? Et ben, pas tant que ça. Pour preuve, une étude de Statistique Canada, intitulée « Choisir de ne pas avoir d’enfants », concluait en 2003 que « notre société “enfantcentrique” [a] tendance à faire en sorte que les couples sans enfants se sentent inadéquats, tenus à l’écart, jugés ou mal compris ». Alors, ne pas vouloir d’enfants, nouveau tabou ? La nullipare (femme non-mère), nouvelle paria ?
Dans No Kid : 40 raisons de ne pas avoir d’enfant, la Française Corinne Maier dénonce la « bébé-mania » et tout le discours très optimiste qui entoure la paternité et la maternité. C’est elle qui accuse l’État (français, en l’occurrence) d’entraver le succès des femmes en les maintenant en marge du marché du travail et en les enfermant dans une « prison de domesticité ». Mais elle ne s’arrête pas là : son livre se veut carrément un argumentaire visant à décourager les gens de faire des enfants. En quarante chapitres, qui invoquent autant de raisons, l’auteure explique au lecteur pourquoi il ou elle regrettera inévitablement d’avoir des enfants. « Évitez de devenir un biberon ambulant », « gardez vos amis », « un enfant c’est trop cher » écrit notamment la polémiste, elle-même mère de deux enfants. Comme beaucoup d’autres parents, elle avoue avoir fait des enfants avec l’espoir qu’ils mettent fin à ses moments de solitude. Seulement pour réaliser, plus tard, que la maternité en créait de nouvelles formes.
Dans L’envers du landau, paru récemment aux éditions Tryptique, la professeure de littérature à l’Université d’Ottawa Lucie Joubert aborde elle aussi cette question épineuse, mais sur un ton tout de même moins polémique. L’auteure, qui ne cherche pas à dénigrer la maternité, veut avant tout attirer l’attention sur la pression que subissent les femmes qui, comme elle, ne veulent pas avoir d’enfants. Cette pression provient le plus souvent non pas de la famille ou de l’entourage immédiat, affirme Joubert, mais plutôt d’un discours ambiant dont le message est clair : la réalisation de soi, pour une femme, passe par les enfants. Celles qui résistent et refusent de rentrer dans le rang deviennent en quelque sorte des rebelles d’une société obsédée par le discours nataliste. « Mais ça ne veut pas dire qu’on n’aime pas la famille ou les enfants : on n’est pas des “childhaters” ou des “misopédistes”» d’expliquer l’auteure.
Féministe, elle se dit inquiète de voir que ce qui était considéré comme acquis, c’est-à-dire le choix d’avoir des enfants ou non, est remis en question par toutes ces pressions sociales. C’est en partie pour tenter de sécuriser ce choix pour les générations à venir qu’elle a écrit ce livre. Mais c’est aussi, indirectement, pour toutes ces femmes qui, n’ayant pu donner la vie, souffrent de ne jamais pouvoir atteindre ce qui est projeté comme étant l’aboutissement de la féminité.
Reste que pour la plupart des gens, avoir un enfant sera toujours vu non seulement comme le plus beau cadeau mais aussi le plus véritable don de soi qu’un être humain puisse faire. Ce qui relègue ces femmes, et dans une moindre mesure ces hommes, à un statut public d’individualiste, voire d’égocentrique. C’est pourquoi, à la sortie de son livre, on a souvent accusé Corinne Maier de « faire l’éloge de l’égoïsme ». Ce à quoi elle rétorque que son livre est plutôt « l’éloge de la réalisation de son désir individuel, au risque de déplaire à la société ».
Mais on peut pousser la réflexion un peu plus loin et se demander si, au contraire, ce ne sont pas les gens qui décident d’avoir des enfants qui sont le plus égocentriques. Idée grotesque ? Ça reste à voir. « Quand on fait des enfants, on ne les fait pas pour la société, ni à la rigueur pour l’enfant lui-même. On les fait pour soi », affirme Irène Krymko-Bleton, psychanalyste et professeur à l’UQAM.
Pour le bien de mon enfant la planète
Marie-Odile Samson
« Si, à 30 ans, avoir deux enfants peut sembler beaucoup, à 60 ans, tout compte fait, c’est peu. écrit Marlène Hyppia, journaliste chez ELLE Québec. Il faudrait plutôt viser cinq ou six héritiers si on veut s’assurer à long terme son lot de bâtons de vieillesse, de visites et, qui sait, de petits-enfants à chouchouter ».
Dans l’article « 20 bonnes raisons d’avoir des enfants », celle-ci détient la troisième place. Cependant, si l’on élargit à l’échelle mondiale l’idée d’avoir des enfants, on se doit de considérer le taux de remplacement de l’espèce humaine. Celuici, soit le nombre d’enfants qu’une femme doit avoir pour remplacer soi-même et son conjoint, se situe à 2,1 enfants. Mais avant d’envisager engendrer six héritiers, y a‑til des contraintes sociales et écologiques qu’un couple devrait considérer ?
Faire des enfants demeure un choix personnel. C’est le premier sentiment qu’a exprimé Madhav Badami, professeur à l’École d’environnement de McGill, lorsque Le Délit s’est entretenu avec lui. « Je ne suis pas en position de dire à quelqu’un le nombre d’enfants qu’il devrait avoir. C’est un choix personnel. » Personne ne peut juger la nature de cette décision. La quantité d’enfants désirée, quoique personnelle, devrait cependant être un choix posé rationnellement qui prenne en compte, non seulement ses désirs personnels, mais surtout l’effet sur les ressources planétaires. Avoir une famille de cinq ou six enfants, cela peut sembler satisfaisant en soi, mais si chaque couple se disait la même chose, il faudrait rapidement trouver des solutions aux problèmes de nutrition, de pauvreté et de manque de territoires habitables qui surviendraient. Sans diminuer le bonheur que peut rapporter chaque enfant, il faut tout de même s’assurer de leur léguer une planète potable et durable.
Il y a une grande distinction entre pays industrialisé et pays en voie de développement lorsqu’il s’agit de choisir de faire un enfant ou non. En effet, il y a des coûts économiques et sociaux associés à la procréation, mais ces dépenses existent aussi lorsqu’on choisit de ne pas faire d’enfants. M. Badami nous explique : « les conséquences sociales qui découleraient d’une population en décroissance pourraient être aussi importantes que le coût environnemental associé à la surpopulation mondiale ». Les deux revers de la médaille sont importants à considérer, selon si le pays dans lequel nous vivons fait face à un problème de surpopulation ou à une population vieillissante.
Dans certains pays en voie de développement, un nombre élevé d’enfants permet aux familles, non seulement d’assurer le taux de remplacement, puisque le taux de mortalité infantile y est plus élevé, mais aussi de fournir plus de bras au travail de la terre, qui est fondamental à la survie et au mode de vie. L’importance d’avoir des enfants ne relève donc pas seulement d’un désir personnel, mais bien d’une nécessité sociale causée par un problème profondément ancré dans ces sociétés. Ceci a, par conséquent, une grande influence sur le problème de surpopulation, mais aussi sur la qualité de vie économique de ces individus. Le territoire du Kenya fait partie des sols les plus travaillés dans le monde, et sa population parmi les plus denses de la planète. Les deux sont intrinsèquement liés, car le besoin de travailler la terre marginale est nécessaire à la survie de la communauté du Kenya.
Par contre, dans certains pays développés tels le Japon ou l’Allemagne, la population vieillit rapidement. Dans ces pays, on peut remarquer l’ampleur du problème que cause la dénatalité. Comme l’explique Milton Ezrati, dans l’article « Japan’s Aging Economics » du journal Foreign Affairs, les grandes entreprises vont y penser à deux fois avant de s’installer dans un pays qui ne peut fournir et renouveler une main d’oeuvre jeune et dynamique. L’immigration pourrait évidemment être une solution à ce problème, mais elle pourrait tout de même entraîner de sérieuses conséquences. M. Badami confirme : « si l’on prend l’exemple du Japon, il faudrait importer des travailleurs. Mais il faudra ensuite travailler avec les conséquences du mélange des cultures ». L’immigration, combinée à une augmentation du taux de natalité, permettrait à ces pays dont la population est en déclin de retrouver leur élan.
Le Québec fait face à une situation semblable. Ayant une population en vieillissement rapide, le Portail du Gouvernement du Québec prévoit qu’en 2031, notre population se classera parmi les plus vieilles des sociétés industrialisées. Mais, comment donc bâtir une famille aujourd’hui en prenant en compte toutes ces circonstances ?
L’adoption pourrait être une solution logique. Un pays sous-peuplé, adoptant des enfants d’un pays surpeuplé qui n’attendent que l’amour d’une famille, cela pourrait être un remède incroyable aux problèmes sociaux qui s’étendent d’un pays à l’autre. M. Badami nous propose une vision qui offre encore plus de solutions : « si des gens d’un pays surpeuplé adoptaient les enfants de leur propre pays en leur donnant une bonne maison, cela pourrait résoudre deux des problèmes principaux dans le monde, soit la pauvreté et la croissance rapide de la population ». Quelques hics : l’adoption demeure non seulement un procédé long, coûteux et incertain, mais elle est rarement le premier choix de futurs parents.
D’un autre côté, M. Badami nous amène à considérer le point de vue de l’enfant. En grandissant, il est toujours (ou presque toujours!) plaisant d’avoir un frère ou une soeur avec qui partager ses jeux, ses histoires et sa vie. Cela pourrait être une autre motivation qui pousserait une famille à atteindre le taux de remplacement. Toutes les raisons sont bonnes pour vouloir et avoir des enfants, et il est nécessaire de continuer à se reproduire pour assurer la survie de la population. Au-delà de l’aspect romantique d’une vie familiale, assurer la descendance de la race humaine, voilà tout de même le but ultime de « faire des bébés ». Finalement, doit-on se sentir responsable de respecter les limites de notre planète ? Si un adulte prend la décision de devenir responsable d’un enfant, il devrait donc également se sentir responsable de lui assurer un avenir vivable. Pour un futur parent, ce qui est donc important de garder en tête, c’est qu’il y a des limites sociales et physiques à respecter pour que la Terre conserve son équilibre et puisse assurer la survie de chaque individu naissant.