Depuis sa création, Internet a toujours été un espace de liberté et de création à part, qui a profondément modifié notre rapport à la propriété ‑comme en témoignent les téléchargements toujours plus nombreux- mais aussi à la liberté d’expression et à la création (les événements « hackathons » ‑contraction des mots « hack » et « marathon»- en sont un parfait exemple).
Vol ou promotion ?
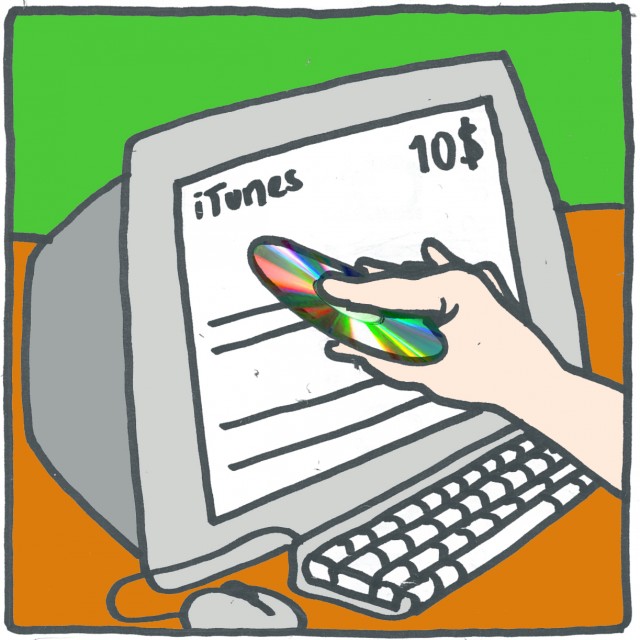
Le téléchargement illégal est évidemment une préoccupation pour les gouvernements et les acteurs culturels (que ce soient les artistes, les maisons de production, ou encore les distributeurs) qui connaissent des difficultés financières croissantes. Ainsi le film Le Hobbit : un voyage inattendu a été téléchargé 8 400 000 fois sur via le logiciel de partage Peer 2 Peer (P2P) Bit Torrent (P2P, technologie permettant l’échange direct de données entre ordinateurs reliés à Internet, sans passer par un serveur central, selon la définition du dictionnaire Larousse). En comparaison, sur les 16 semaines suivant la sortie du DVD/Blue-Ray le nombre de ventes de ce film aux États-Unis était de 4 509 474, selon le site internet The Numbers.com.
Outre le cinéma, le piratage porte également un sérieux coup à l’industrie du disque : d’après le think tank Institute for Policy Innovation (IPI) les ventes de musique ont diminué de 53% aux États-Unis entre 1999 (arrivée de Napster, le premier site de P2P sur internet) et 2011. Parmi les 64 personnes interrogées par Le Délit, 48% reconnaissent télécharger illégalement des séries, musiques ou films une fois par semaine ou plus.
Le piratage a donc un impact direct dans l’économie, puisque selon l’IPI le montant de la perte engendrée par le téléchargement illégal dans la seule industrie musicale serait de 12,5 milliards de dollars au sein de l’économie américaine. De plus, cela supprimerait directement 70 000 emplois.
Cependant, si l’impact économique du piratage semble effectivement désastreux, hormis pour les fondateurs de sites de téléchargement comme Megaupload ou The Pirate Bay, il n’est pas lié au simple téléchargement illégal. En effet selon Julien Cadot, rédacteur en chef de la rubrique « Science, Technologies et Futur » au média numérique indépendant français Ragemag, le problème est aussi lié au fait que les compagnies de production n’ont pas su s’adapter à l’explosion d’internet, ont tenté d’appliquer leur modèle économique coûte que coûte, alors que « face à une situation nouvelle, il s’agit plutôt d’inventer de nouveaux modèles économiques pour soutenir la création et les médiateurs ». De plus, il ne faut pas oublier que les emplois supprimés dans l’industrie culturelle sont aussi le résultat de l’essor de plateformes légales comme YouTube, Spotify ou encore Deezer.
Mais que penser alors des artistes qui proposent leurs morceaux en téléchargement gratuit, ou même leur album ? En d’autres mots, qui créent un nouveau modèle économique pour la distribution de leur produit, s’adaptant au public plutôt que d’essayer de lui forcer la main.
Mais l’impact culturel est-il réellement négatif ? En effet, on peut penser que le piratage laisse uniquement sa chance aux grosses productions qui ont les moyens de couvrir les pertes liées au vol. Mais que penser alors des artistes qui proposent leurs morceaux en téléchargement gratuit, ou même leur album ? En d’autres mots, qui créent un nouveau modèle économique pour la distribution de leur produit, s’adaptant au public plutôt que d’essayer de lui forcer la main. On se souvient que le groupe britannique Radiohead avait proposé à prix libre le disque In rainbows en 2007. Les internautes pouvaient alors choisir le prix d’achat de l’album, que ce soit 0 ou 100 dollars. Dans ce cas le groupe avait proposé une alternative efficace au piratage, en proposant de manière attractive mais légale sa musique.
D’autres artistes ont eu des attitudes plus subversives, en allant jusqu’à encourager le piratage : en 2008, le groupe Nine Inch Nails s’est séparé de son label et a proposé son album Ghosts I‑IV gratuitement sur son propre site internet, encourageant les internautes à le distribuer sur des réseaux de P2P. En parallèle le groupe a proposé des coffrets « Deluxe » à 300 dollars, des DVDs et vinyles, et a finalement réalisé plus de 1,6 millions de dollars de profits. Ainsi, le piratage a assuré une large promotion pour ces artistes, tout en contribuant à propulser les ventes de supports musicaux « enrichis » (plus attrayant qu’un fichier MP3 ou un simple CD).
Cependant, d’autres artistes refusent de se verser dans la séduction et adoptent une posture très dure à l’égard du téléchargement. C’est par exemple le cas de Bono, du groupe U2, qui dénonçait le piratage dans une tribune du New York Times le 2 janvier 2010 : « Une décennie de partage et de vol de fichiers musicaux a montré à l’évidence que ceux qui en souffrent sont les artistes […], précisément les jeunes auteurs compositeurs de chansons qui ne peuvent pas vivre de la vente de places de concerts et des ventes de tee-shirts ». Les gouvernements vont évidemment dans le sens de Bono, puisqu’au Canada, le piratage en ligne est un délit puni par la Loi sur le Droit d’auteur et le Code criminel. Les pirates peuvent être punis par cinq ans d’emprisonnement et 20 000 dollars de dommages et intérêts (par œuvre contrefaite) au maximum. Cela va à l’encontre de l’avis de 40% des personnes interrogées par Le Délit, qui estiment que tout ce qui est mis sur internet appartient au public.
Réinventer la transparence

Comme l’ont montré WikiLeaks ou Edward Snowden (à l’origine du scandale Prism, sur la National Security Agency, NSA), les gouvernements n’interviennent pas sur Internet uniquement pour contrôler le piratage. Ils cherchent aussi à contrôler les données privées, et éventuellement à censurer les citoyens (en Chine par exemple). Dans les domaines de la liberté d’expression et de la transparence absolue, Internet a ses détracteurs, mais aussi ses héros, motivés par un idéal de démocratie absolue. Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, ou Aaron Swartz, un programmeur de génie et l’un des premiers « hacktiviste » sont les chefs de file de ce mouvement citoyen. En entretien avec Le Délit, Jessika-Kina Ouimet, ancienne co-directrice d’Open Media McGill, nous explique que le libre accès à l’information pour lequel se sont battues toutes ces personnes (jusqu’à en mourir, dans le cas Aaron Swartz, qui avait rendu public des travaux universitaires en s’introduisant dans la base de données de la plateforme académique JSTOR) est la condition nécessaire pour une réelle « égalité des voix ». Open Media, dont une antenne existe à McGill, est une organisation qui vise à « promouvoir l’intérêt des étudiants dans les médias, les politiques des technologies de l’information et des communications au Canada ». L’ancienne co-directrice précise que le site cherche à révéler et à contrebalancer l’asymétrie qui existe entre le niveau d’information des citoyens et les décisions réelles des dirigeants politiques. Par exemple, on peut trouver sur leur site un article utilisant les documents de WikiLeaks concernant les négociations sur le Partenariat Trans-Pacifique, qui implique douze pays et va révolutionner le commerce mondial. Celles-ci avaient été tenues secrètes jusqu’à ce que WikiLeaks publie le texte de cet accord le 13 novembre dernier (voir l’article « Internet, un espace menacé » dans Le Délit, vol 103 num. 10), estimant que cette décision ne devait pas rester dans l’ombre. À ce propos, Julian Assange a déclaré le 13 novembre, sur le site de WikiLeaks : « Si vous lisez, écrivez, publiez, pensez, écoutez, dansez, chantez ou inventez ; si vous produisez ou consommez de la nourriture ; si vous êtes malades maintenant ou le serez un jour, le Partenariat Trans-Pacifique vous a en ligne de mire ». Ainsi WikiLeaks a un engagement large, militant, contre toute forme d’omnipotence gouvernementale et en faveur du droit à la vie privée pour les internautes. 70% des personnes interrogées par Le Délit, considèrent, comme WikiLeaks, qu’Internet ne devrait pas être régulé par les gouvernements.
« C’est un acte [la révélation de secrets d’état] ambigu et très fort symboliquement : c’est le moment où le citoyen accepte de trahir (au sens militaire strict) son état parce qu’il estime que cet état ne sert pas les intérêts des autres citoyens, comme cela doit être le cas en république ».
Cependant, ce militantisme peut sembler manichéen pour certains : on pourrait penser qu’il y a un certain déséquilibre entre le droit à la vie privée pour les citoyens opposés à la transparence absolue pour les gouvernements. Jessika-Kina Ouimet nous explique qu’il est logique qu’il n’y ait pas de secret d’état, car le gouvernement agit au nom des citoyens, et leur appartient donc : il ne doit sa légitimité qu’aux individus qu’il représente, et brise le contrat social en occultant une partie de ses décisions.
Julien Cadot du média Ragemag explique au Délit qu’il « pense surtout que dans notre monde très opaque, ces lanceurs d’alerte [Assange, Snowden…] rétablissent ponctuellement un équilibre, ou un semblant d’équilibre. Ce qu’il manque peut-être, c’est un équivalent de WikiLeaks ou de Snowden appliqué à l’économie et à la finance. Je pense qu’en creux, ces révélations qui concernent les pouvoirs politiques nous permettent d’entrevoir à quel point des boîtes noires se forment dans les instances dirigeantes actuelles – et à quel point l’opacité devient la règle, alors qu’elle devrait être l’exception ». Il voit derrière ces actes une réelle réflexion positive, constructive. Ce ne sont pas selon lui le produit d’impulsions irraisonnées : « c’est un acte [la révélation de secrets d’état] ambigu et très fort symboliquement : c’est le moment où le citoyen accepte de trahir (au sens militaire strict) son état parce qu’il estime que cet état ne sert pas les intérêts des autres citoyens, comme cela doit être le cas en république ».
Cependant, bien qu’il soit partisan de la transparence, préalable nécessaire à l’accomplissement réel de la démocratie, de la gouvernance citoyenne, il estime logique que les États conservent certains secrets, à l’inverse d’Open Media : « On considère qu’un état est garant de la sécurité de ses citoyens et, dans l’exercice de cette protection, peut posséder des éléments confidentiels qui nuiraient au pays et à ses citoyens, civils ou militaires, s’ils étaient découverts ». Mais il ajoute : « là où l’on franchit une limite, et c’est comme cela que l’entendent beaucoup de lanceurs d’alerte, c’est au moment où l’État cache soit des informations qui mettent en danger la sécurité ou la vie privée de leurs citoyens ou des citoyens d’autres pays, soit des informations qui mettraient à mal sa propre légitimité ».
Les nouveaux créateurs

Hors de toute considération politique, Internet est aussi un espace de création exceptionnel. De nombreuses jeunes entreprises (« startups ») se sont développées autour et grâce au web. Dans les milieux étudiants, outre ces entreprises, plus « institutionnalisées », les étudiants peuvent se muer en « hackers », afin de participer à des « hackatons » dans le but de créer des logiciels, des applications, ou toute sorte de produits nécessitant des lignes de codes. Ces « hackathons » sont très populaires dans les universités nord-américaines, puisque les plus gros, comme celui organisé par l’Université de Pennsylvanie, réunissent parfois plus de 1000 hackers. Mohamed Adam Chaieb, membre exécutif de Hack McGill, le club de hackers de McGill créé en août 2013, précise que le terme hackers doit être dissocié de l’image dissidente et destructrice qu’il véhicule. Dans le cas de Hack McGill le terme désigne plus une « sous-culture », de gens qui souhaitent mettre leurs idées en pratique rapidement, grâce à leur compétences en informatique. Bien loin donc des « Anonymous » ou de la « Syrian Electronic Army ».
Le terme « hackers » doit être dissocié de l’image dissidente et destructrice qu’il véhicule. Dans le cas de Hack McGill le terme désigne plus une « sous-culture », de gens qui souhaitent mettre leurs idées en pratique rapidement, grâce à leur compétences en informatique.
Lors des « hackathons », les hackers concrétisent leurs idées, ou celles d’entreprises ou personnes venues les aider. Ainsi, quelqu’un qui souhaiterait créer un logiciel de Design spécifique peut s’associer à des hackers lors d’un « hackathon » afin de produire un « hack ». Un « hack » est un produit non fini, un premier jet, car les « hackathons » sont des compétitions dans lesquelles les participants disposent d’un temps limités (entre 12 et 48 heures). À la fin de celui-ci, les équipes ayant réalisé les meilleurs « hacks » reçoivent des prix, pouvant se chiffrer en milliers de dollars. Par exemple lors de « McHacks (le « hackathon » organisé par McGill les 22 et 23 février prochains), il y aura 30 000 dollars de prix en jeu. Mais les intérêts économiques dépassent les simples récompenses : les entreprises sponsorisent ces évènements (et en organisent parfois, comme c’est le cas de LinkedIn) car cela leur permet de dénicher des talents, de bénéficier des idées qui germent lors de ces journées, mais aussi d’avoir des retours sur leurs produits : Mohamed Adam Chaieb explique, par exemple, Microsoft pourrait avoir envie de sponsoriser un « hackathon » non seulement pour que des gens développent des applications pour le téléphone de Windows (le Windows phone) mais aussi pour voir les possibilités qu’offre son interface, ainsi que ses limites.
Si les « hacks » ne sont pas des produits finis, il arrive cependant que l’idée soit ensuite développée pour aboutir à une application ou un logiciel utilisable par le grand public. Ainsi deux développeurs du Massachusetts Institute of Technology avaient créé lors d’un « hackathon » une application permettant de placer deux téléphones intelligents côte-à-côte, puis de faire passer des photos de l’un à l’autre d’un simple mouvement du doigt sur l’écran vers l’autre téléphone. Cette idée a ensuite été développée, complétée (et forcément complexifiée, car de nouveaux paramètres rentraient en jeu), puis a été mise sur l’Apple Store (il s’agit de Mover).
Les « hackathons » sont basés sur un principe de solidarité très fort : ils sont gratuits, ouverts à tous, même à ceux n’ayant pas une forte expérience dans le domaine du « hacking », la nourriture est fournie. « Tout le monde est le bienvenu », nous explique Mohamed. De plus les « hackers » disposent d’un réseau social, Github, sur lequel ils partagent leurs programmes, se rencontrent et forment des équipes. C’est donc la solidarité au service de la création. Cette dernière peut être orientée, vers la musique (le Hack Music Day), ou les jeux vidéos par exemple, ou bien encore vers un support en particulier. C’est aussi cette spécialisation qui peut attirer des sponsors.
Ces rendez-vous sont donc forts d’un potentiel immense et placés sous le sceau de la créativité.
Ainsi, Internet est un espace en perpétuel mouvement, au sein duquel s’entrechoquent les idéologies, et qui redessine notre rapport à l’autre, à l’autorité, à la créativité et à la propriété. Pour le meilleur et pour le pire.


