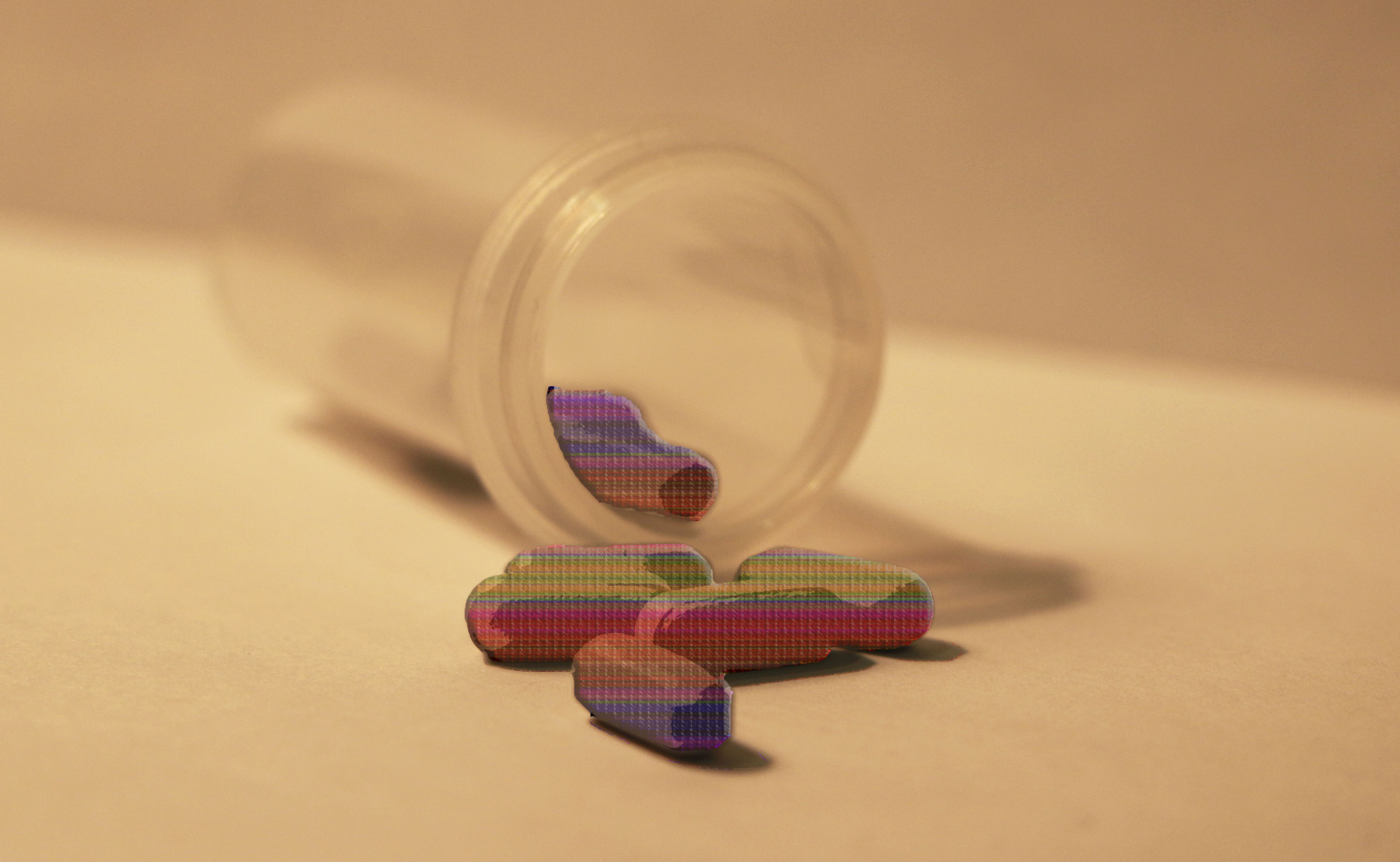Malgré la constance et l’ubiquité de la recherche médicale, certaines découvertes en particulier marquent des sociétés entières. Parmi ces dernières, on peut compter le vaccin par Pasteur en 1885, l’invention de l’aspirine par Hoffman à la fin du XIXe siècle, ou encore la pénicilline par Fleming durant le siècle suivant. En 1957, le psychiatre suisse Roland Kuhn découvrait le premier antidépresseur, l’imipramine. Ce n’est cependant qu’à partir de la fin années 80, avec l’apparition de la fluoxétine, que cette nouvelle classe de médicaments commença à impacter la société de manière remarquable. Cette pilule blanche et verte, mieux connue sous le nom de « Prozac », fut accueillie avec un enthousiasme sans précédent : pourrait-elle être la clef pour guérir la dépression ? C’est le parti pris par la journaliste américaine Elizabeth Wurtzel dans son autobiographie intitulée Prozac Nation, sortie en 1994. L’histoire de sa lutte contre la dépression et de sa victoire permise par la fluoxétine devint rapidement un best-seller aux États-Unis et sera même adaptée pour le grand écran en 2001.
Le Canada est le troisième plus grand consommateur d’antidépresseurs de tous les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), selon le rapport Panorama de la santé 2013. D’après ce même rapport, au sein des pays membres plus d’un adulte sur dix consomme des antidépresseurs. La consommation de ces médicaments a aussi fortement augmenté au cours des dernières années : elle a en moyenne presque doublé entre 2000 et 2011.
Pourtant, l’enthousiasme quasi-unanime s’est effacé depuis les années 1990, et le recul a laissé place à de nombreux doutes et controverses. Quels sont donc les facteurs à l’origine de cette augmentation ? La consommation d’antidépresseurs est-elle toujours justifiée ?
Davantage de diagnostiques ?
Les troubles de la santé mentale ont un long précédent de stigmatisation. Aujourd’hui encore, 60% des gens souffrant de troubles mentaux n’ont recours à aucun service, selon la Commission de la Santé Mentale du Canada (CSMC). Il est cependant impossible d’ignorer le progrès effectué au cours des dernières décennies. Depuis 2009, par exemple, la CSMC œuvre avec les professionnels de la santé, les jeunes, la main‑d’œuvre et les médias pour éradiquer les préjugés liés à la maladie mentale, à travers l’initiative Changer les mentalités. Une acceptation grandissante de ces troubles, en plus de l’évolution des outils d’évaluation et de diagnostiques à la disposition des professionnels, pourrait expliquer les tendances à la hausse observées dans l’utilisation d’antidépresseurs. En effet, si plus de gens sont éduqués sur la santé mentale et les ressources qui sont à leur disposition, et si les professionnels peuvent mieux les évaluer, il s’ensuit que plus de gens reçoivent un traitement.
Pourtant, selon Marc Laporta, directeur du Centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale et professeur adjoint à McGill, en entrevue avec Le Délit, « la hausse de diagnostiques est certainement une partie de la réponse, mais pas son intégralité.» Il explique que ces médicaments sont prescrits pour gérer des problèmes « tels que l’anxiété, qui incluent les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies sociales et le stress post-traumatique », mais qu’« ils sont aussi malheureusement souvent prescrits dans des situations qui ne justifient pas leur utilisation, comme les formes légères de dépression, les réactions temporaires au stress, l’insomnie et autres ».
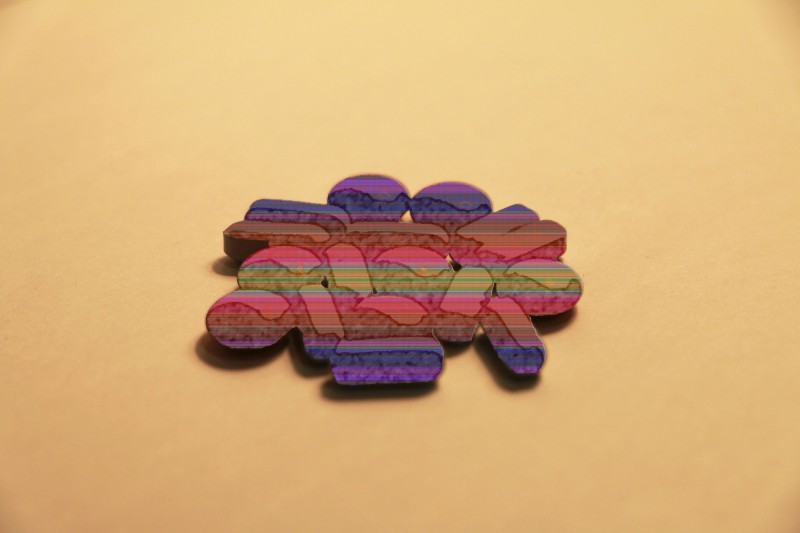
Une solution rapide et lucrative
Si les antidépresseurs sont souvent prescrits pour des problèmes autres que la dépression, c’est en partie parce que les problèmes mentaux sont extrêmement complexes et variés. Il existe des troubles trop spécifiques pour mériter autant d’attention des chercheurs que la dépression. Dans ce type de cas, les antidépresseurs sont prescrits par manque d’alternative plus adaptée. La littérature scientifique montre pourtant un succès très mitigé de cette classe de médicaments sur les troubles autres que la dépression.
Le recours fréquent à la pharmacologie s’explique aussi par son côté pratique. Pour le patient, c’est un traitement concret qui a le potentiel pour agir vite, et qui ne demande ni autant de temps ni autant de travail que la thérapie. Pour le médecin, c’est aussi une économie de temps, une façon de satisfaire un patient qui attend une solution, et la prescription représente de plus parfois un intérêt financier.
Une grande partie de la controverse qui a entouré l’utilisation d’antidépresseurs ces dernières années est liée à une méfiance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. De toute évidence, cette industrie gagne à encourager l’approche pharmacologique plutôt que la thérapie. « La santé est une industrie et les groupes d’intérêts ont beaucoup de moyens d’influencer plus ou moins subtilement la recherche, les diagnostiques et les tendances de traitements. On a besoin d’une vigilance constante de la part des organismes subventionnaires, et je pense qu’on le fait mieux qu’avant », commente Marc Laporta. Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (plus connu sous le sigle DSM), ouvrage aux dimensions quasi-bibliques pour les psychologues en Amérique du Nord, l’industrie pharmaceutique a une forte influence qui va jusqu’à l’origine du diagnostique. Une étude réalisée en 2006 par Lisa Cosgrove de l’Université du Massachusetts révélait que sur 170 membres du comité responsable de l’édition du DSM-IV, 95 étaient associés financièrement avec des compagnies pharmaceutiques. Dans le comité des troubles de l’humeur, catégorie qui inclut les troubles dépressifs et bipolaires, premiers concernés par les antidépresseurs, tous les membres ont admis avoir des liens avec cette industrie.
Critique, mais pas cynique
Si les années 1990 ont été le point culminant de l’enthousiasme vis-à-vis de la fluoxétine et de ses cousins, ces dernières années ont vu naître un certain cynisme à l’égard de médicaments qui ne sont finalement pas la solution miracle tant attendue, qui ne sont pas toujours prescrits adéquatement, et qui semblent servir à alourdir les poches de l’industrie pharmaceutique. Il est aujourd’hui important d’être informé des risques et limites de ces médicaments et de connaître les possibles motivations de ceux qui les prescrivent. Il faut aussi être conscient de leur efficacité, prouvée bien supérieure à celle de simples placébos dans la littérature scientifique, en particulier pour les cas sévères. « Nous sommes tellement loin de pouvoir aider ceux qui en ont besoin que nous sommes heureux de voir une tendance vers plus de diagnostiques et de traitements », conclut Marc Laporta. Reste à explorer les possibilités de la psychothérapie, qui est souvent moins accessible ; les meilleurs résultats observés sont obtenus en combinant cette méthode avec la pharmacothérapie.