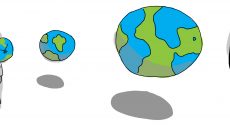Les Anarchives exposent les reliques d’une décennie turbulente.
Elle donne le vertige, cette impression de déjà vu pendant la grève étudiante de 2012, qui rappelle étrangement aux Québecois sexagénaires les mobilisations de 1970. La crise d’octobre 1970, ça vous dit quelque chose ? Ça devrait.
Le collectif des Anarchives fait revivre les années turbulentes du Québec en exposant leurs archives. Dans le cadre du colloque international « Contre-culture : existences et persistances » organisé par Simon Harel (UdeM) et Simon-Pier Labelle (McGill), la médiathèque Gaëtan Dostie accueillait vendredi 16 octobre le collectif, pour présenter les reliques d’une décennie mouvementée.
L’exposition Criez, créez ou crevez : contre-culture au Québec de 1955 à 1975 est installée dans une salle au deuxième étage de la petite médiathèque, dont les murs sont envahis de vieilles revues anarchistes, marxistes, féministes, ou encore de manifestes maoïstes. Pour mettre un peu d’ordre dans cette amas de papiers révolutionnaires, les trois jeunes représentants du collectif Anarchives ont présenté leur démarche lors de la conférence « Réflexion sur la contre-culture et les devenirs révolutionnaires », précédant le vernissage de l’exposition.
« C’est plus un bordel qu’une bibliothèque » me glisse l’un des trois « anarchivistes » avec un sourire en coin, alors que je tourne les pages de la vieille revue Mainmise. Avant la conférence, on s’attarde dans la salle d’exposition, saturée de journaux qui décrivent un désir de révolution anti-coloniale, anti-capitaliste, anti-patriarcale. En effet, on aperçoit des revues qui parles de drogues, puis de féminisme et de mouvements gais, et puis plus loin un article sur Mao et des revues sur des concerts de rock. Une affiche appelle « Québécoises debouttes ! », une autre demande « la drogue, problème ou solution ? », et d’autres encore annoncent le « méga-concert de Pink Floyd au Stade Olympique de Montréal ».
Finalement, pour être vraiment certain d’avoir cerné le sujet, un article annonce « la contre-culture s’organise ! »
La présentation commence par l’introduction de Gaëtan Dostie, qui explique pourquoi il organise un événement tous les 16 octobre, depuis 1971. C’est dans la nuit du 16 octobre 1970, à quatre heure du matin, que la police est venue le sortir de son lit pour l’emprisonner. Il s’est retrouvé dans une cellule côte à côte avec d’autre révolutionnaires, notamment Pierre Vallières, qui lui glissa le crayon avec lequel Gaétan écrivit le poème « peur d’élire » qu’il nous lit alors ce vendredi. Applaudit par la dizaine de conférenciers, Gaëtan se retire, ému.
Les fouilleurs d’archives se sont attaqués au monceau de revues de Gaëtan Dostie pour rendre le passé vivant, avec une présentation intéractive de la presse des années 1955 à 1975, expliquent-ils pendant la conférence. Les trois jeunes intellectuels expriment leur « aversion pour les morgues à passé » : ici, « on peut toucher, sans cacher l’usure du monde ».
Ainsi, exposer les journaux d’une autre époque permet de se connecter avec ce qui s’y est passé mais aussi ceux qui y sont passés. Ces archives mettent en avant les erreurs du passé, qui paraissent aujourd’hui si évitables… En bref : elles dépeignent « ce beau bordel là qu’ont été les années soixante-dix au Québec », concluent les « anarchivistes ».
En soufflant la poussière qui s’était installée sur ces reliques, les anarchivistes ont mis la main sur les manifestes de la contre-culture, qu’ils définissent pour nous lors de la conférence. C’est une « rupture productive et transhistorique qui rejette le mainstream » avancent-ils, qui a été influencée par l’émergence du rock aux États-Unis, mais aussi de partout où des gens se révoltaient contre le gâchis capitaliste. Ce fût l’époque où le drop out décrochage) social était commun, où l’on expliquait le fonctionnement des armes à feu révolutionnaires felquistes (militants du FLQ, Front de Libération du Québec, ndlr) dans des revues où l’on pouvait aussi trouver un tutoriel pour faire pousser sa propre marijuana. Ce sont des revues révolutionnaires telles que La Claque, Logos, ou Mainmise qui ont véhiculé cette contre-culture, et que nous avons maintenant l’occasion de feuilleter dans une vieille médiathèque à Montréal. ‑Amandine.
Contre-célébration
Nous étions le dimanche 27 avril 1975 quelque part à Montréal et une bande de jeunes organisait un marathon de poésie de musique, de 14h00 à 2h00 du matin. À la barre du micro défilèrent les poètes du futur, c’est à dire Josée Yvon, Allen Ginsberg, Denis Vanier, William Burroughs, et j’en oublie vingt-et-un — autant de héros du langage qui changèrent le visage et la voix de l’Amérique Nordique.
40 ans plus tard, samedi dernier, ils ont remis ça. Qui ça « ils » ? Les poètes bien sûr, ceux de 75 et ceux d’aujourd’hui, en hommage aux anciens, c’est à dire de vassaux à seigneur, puisque la poésie n’est après tout que l’exploitation agricole d’un langage, c’est à dire d’une même terre, et que l’on plante toujours ses choux sur la parcelle d’un autre qui était là avant nous (c’est d’ailleurs l’unique explication que Zadig&Voltaire devrait faire de la phrase de Candide, « il faut cultiver son jardin »).
C’était donc à l’Escogriffe, bar sombre et obscur de la rue Saint-Denis, à droite du Quai des Brumes quand vous descendez vers Sherbrooke, merci, bienvenue, bonne soirée, toi aussi. À l’ombre d’une scène mal éclairée par des lueurs vaporeuses de Guinness, Maudite et autres bières noires, à l’ombre de la nuit, à l’ombre de la vie, à l’ombre de tout cela réuni, la parole a repris son cours impétueux. Fiat lux, et lux fuit. Catherine Lalonde d’abord, accompagnée de Shawn Cotton, pour la lecture d’un duo Josée Yvon/Denis Vanier aux accents solennels et intimes. Le ton est donné, posé, place au poème.
Pas besoin d’avoir lu Introduction à la poésie orale de Paul Zumthor pour savourer les phrases qui tombaient en grappe cette soirée-là, des bouches ivres de sang des parleurs et des parleuses du collège informel de la vie littéraire. Un trio de jazz libre était planté derrière le micro, qui servait de l’improvisation en masse pour qui désirait un petit fond sonore à mettre au pied de leurs imbuvables vers qu’ils nous forcèrent à avaler.
C’était bon, littéralement et dans tous les sens, j’aimerais en manger davantage. Plus de Raôul Duguay dans son manteau de fourrure pourpre, casque à cornes de caribou sur le chef, trompette en main, mots dans la bouche. Plus de Paul Chamberland, élégant comme un prince qui s’excuserait d’en être, nous liturgifiant sa dernière encyclique personnelle et universelle, qui recale le Laudato Si’ du père François aux dernières vulgarités. Plus de sœurs DAF endiablées de partout, louant la mort du Christ un soir d’Octobre 70 sur un air de Jean Leduc. Plus de Jean-Paul Daoust, qui reste le Christian Dior de la poésie québécoise, quoiqu’en dise les racontars, tendez les yeux vers l’étoile de Marylin, elle vous répondra que oui. Plus de Sébastien Dulude à cheval sur son Patrick Straram, dégainant le lasso de sa phrase avec l’allant d’un John Wayne partant mourir à Rio Bravo pour la première fois. Plus de Mathieu Arseneau, haletant, haleté, instoppable, instoppé, prenant François Charron en excès de vitesse et le reste de la salle avec. Plus de ça, rien contre ça, tout pour ça. – Joseph.

Culture underground
Sous le petit dôme de verre de la Médiathèque Littéraire Gaëtan Dostie, la docteure en musicologie Marie Thérèse Lefebvre a accordé les couleurs de sa chemise rétro au thème du colloque qu’elle vient présenter. « L’Underground musical au Québec dans les années 70 », voilà un cadre qui va faire défiler dans nos imaginaires une suite de noms de musiciens excentriques, poètes insolents, magazines culottés et autres ingrédients alternatifs de la contre-culture de toute une décennie. Une décennie dont l’héritage est bel et bien vivant.
La musique underground se démarque du reste de la bulle musicale de l’époque par son absence d’institutionnalisation. Vers la fin des années 1960, tandis que la musique considérée comme overground (musique populaire ndlr) était subventionnée, enseignée et diffusée dans des émissions de radio, son obscur concurrent évoluait dans une démarche collective désordonnée, à l’ombre de toute forme d’autorité.
D’influence américaine, ce mouvement expérimental pose ses dalles sur les traces de John Cage, musicien absurde dont le « 4’33’’ for piano » présente un pianiste assis, qui se prépare à entamer son morceau pendant… 4 : 33 minutes.
La dimension politique des artistes de l’underground est omniprésente jusque dans les années 1970. Elle constituait une nébuleuse créative de groupes musicaux tels que le Quatuor de jazz libre dont le musicien Yves Charbonneau déclarait : « Avant d’être musicien, je suis révolutionnaire. Au lieu d’avoir une mitraillette, j’ai une trompette. Aux autres, je prêche la liberté en disant : jouez libre, vous aussi. » Cependant, peu à peu, la vigueur politique du mouvement s’est estompée pour se tourner vers une réflexion plus esthétique.
C’est cette recherche de qualité sonore qui encourage les artistes Patrick Straram et Claude Vivier à organiser l’évènement de rencontre musical : « Du Son sur Sanguinet » dont les concerts ont fait vibrer les murs de la salle Conventum, fondée en 1973 par le groupe du même nom. Même si cet événement tomba dans un vide médiatique – grève de la presse, arrêt de la revue Cucul chronique… – on pouvait lire dans la brochure de l’événement : « Une nouvelle musique indépendante, voilà ce que défendent les protagonistes du concert de ce soir. Des sons fascinants, une volonté profonde d’exprimer un univers sonore encore inconnu, l’expérience vivante de la création de nouveaux horizons pour la vie… pour le rêve. » ‑Céline.