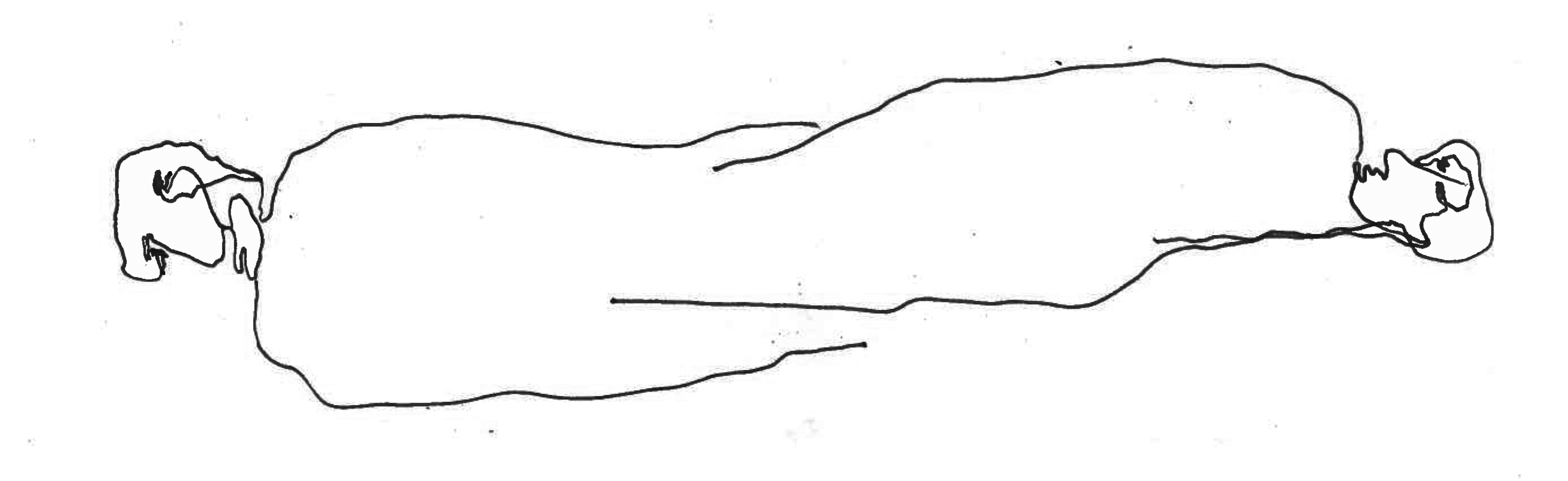La liste est longue et s’éternise : la remise en question des ateliers sur le consentement à McGill, les rites d’initiation douteux de la faculté de droit de l’Université de Montréal, la fin de semaine effroyable d’agressions sexuelles à l’Université de Laval, le Vet’s Tour aux pratiques dégradantes de l’Université d’Ottawa. Pour ceux qui doutaient encore de l’existence d’une culture qui banalise les gestes de violence sexuelle, le message ne peut être plus clair. En effet carce dernier mois s’est déployée une pièce sordide d’un genre douteux mettant en scène une nouvelle victime, de nouvelles accusations, un autre présumé violeur, une colère renouvelée. Que reste-t-il donc à prouver pour que cette indignation puisse enfin se transformer en action et que le changement de mentalité si nécessaire puisse avoir lieu ?
David contre Goliath
Caricaturale presque, l’histoire d’Alice Paquet, qui affirme que le député provincial Gerry Sklavounos l’a agressée sexuellement, a été la goutte de trop provoquant le scandale libérateur. Le courage dont a fait preuve la jeune femme pour évoquer les gestes présumés du député n’a d’égal que la violence des propos qui ont suivi sa déclaration. Il est temps d’admettre que les résultats de nos institutions juridiques, policières et gouvernementales ne sont guère satisfaisants pour un État de droit censé protéger ses citoyens. Si des survivantes telles qu’Alice avaient obtenu le soutien et le suivi nécessaire, tant juridique que moral, le témoignage de cette dernière n’aurait pas été déchiqueté violemment comme il l’a été. Dans un monde idéal où la parole des femmes est prise au sérieux, le témoignage d’Alice aurait pu être un vibrant appel à la solidarité et à l’entraide. Nos médias se seraient évité leur vaine logorrhée.
Il nous revient de questionner la place et la responsabilité de ces derniers dans ce type d’épisodes. À chaque occurrence d’une telle affaire, nous nous trouvons devant un dilemme moral. D’une part, portant le poids de notre propre histoire et des inégalités qui l’ont pétrie, on ne peut ni ignorer les cas où des violences sexuelles furent réduites au silence, ni les cas où des allégations fausses ont détruit la vie d’innocents.
En tant que médias, nous sommes incombés d’un devoir d’éthique. Un médium, quel qu’il soit, ne doit pas se faire la voix d’une justice populiste aveugle. En ceci beaucoup ont échoué. En allant fouiller dans le passé de la survivante, certains se sont fait le relais d’informations fallacieuses et non utiles au débat. D’autres encore, ont appelé le présumé coupable « criminel », se posant de facto en porte-à-faux vis à vis de la justice, au risque de diffamation. Si aujourd’hui beaucoup dénoncent cette justice populaire, nul ne peut nier que si les intervenants de première ligne avaient offert le soutien nécessaire à Alice, cette dernière n’aurait pas eu besoin de se tourner vers les médias pour obtenir ne serait-ce qu’un semblant de justice. Si victime il y a, elle doit pouvoir s’exprimer sans crainte ni jugement. Si coupable il y a, il doit pouvoir répondre des accusations qu’il reçoit. Nos institutions doivent se réformer pour corriger le tir : il en va de leur survie.
Pour un combat inclusif contre la culture du viol
On croyait derrière nous l’époque où la couleur de peau des accusés faisait les gros titres. Cependant, suite à la vague d’agressions sexuelles présumées qui ont eu lieu dans les résidences de l’Université de Laval, certains journalistes ont tenté d’établir une causalité douteuse, voire dangereuse, entre la culture du viol et la couleur de peau. Ce sont ces mêmes journalistes et commentateurs qui discréditent les survivantes lorsqu’elles dénoncent ce problème systémique. Sous entendre que la culture du viol est liée à une minorité est un aveuglement imprudent qui ne fait qu’exacerber les autres problèmes du Québec tel que le racisme systémique. Plus encore, ce serait pour certains une façon de se laver les mains et de dire que le problème vient d’ailleurs alors qu’il est au coeur de nos institutions. Ceux qui pointent du doigt les étrangers oublient que selon les données du Gouvernement du Québec 84,2% des jeunes victimes et 78,8% des victimes adultes connaissent leurs agresseurs, qui sont souvent un membre de la famille. La lutte contre les violences sexuelles n’est pas un combat à mener en pointant du doigt des minorités. Nous avons le devoir moral de nous interroger sur la manière dont la culture du viol imprègne l’ensemble de notre société, de nos médias à nos institutions policières. Face aux nouvelles récentes de violences sexuelles sans cesse renouvelées, nous ne devons pas nous contenter de nous scandaliser. Collectivement, nous devons repenser les tenants de notre culture et remettre en question la manière dont elle contribue à perpétuer et excuser la violence sexuelle. N’attendons plus le prochain scandale pour nous indigner. Pour en finir avec la culture du viol, nous devons mener un combat inclusif qui ne laisse personne de côté.
Et McGill dans tout ça ?
Au sein de l’Université McGill, l’équipe du Délit avait félicité les efforts de l’institution qui a [finalement] proposé une Politique contre les violences sexuelles. Ouverte à une consultation publique, cette politique est encore à retravailler et devrait voir le jour dans les prochains mois. Cette ébauche a mobilisé de nombreux groupes étudiants qui ont soumis leurs recommandations au sénat de l’Université (voir page 3). Toutefois, ce n’est pas assez. De nombreuses universités québécoises n’ont pas encore adopté de telles démarches. Les événements récents ont démontré l’urgence d’une stratégie provinciale pour pallier cette lacune.