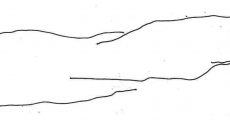2,5millions de dollars canadiens. C’est la somme attribuée au projet de recherche de Mme. Shaheen Shariff, professeure au sein de la Faculté des sciences de l’éducation à McGill, par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Projet ambitieux rassemblant dix universités et quatorze partenaires communautaires, celui-ci s’engage à remédier à la violence sexuelle au sein des campus universitaires canadiens sur les sept années à venir.
Le Délit a rencontré Shaheen Shariff et Carrie Rentshcler, collaboratrice au projet et professeure en études de communication et études féministes.

Le Délit (LD): Tout d’abord, que pensez-vous de la couverture médiatique des nombreux incidents de violence sexuelle survenus ces dernières semaines au Canada ?
Carrie Rentschler (CR): J’ai observé qu’il y a eu de nombreux journalistes qui ont été très compatissants avec les survivant•e•s et le mouvement contre la violence sexuelle — certain•e•s sont eux-mêmes des survivant•e•s d’agressions sexuelles, comme on a pu le voir avec le mot-clic #beenrapedneverreported (violé•e, jamais signalé, ndlr). La couverture médiatique de ces sujets a été récemment pertinente car elle a donné de la visibilité à plusieurs cas d’agressions sexuelles (bien que pas tous) et les revendications des activistes ont également été communiquées.
LD : Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette recherche ?
Shaheen Shariff (SS): Pendant vingt ans j’ai étudié le harcèlement en ligne et le sexting (l’envoi et échange de « sextos », ndlr), une pratique que les jeunes adoptent de plus en plus tôt et souvent de manière non consensuelle. J’ai remarqué que la réponse des universités face aux agressions sexuelles était similaire à celle des écoles dont les élèves ont subi du harcèlement en ligne : ils réagissent lorsque les médias portent attention à ces problèmes. Un autre constat est qu’il existe un manque accru de recherches universitaires sur la violence sexuelle au sein des campus — beaucoup de sondages initiés par les médias existent mais peu de recherches académiques. Dès lors, j’ai décidé qu’il faudrait étudier en profondeur le problème des violences sexuelles au sein des universités et trouver des solutions durables pour les pallier. De plus, le but de l’université est d’éduquer et d’améliorer notre société, il faut donc que cette institution redevienne responsable et entreprenne des politiques et des programmes informés sur la problématique des violences sexuelles. Toutefois les politiques seules ne sont pas suffisantes car les étudiant•e•s utilisent les réseaux sociaux et consomment une culture populaire qui véhicule des idées sexistes et la « culture du viol » — il faut également s’attaquer à ce problème. C’est pour cela que le projet comporte trois axes : (1) le rôle des lois et des politiques au sein des universités (2) le rôle et l’influence de l’art et la culture populaire (3) le rôle et l’influence des médias conventionnels et les réseaux sociaux.
LD : Quel est votre rôle au sein de cette recherche ?
CR : Je supervise l’axe de recherche sur l’art et la culture populaire. Je compte entreprendre un projet qui évaluera les différentes politiques contre la violence sexuelle qui existent sur les campus canadiens. J’étudierai comment ces politiques conversent et interagissent avec l’activisme étudiant et le travail pédagogique qui tous deux s’attaquent aux problèmes de violence sexuelle. C’est principalement l’activisme étudiant qui a mené le développement de ces politiques et organisé des structures de support pour, les survivant•e•s. Je pense donc que l’on peut apprendre de leurs actions et dès lors examiner leurs stratégies afin de transformer le débat actuel autour de la culture du viol sur les campus. La question que ce projet pose est : à quoi ressemblerait une institution, et ses membres, qui seraient responsables de la violence qui existe sur leur campus ?
LD : Existe-il des partenariats avec des universités francophones ?
CR : Nous avons l’opportunité ici de pouvoir travailler avec nos collègues des universités québécoises, notamment le Réseau québécois en études féministes. À l’origine, le don de financement a été donné à des institutions anglophones ‚mais je suis ouverte à ce que nous utilisions ce don avec d’autres universités ou écoles de la province qui eux aussi luttent contre la violence sexuelle. Je suis en contact avec le RéQEF (Réseau québécois en études féministes, ndrl) qui a créé un sondage destiné aux universités de la province et qui vient prendre la température du climat autour de la violence sexuelle ainsi que des expériences d’agressions sexuelles. J’espère pouvoir amener ce sondage au sein de McGill afin que nous participions à une conversation plus large à l’échelle du Québec.
LD : L’expression culture du viol est controversée, que pensez-vous de ce concept ?
CR : Je pense que c’est un concept très utile car il est utilisé par les activistes. C’est un moyen de formuler le problème et de le nommer. Le terme signifie que les agressions sexuelles ne sont pas simplement un problème interpersonnel mais aussi structurel. Il indique qu’il existe un soutien culturel et structurel à la violence sexuelle, la normalisant et minimisant son importance pour les survivant•e•s. Bien que certains soient critiques de la définition de « violence sexuelle » et du sens ambigüe de « culture », je pense que c’est important de nommer le « viol » en tant que problème et comprendre les sources de la violence sexuelle comme les politiques, les négligences institutionnelles et les sous-cultures encourageant un comportement masculin agressif, entre autres.
LD : Que pensez-vous du projet de politique contre la violence sexuelle de l’Université ?
SS : Je pense que ce projet est un bon début. Un bémol néanmoins, il ne mentionne pas les réseaux sociaux et la violence en ligne. De plus, j’apprécie qu’il soit centré sur les survivant•e•s bien que des officiers chargés des affaires disciplinaires ont fait remarquer qu’il faudrait également une procédure officielle pour les agresseurs présumés. Pour aider les universités, nous allons établir d’ici un an un livre blanc qui présentera ce qui existe à l’heure actuelle en termes de politiques, et qui servira de point de départ. Au fil des années, au vu des recherches et à l’issue de consultations auprès des étudiant•e•s, nous retravaillerons le livre blanc et modifierons les recommandations.