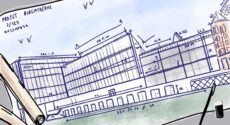Il est 16h30. En cette journée de fin novembre, les immeubles que j’aperçois par la fenêtre de la bibliothèque s’allument déjà. L’atmosphère extérieure est entre chien et loup. Il fera nuit dans quelques minutes, et la prochaine fois que le jour réapparaîtra, je dois avoir fini mon papier de 15 pages. La nuit promet… Il va me falloir de l’énergie et de la concentration pour réussir à « pondre » un essai de 8000 mots ! Pourtant, je sens déjà la fatigue peser sur mon corps et ai l’impression que mon esprit est saturé d’idées. Cela va faire trois semaines de suite que je me retrouve dans des situations similaires à celle-ci, avec d’autres cours, et ma motivation pour « tout donner » s’effrite. Mais pourquoi ne m’y suis-je pas prise plus tôt ? Pourquoi ? C’est dans ces moments-là que l’on se déteste, que l’on dit « plus jamais ! » C’est aussi dans ces moments-là qu’on voudrait une pilule magique, une qui procurerait motivation, persévérance, énergie, et concentration pendant plusieurs heures à la suite.
C’est la promesse que tiennent l’Adderall, le Ritalin, la Modafinil, le Vyvanse, le Concerta, et pour certains même de la marijuana. Toutes ces smart drugs, aussi appelées stimulants d’ordonnance, sont normalement prescrites sur ordonnance pour d’autres troubles neurologiques comme le TDAH (Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) ou encore la narcolepsie. Elles sont cependant utilisées par de nombreux étudiants en bonne santé qui les obtiennent illégalement. La consommation de tels produits a grimpé en flèche pendant la dernière décennie, bien qu’elle concerne surtout des personnes sans antécédents neurologiques, notamment des étudiants de premier cycle. L’usage non-médical de psychostimulants représente la deuxième forme d’usage de drogues illégales à l’université, juste après la marijuana. Entre 2010 et 2015, la consommation de Ritalin, un des stimulants d’ordonnance les plus vendus au Québec, a augmenté de 56%. Cette réalité choque certains, alors que d’autres félicitent la science d’avoir inventé ce nouveau « boosteur » cognitif.
Reste à savoir quelles sont les raisons et enjeux derrière cette hausse d’usage. Est-ce une avancée scientifique signifiante, assouvissant le perpétuel désir humain d’augmenter ses capacités intellectuelles ? Ou est-ce une fausse-bonne idée ? Afin de mieux comprendre ce phénomène contemporain, Le Délit a recueilli dix-neuf témoignages, majoritairement d’étudiants mcgillois utilisant des psychostimulants.
Une « smart drug » rend-elle réellement plus intelligent ?
La plupart des smart drugs agissent — au même titre que la cocaïne et la méthamphétamine — sur la quantité de dopamine qui circule dans notre cerveau, un neurotransmetteur associé au plaisir, au mouvement et à l’attention. Bien que ces psychostimulants aient des différences notables de fonctionnement neurologique et d’effets, la principale raison donnée dans les témoignages relève de leur capacité à augmenter la concentration chez l’individu pendant plusieurs heures d’affilée. Ces stimulants permettent aussi de couper la sensation de faim ou de fatigue. On ne peut cependant pas dire que ces substances augmentent nos capacités intellectuelles à proprement parler. Les stimulants aident à booster la performance d’un individu lors de l’apprentissage dit « par cœur » (rote-learning task, ndlr), mais ils n’augmentent en aucuns cas le Quotient Intellectuel (QI) de l’individu.
Est-ce une avancée scientifique signifiante, assouvissant le perpétuel désir humain d’augmenter ses capacités intellectuelles ? Ou est-ce une fausse-bonne idée ?
Tout démarre à l’université et ce n’est pas un hasard
L’exemple cité plus haut n’est qu’un profil d’usage de ces drogues parmi une plus grande variété de situations. Sur les 19 personnes ayant participé au sondage, 11 ont répondu à la question « Pour quelle occasion consommez-vous le plus souvent ce type de produit », par « Quand j’ai vraiment une charge de travail trop importante et que je dois cram de manière efficace ». Ces mêmes personnes semblent aussi consommer la drogue occasionnellement, « très rarement » ou « 2 à 4 fois par semestre ». Un·e témoignant·e assure qu’il ou elle a réussi, grâce à un stimulant, à rattraper l’entièreté du contenu d’un cours en seulement trois jours. Il ne serait pas étonnant que cela soit le cas durant la période des examens de mi-session et des examens finaux.
L’université — fonctionnant très différemment des études secondaires — repose sur un système où l’Étudiant est peu évalué pendant une longue période, mais où il doit s’auto-discipliner pour travailler régulièrement. Aucun ou très peu de suivi de l’élève est assuré durant cette période par le professeur, ou bien le TA (Teaching Assistant, ou Assistant au Professeur, ndlr). Puis, à certaines périodes, toutes les évaluations — aussi importantes les unes que les autres, puisque peu nombreuses le long du semestre — tombent au même moment. L’étudiant est majeur, nous-dirions nous, « il est grand maintenant », il doit se gérer comme un adulte sans que quelqu’un ne doive lui tenir la main ? Certes, mais ce n’est pas si simple lorsque l’on sait qu’aucune transition n’est assurée avec le système éducatif précédent, et qu’il s’agit aussi en première année de savoir jongler entre vie académique, extra-scolaire et sociale, et, pour beaucoup, loin de leur famille, l’entité structurante principale pour la plupart d’entre eux auparavant. De nombreux témoignages précisent d’ailleurs avoir commencé à en prendre lors de leur première année d’université.
Plus problématique encore, 9 personnes disaient consommer ce produit « pour obtenir les résultats escomptés », alors que 10 en prennent pour « réussir à simplement faire tous mes devoirs ». À cela s’ajoute le fait que l’usage de psychostimulants est proportionnel à la compétitivité des universités, et que l’on se plaît à surnommer McGill le « Harvard du Canada ». Il s’agirait donc ici d’un usage avec un objectif différent : pallier son écart de notes avec les autres étudiants de l’Université, ou réussir à gérer la quantité de travail assignée — ici, au quotidien. McGill est connue pour être une université avec une exigence académique considérable, et certains diront même qu’il y règne une ambiance de compétition entre les élèves. Pour avoir des « A », un petit « coup de pouce » avec un psychostimulant peut augmenter les notes qu’auraient les étudiants par rapport à la situation ou ils travailleraient « sobres ».
Ces stimulants, pris plus régulièrement, semblent être la seule voie possible pour réussir à atteindre les objectifs souvent trop ambitieux d’étudiants sous pression, parfois asservis par cette idée de toujours être plus performant. À la question, « Avez-vous l’impression que vous ne pouvez pas réussir (académiquement, socialement ou autre) sans consommer ce produit ? », 4 personnes ont répondu « Oui ». Ils ou elles justifient cette réponse par des réponses variées : « Je n’arrive pas à me discipliner sans », « ça me permet de réussir à tous les niveaux de ma vie » ou encore « Je n’arrive pas à avoir les notes dont j’ai besoin, je n’arrive pas à étudier pendant des heures comme les autres ». Il ne s’agit pas ici de généraliser. 7 personnes ont répondu qu’ils pourraient très bien vivre sans, et que s’ils « ne “procrastinaient” pas tant » ou qu’ils « géraient leur temps d’une meilleure manière », ils n’en auraient pas besoin.
Comment justifier cette augmentation d’utilisation ?
Il semblerait tout d’abord que l’on assisterait à un surdiagnostic du TDAH au Québec ces dernières années, qui pourrait être expliqué, selon les docteurs Joel Paris et Brett Thombs de l’Université McGill, par une définition trop vague des critères pour définir la condition d’hyperactivité. Ainsi, des étudiants pourraient obtenir une ordonnance assez facilement en allant voir un médecin. On sait aussi, à en croire le sondage du Délit et d’autres témoignages sur Internet, qu’une grande partie des étudiants qui consomment illicitement des stimulants se le procurent par un ami qui a lui-même une ordonnance.
Des facteurs générationnels pourraient aussi être à l’origine de cette augmentation. Dans un article académique, N. Katherine Hayles met en lumière la différence entre deux modes cognitifs symboles de leurs générations respectives — l’hyper attention et l’attention profonde (hyper and deep attention, ndlr). Alors que les générations précédentes tendaient à porter une attention profonde aux tâches qu’ils effectuaient — c’est à dire se concentrer sur une seule et unique tâche pendant une durée prolongée, avec un seul média d’information — la nouvelle génération aurait un mode de fonctionnement cognitif alternatif. Avec l’explosion de la diversité des sources médiatiques, et des médias par lesquels nous communiquons, nous aurions tendance à favoriser l’hyper attention et l’hyper stimulation : autrement dit, au lieu de se concentrer sur une seule tâche en particulier, nous préférerions effectuer plusieurs choses à la fois en passant très rapidement d’une tâche à l’autre, mais tout en allant moins en profondeur que si nous ne réalisions qu’une unique tâche. Parallèlement à cette évolution, les attentes universitaires n’ont que peu changé, restant ainsi plus adaptées à une forme d’attention profonde — par exemple, faire des lectures de plusieurs dizaines de pages, au lieu de favoriser un format d’apprentissage plus interactif. Ainsi, nous sommes confrontés à un mal-être générationnel, et éprouvons beaucoup plus de difficulté à se concentrer sur une seule tâche et donc à faire les choses en profondeur. D’après Hayles, notre déficit d’attention et de concentration se rapprocherait même des symptômes ressentis par les personnes atteintes du TDAH — ironique quand l’on sait que les stimulants pris par les étudiants sont à l’origine créés pour traiter cette déficience.

Un pari risqué
Il faut mettre des mots sur une réalité : utiliser des stimulants non prescrits reste un pari risqué. Le faire, c’est s’exposer à des risques très importants. Comme pour tout médicament, les antécédents personnels influent considérablement sur les possibles effets indésirables que peut provoquer la prise d’une substance. Les psychostimulants sont prescrits avec prudence puisqu’ils sont, par exemple, connus pour être extrêmement dangereux pour des personnes avec des antécédents cardiaques (ils peuvent causer une mort subite).
Bien qu’ils ne touchent pas l’ensemble des ses consommateurs, ces substances comportent de nombreux effet secondaires indésirables. Parmi les témoignages recueillis par Le Délit, si 5 personnes assuraient ne pas avoir ressenti d’effets secondaires particuliers, 5 personnes déclaraient être sujettes à une forte anxiété pendant le temps d’effet du médicament.
Il est aussi facile de faire une overdose, notamment avec l’Adderall : les dosages à prescrire dépendent du poids et de la taille de la personne, et le changement de dose peut faire une très grande différence. Une overdose d’un stimulant peut causer une psychose, des convulsions, ou des événements cardiovasculaires (hypertension et tachycardie), entre autres. Se pose aussi la question d’accoutumance à la substance ingurgitée, même si cela concerne davantage les utilisateurs réguliers. Si la Modafinil ne semble pas être addictive, Adderall a un potentiel très important d’addiction. Dans un des témoignages recueillis par Le Délit, un individu qui a pris de l’Adderall tous les jours pendant 8 mois raconte à quel point il a été dur d’arrêter d’en prendre après, et comment il ou elle s’est alors senti·e lassé·e, fatigué·e et non productive.
Quant aux effets des stimulants à long-terme, ils restent encore très peu documentés car l’utilisation de ce type de drogue est assez récente. Certains chercheurs pensent que l’usage de cette drogue pourrait affecter notre plasticité cérébrale, c’est-à-dire la capacité de notre cerveau à remodeler ses connexions entre nos neurones, et donc celle à s’adapter à différents contextes et situations. Cependant nous ne sommes pas à l’abri d’autres effets à long terme qui n’ont pas encore été anticipés.
Surtout, ces substances semblent déteindre très négativement sur la vie sociale du consommateur — un effet secondaire susceptible d’inquiéter particulièrement des jeunes dans leur âge d’or. De nombreux témoignant·e·s relevaient l’impact des stimulants sur leur sociabilité : « je suis froide avec les gens autour de moi, je vis un détachement social » disait l’une. Un autre individu du sondage, qui prenait de l’Adderall tous les jours, énonçait « je suis devenue une personne différente. Je n’aimais pas la personne que j’étais devenue, j’ai perdu mon aptitude à me relaxer et j’ai perdu mon sens de l’humour. Même des mois après avoir arrêté, je me battais pour retrouver mon « mojo »». Sebastian Serrano, journaliste pour le site Vice, intitulait son récent article « Prendre de la Modafinil m’a fait aimé le travail mais détester les gens ».
Des enjeux éthiques à la fois clairs et ambigus.
Plusieurs questionnements éthiques se posent quant à l’utilisation de ces drogues. Les psychostimulants pourraient-ils être un facteur d’inégalités entre les étudiants ? Premièrement, il faut penser aux personnes qui ont réellement besoin de ces traitements, les personnes atteintes de TDAH (ou d’autres déficiences neurologiques). Grâce à ces stimulants, il arrivent à remédier à leurs lacunes et donc à arriver au même niveau que celui de leurs camarades. Mais qu’en est-il lorsque ceux-là commencent eux aussi à prendre le même traitement ? C’est un retour à la case départ : leur retard par rapport aux autres est de nouveau rétabli. C’est aussi une inégalité financière qui est à la clé. Ces substances ont un prix élevé : si beaucoup d’étudiants se mettent à utiliser cette drogue, les étudiants qui n’ont pas les moyens d’acheter ces pilules « magiques » pourraient être désavantagés dans la course à la meilleure GPA (Grading Point Average, ndlr).
Cela nous amène à une autre question capitale : celle de la tricherie — alors qu’il est rappelé dans la totalité des syllabi que « L’Université McGill attache une haute importance à l’honnêteté académique ». À quel point modifier artificiellement nos capacités cognitives peut-être assimilé à de la tricherie ? C’est une interrogation à laquelle il est difficile de répondre, puisque considérer les psychostimulants comme de la tricherie nous amènerait à devoir caser le café et les boissons énergisantes dans la même catégorie — deux psychostimulants qui sont utilisés à tire-larigot par la majorité des étudiants. Aussi, où tracer la limite de l’acceptable ? Devrions-nous mécaniquement suivre la limite normative qui découle de notre système légal entre le licite — café et boissons énergisantes — et l’illicite ? Si il est clair que le café a des effets plus faibles que les psychostimulants, à quel point plusieurs tasses de cafés peuvent-elles être considérées équivalentes à une demi-pilule de Modafinil faiblement dosé ?
La robotisation de la société et la course à la productivité
Ce qui dérange, fondamentalement, c’est la manière dont cette consommation témoigne de manière frappante des vices de notre société contemporaine. L’utilisation régulière de stimulants cognitifs à la fois découle du paradigme de la réussite et de la productivité, dont les étudiants semblent être les premières victimes, mais aussi nourrit davantage. Derrière cette utilisation de substances psychotropes prône la volonté d’être encore plus performant au prix, pour beaucoup, de sa santé et de sa vie sociale.
C’est pourtant un jeu dangereux : le chemin de l’amélioration de la productivité n’a pas de fin. Si l’utilisation de stimulants se banalise réellement, un nouveau pallier sera alors créé. Les compteurs seront remis à zéro, nous serons à nouveau tous au même niveau, et nous chercherons à nouveau à améliorer nos capacités. Ce cycle de la destruction créatrice dans la technologie — celui qui nous fait passer du téléphone fixe au portable, puis au téléphone intelligent, etc — serait transposé à l’humain.
Il ne s’agit pas ici de porter un jugement sur les étudiants qui utilisent des psychostimulants. Cette enquête démontre qu’ils en prennent pour pallier des difficultés compréhensibles et partagées. Mais est-ce vraiment la solution à ces problèmes ? L’utilisation de ces stimulants révèle les maux dont souffrent les étudiants sans être pour autant le meilleur remède. Il faudrait peut-être mieux s’attaquer aux causes de ces difficultés, et non pas à nos cerveaux en bonne santé. Il s’agirait de repenser notre système scolaire qui manque d’accompagnement, de soutien, et de méthodes pédagogiques adaptées à notre ère. Il s’agirait aussi de remettre en question notre conception de la réussite et de la productivité qui semble nous amener à être bien trop durs et exigeants avec nous-mêmes.