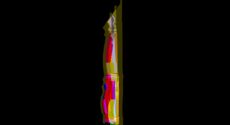Pascal Lapointe est diplômé de l’Université Laval au baccalauréat en communications (1987) et à la maîtrise en histoire (1990). Journaliste indépendant depuis 1988, il est actuellement le rédacteur en chef de l’Agence Science-Presse. Il a publié Le journalisme à l’heure du Net (1999) et co-publié Les nouveaux journalistes : le guide (2006).
Le Délit (LD): Pour nos lecteurs, voulez-vous nous dire en quoi consiste l’Agence Science-Presse ?
Pascal Lapointe (PL): Il s’agit d’un média qui a été créé il y 39 ans maintenant, en 1978. Il est à but non-lucratif, indépendant et bien sûr spécialisé en science. Il a comme particularité d’être une agence de presse, c’est-à-dire un média dont la mission première est de vendre des articles et distribuer des articles à d’autres médias.
LD : Habituellement, à qui vendez-vous vos articles ?
PL : À l’origine, nos premiers clients des années 1970–1980 étaient les hebdomadaires régionaux avec de petites équipes. C’est un marché qui a beaucoup diminué et même pratiquement disparu. Avec l’arrivée d’Internet, on s’est mis à distribuer nos articles gratuitement à tous. Ceux qui sont restés comme clients directs, ce sont des médias tels que le journal Métro, Le Devoir, mais aussi des médias spécialisés. On a, par exemple, un contrat avec le magasine Naître et grandir pour leur faire des actualités chaque semaine sur la santé des jeunes enfants et un partenariat avec Planète T en ce moment pour le détecteur de rumeurs. On a des partenariats ponctuels comme ceux-là et non plus des grands bassins d’abonnés comme on en avait.
LD : À votre avis, quel est l’état du journalisme scientifique au Québec ?
PL : Bon, il est certain qu’il ne se porte pas très bien. D’un autre côté, il n’a jamais été très fort non plus, il n’y a jamais eu une vague de journalisme scientifique. Alors, deux choses : en terme d’espace rédactionnel, cela n’a pas changé et il y en a aussi peu qu’il y en avait ; par contre, [le journalisme scientifique] subit les mêmes problèmes que subit le journalisme en général, c’est-à-dire qu’il y a des coupures de budget et pour les journalistes pigistes, c’est devenu beaucoup plus difficile de vivre de la pige. Je ne crois pas qu’il subsiste un seul journaliste au Québec qui soit capable de vivre uniquement du journalisme scientifique. Il doit aller chercher des revenus ailleurs dans d’autres secteurs du journalisme. Alors, on ne peut pas dire que le journalisme scientifique se porte mal en terme d’espace, mais il subit les contrecoups de la crise des médias depuis 15–20 ans. Il y a eu un plafonnement à partir des années 1980–1990.
LD : Expliqueriez-vous ce plafonnement par l’accès dorénavant plus facile à du contenu scientifique par l’intermédiaire d’Internet ?
PL : En partie, oui. C’est difficile de donner une seule cause, puisque pour les États-Unis, ce plafonnement a commencé dans les années 1980 alors qu’au Québec on le situe à peu près au milieu des années 1990. Donc, les années 1980, c’est avant l’apparition d’Internet. Un autre facteur, que l’on a souvent tendance à sous-estimer, c’est la montée en force de la communication d’entreprise. Avant les années 1980, dans les universités par exemple, les relationnistes spécialisés en science n’existaient pratiquement pas. Il n’y a que McGill qui en avait. Aujourd’hui, c’est systématique. Donc, on se retrouve devant une situation où il y a plein de gens, de groupes, d’investisseurs qui ont choisi à partir des années 1980–1990 d’investir dans la communication à partir de la source. L’argent qu’ils auraient pu donner à de la pub dans des magazines de science a cessé de circuler. Donc, le plafonnement du journalisme scientifique se produit à un moment où, parallèlement, on assiste à une explosion des emplois en communication scientifique.
LD : De quelle manière la culture scientifique, à travers l’éducation et la conversation, peut-elle orienter, quant à elle, la conversation démocratique ?
PL : Bonne question ! De quelle manière pourrait-elle l’orienter ? C’est sûr que si l’on recule 50 ans en arrière, on a une société où la science occupe une plus grande place, donc on peut dire que le public est davantage outillé sur les enjeux pointus. En même temps, [aujourd’hui] il y a tellement peu [de discussions] qu’il n’y a pas suffisamment d’outils. L’enjeu des OGM (organismes génétiquement modifiés, ndlr) serait sans doute différent s’il y avait une culture scientifique différente face à ce qu’est la génétique, un gène, un OGM. Il y a une différence entre comment la culture scientifique a influencé le discours et comment elle pourrait le faire. Il y a encore du chemin à faire. On le voit aussi —je ne sais pas si c’est relié à votre question— dans le discours des politiciens. On se rend compte à quel point le discours des politiciens serait différent s’ils étaient plus nombreux à appuyer leurs argumentaires avec des données probantes. La plupart du temps, ils vont plutôt traiter un enjeu scientifique de la même façon qu’ils traiteraient un enjeu politique : c’est noir ou c’est blanc. Encore pire, les gens ont peur de telle affaire alors on va la mettre sur la glace.
LD : Si vous me permettez, je me souviens de la lecture d’une conférence qu’a donnée Wittgenstein où il exprimait la critique selon laquelle, à travers la vulgarisation, une part importante d’un certain public aimerait croire qu’il comprend certaines choses, alors qu’il n’aurait finalement pas vraiment cette volonté de comprendre. Plutôt, il voudrait avoir le paraître de la chose. Qu’en pensez-vous ?
PL : C’est un peu sévère, mais il y a évidemment un fond de vérité lié à ça ; on veut tous avoir l’air plus intelligent. Ça dépend, j’imagine, de quelle définition l’on donne à « comprendre ». Du point de vue, disons, d’un physicien quantique, il est clair que cela prendrait des années d’études avant de comprendre au sens où il l’entend. Par contre, lorsqu’on fait un article sur le boson de Higgs et qu’on parvient à faire comprendre au lecteur ne serait-ce qu’il fait partie de la structure du cosmos, que cette petite particule-là est responsable du fait que toutes les particules ensemble se tiennent, déjà on a aidé à faire comprendre un petit quelque chose. Bien sûr, le niveau de compréhension est très loin de ce qu’un physicien aurait, mais à mon sens c’est quand même important. De ce point de vue, ce n’est pas une totale illusion que le public puisse comprendre ; dans sa tête, il a placé le boson de Higgs au milieu d’un champ d’autres particules et si jamais cela l’intéresse de creuser, cela pourra lui ouvrir une fenêtre pour lui donner un point de départ. Alors que d’autres vous diraient que la vulgarisation aide à susciter la curiosité, je pense que sa première fonction consiste à ouvrir des portes.