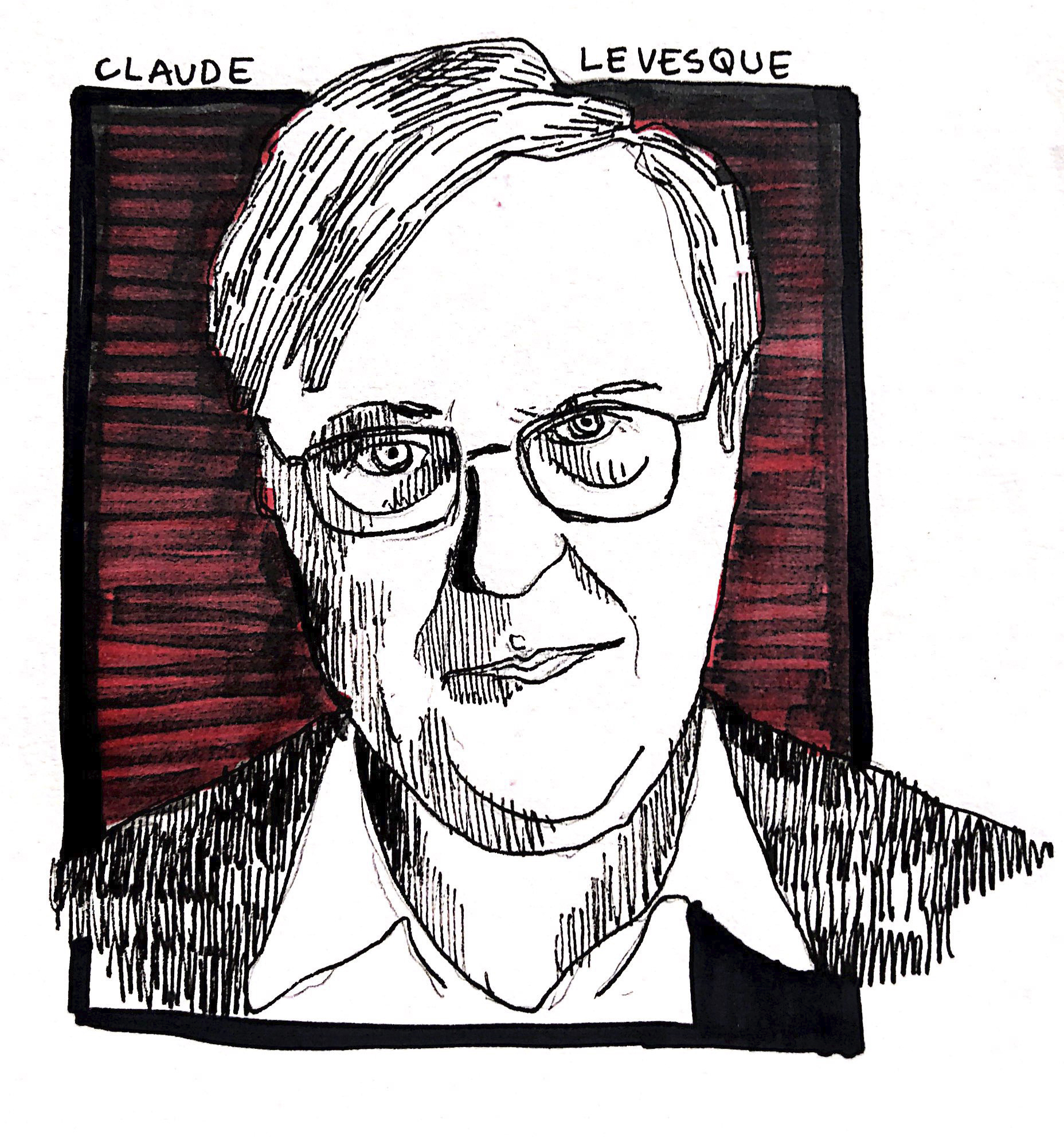26 septembre 2018. Une causerie autour de la réédition de L’étrangeté du texte de feu Claude Lévesque est organisée à la librairie Olivieri. Le fils du philosophe, Nicolas Lévesque, lui-même psychanalyste et essayiste, l’écrivaine et professeure Catherine Mavrikakis, ainsi que l’acteur et dramaturge Alexis Martin y sont présents. Cette triade hétéroclite ne l’est qu’en apparence. Une humanité toute particulière unit nos trois causeurs ; ils portent dans leur chair le souvenir de Claude Lévesque.
Claude Lévesque
Claude Lévesque est un classique de la philosophie québécoise. Comme l’indiqua Nicolas Lévesque, une causerie comme celle entourant la réédition de L’étrangeté du texte permet de bâtir un espace propre à une telle édification. Quand bien même un classique, qui était Claude Lévesque ? S’il est vrai que « la culture [québécoise] a besoin [de son] fantôme », il convient de présenter l’homme, dans la limite du possible. Or, peu d’étudiants le connaissent aujourd’hui.
Comme une comète qui est passée, la mémoire de Lévesque ne semble perdurer que dans la chair de ceux et celles qui l’ont connu. Homme d’une grande théâtralité, la causerie qui eut lieu à la librairie Olivieri fit place à des hommages chaleureux dont on enviait l’opportunité. Cet homme qui riait, avec qui le rire ponctuait, savait que « la tragédie finit par un grand rire ».
Philosophe de l’étrange, nous lui devons L’Étrangeté du texte (1976), Dissonance : Nietzsche à la limite du langage (1988), Le proche et le lointain (1994), Par-delà le masculin et le féminin (2002) et Philosophie sans frontières (2010), entre autres choses.
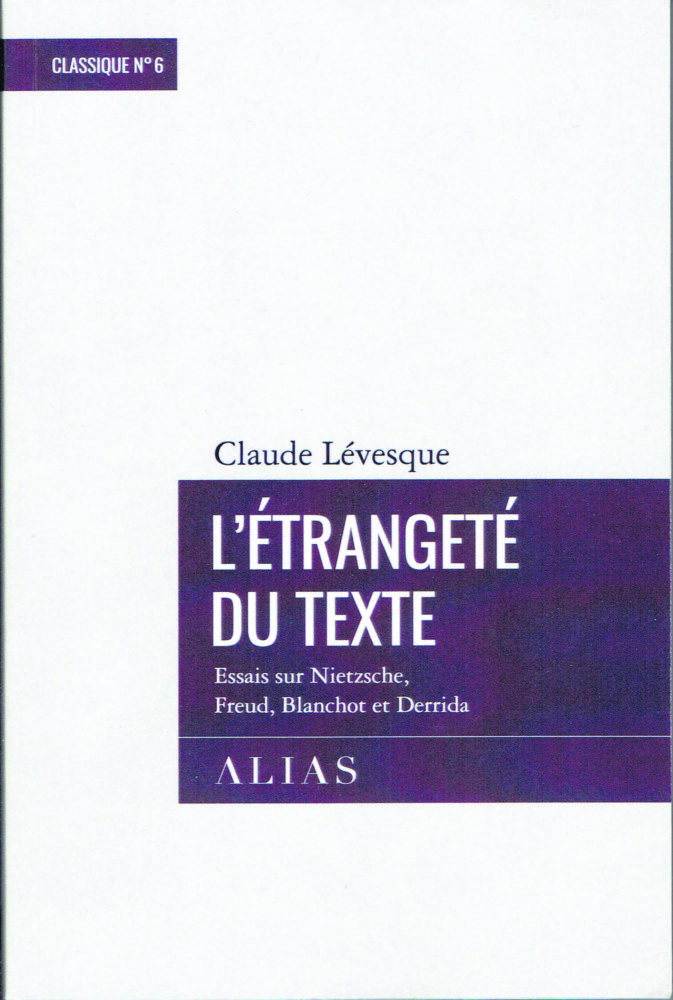
Forcer son chaos à prendre forme
Un portrait de Claude Lévesque s’avère être le contexte promit au bénéfice d’une sortie des narrations au « nous » que j’affectionne tant.
J’ai lu L’étrangeté du texte dès le lendemain. Sans répit, sans souffle pour finir. Cette lecture m’a laissé le corps vieilli, le cœur en miette et la puissance d’exister chancelante. C’est un texte dont on ne saurait recommander une lecture rapide. Lévesque fait partie de ces humains qui savaient professer le monde et ses vérités meurtrières tout en y survivant. Malgré cela, d’aucuns demandent à quelle poétique il pouvait bien faire appel pour y parvenir. Circuler à cette hauteur n’est pas sans risque. Nous-mêmes, en sommes-nous capables ? Le suis-je ? S’il connaissait la maxime nietzschéenne « toute philosophie est la confession de son auteur », il n’était probablement pas sans savoir qu’écrire sur l’étrange signifiait certainement la reconstitution de la mémoire d’un corps… Quelle trace portait-il de cet étrange ? Lui qui est demeuré au ban du monde universitaire toute sa vie, à l’extérieur, et dont les témoignages racontent la souffrance mêlée à la jouissance. Ces questions souffrent de ne pouvoir trouver de réponse.
« Cette sagesse tragique n’a toutefois pas un caractère dramatique ni romantique », disait Lévesque. Cette étrange sagesse, non sans risque, est un gai savoir au sens nietzschéen. Elle nous appelle à forcer notre chaos à prendre forme. De la rencontre avec l’étrangeté – ce qui nous est extérieur et impropre – nous détenons la vue d’un univers brûlant. S’il fait l’effet d’une tourbière, nous ne saurions combattre la fourberie qui nous amène à nous-mêmes déjouer et mettre en déroute le monde de l’étrange. Le pharmakon de Platon est au poison et au remède ce que l’étrangeté de Lévesque est au proche invisible et au lointain visible. Un peu comme le Zarathoustra de Nietzsche, notre philosophe québécois porte la « parole la plus lourde ». Notre triomphe contre le flétrissement, contre la toujours plus pressante dichotomie platonicienne, est le lieu d’un espace « où s’affirment en même temps le désir et la jouissance, les pulsions de vie et de mort, la réalité et la fiction, le possible et l’impossible ».
Avec Lévesque comme compagnon de route, nous sortons de la tension. « Désormais, c’est dans l’ombre et la nuit amicale, dans le froid qui dégrise, qu’il faudra traquer un nouveau soleil. »
Philosophie sans frontières
Si, comme l’affirme Claude Lévesque, le projet de la philosophie est démesuré, en cela qu’il doit rendre compte « de tous les discours, de toutes les disciplines, de tous les arts, de toutes les institutions et régimes possibles », force est de constater que l’objet à penser commande « une écriture nomade, aventureuse, intempestive, risquée, ouverte en droit sur le texte général et sans bordure ». Bref, une philosophie sans frontières. Or, une telle profession demande à ce que le philosophe se fasse écrivain, artiste, maçon, bûcheron, architecte, archéologue… Bergson, dans La pensée et le mouvant, nous entretenait entre autres sur la particularité de l’artiste à mieux saisir certaines perceptions du monde pour lesquelles notre quotidien nous rend aveugles. La démesure de Lévesque demande à dépasser cette frontière propre à l’artiste, elle nous annonce que le philosophe se doit d’être tout. Le peut-il ? Le veut-il…? Si Lévesque s’est fait écrivain, s’est-il fait jardinier ? Si Sartre et quelques autres ont su créer des œuvres voisines à la totalisation, la profession de cette dernière à laquelle appelle Lévesque tient d’une situation dont nous devons sérieusement souligner les risques. Le monde est une véritable poudrière et le feu doit être tenu en respect.
Les livres de Claude Lévesque doivent-ils se populariser ? Doivent-ils plutôt, comme Nietzsche et Rohde le prévoyaient dans leur correspondance au sujet de Vérité et mensonge au sens extra-moral, constituer un répertoire ésotérique en philosophie ? Au demeurant, un répertoire auquel nous trouverions l’accès par un appel auquel nous ne serions plus sourds. Loin d’y répondre, j’aimerais plutôt prescrire un peu de Nietzsche, de Bataille et de Lévesque. Beaucoup de Bergson, de Bachelard de Jankélévitch. Si nous sommes à voir cette tension qui travaille les deux camps, si l’en est, chacun tirant la couverture de son côté, quelques mots des premiers heurtent ô combien davantage que plusieurs traités des seconds. Mais ce sont bien ces derniers qui sont à même de nous faire vivre. À cet égard, vivre est préféré à l’absolue « passion de l’abîme ». Non que la dernière permette la première, elle est pourtant nécessaire à qui attend davantage du monde. Si tout doit s’achever dans le rire pour Lévesque, dans le grand rire, c’est bien parce que la vie doit se réapproprier ses droits contre la mort qui nous travaille. C’est pourquoi, certains d’entre nous sommes appelés à une danse macabre entre les deux ! Loin d’un impossible, cette danse endiablée a compté son propre chantre : Gaston Bachelard.
Sans rien enlever à la puissance des textes de Lévesque — tout au contraire —, rappelons que Nicolas Lévesque souligne avec chaleur ce que peut être la puissance de l’étrangeté lorsqu’il expose que « pour [lui], il y a beaucoup plus d’espoir dans l’obscurité, dans l’ébranlement et dans l’étrangeté que dans la clarté » et qu’au fond, « les Lumières totales deviennent totalitaires ».
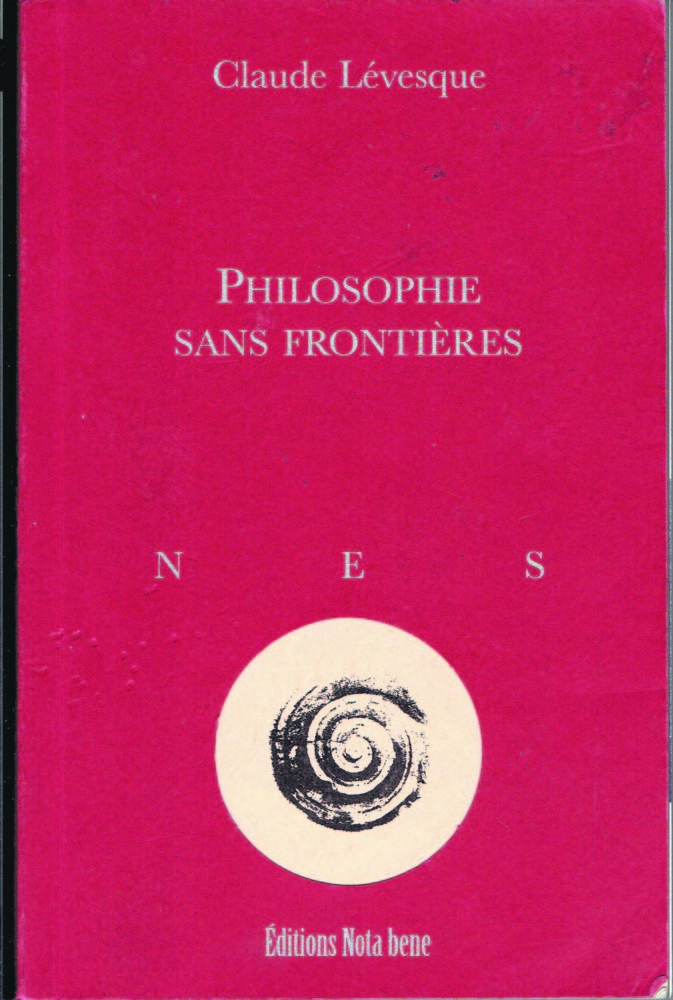
J’ai ressenti cette tendresse pour l’étrangeté, pour l’obscur qui défie le totalitaire. Ma plus grande complicité ressentie envers Lévesque provient probablement du chapitre « Ces livres où je lis ce qui me tue » tiré de Philosophie sans frontières. Ce chemin, voire cet Holzwege heideggérien, parsemé d’angoisse et d’exaltation à la rencontre de l’innommable et de l’inarticulable, m’a mené sur bien des sentiers dont le sceau ne pourrait être levé. Si, pour Lévesque, La part du feu de Maurice Blanchot a joué ce rôle de phare maudit, éclairant dangereusement l’obscurité, je ne suis, pour ma part, pas en reste avec le Faust de Fernando Pessoa. En dépit de ce que l’on pourrait croire à tort, des hautes cimes, la dernière consolation de Lévesque nous parvient comme ceci : « Tutoyer ainsi l’horreur et la mort, faire l’expérience du tragique, permet de puiser à même la source de vie jaillissante, à un point tel qu’on en vient, comme le croit Bataille, à aimer la mort. Est-ce possible ? Peut-être pas, mais c’est cet impossible qu’il faut aimer. »
« Désormais, c’est dans l’ombre et la nuit amicale, dans le froid qui dégrise, qu’il faudra traquer un nouveau soleil »
La tragédie s’achève par un grand rire.