Martine Béland est une professeure et chercheuse au cégep Édouard-Montpetit et titulaire d’un doctorat en philosophie de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris. Ses recherches portent sur le « jeune Nietzsche » et la réception de ses œuvres. Elle est directrice intérimaire du Centre canadien d’études allemandes et européennes (CCÉAE) et professeure associée au Département de littératures et de langues du monde de l’Université de Montréal.
Le Délit (LD) : Bonjour, professeure. Pouvez-vous vous présenter succinctement à nos lecteurs ? Quels sont vos maîtres à penser ?
Martine Béland (MB) : C’est une question en un certain sens assez évidente pour moi parce que je suis une spécialiste de Nietzsche. Il est donc pour moi un philosophe très important ; auteur — pas seulement philosophe — en raison du style et de la construction des livres. Je me suis beaucoup intéressée à ses techniques de production littéraire, aussi à la façon dont il écrit des préfaces, son utilisation des métaphores ; comme auteur en général. Sinon, des auteurs auxquels je reviens souvent sont plutôt des romanciers, des littéraires. En philosophie, à part Nietzsche, j’ai commencé par Heidegger.
LD : D’après vous, qu’est-ce la philosophie et devrait-elle être une discipline travaillée par tous ?
MB : La philosophie, c’est beaucoup de choses. C’est une discipline et ce mot, en soi, est intéressant puisqu’il a deux sens. Aujourd’hui nous pensons beaucoup à la discipline universitaire ou académique, c’est-à-dire un champ où l’on poursuit des études. Au Québec, qui plus est, la philosophie a la particularité d’être une discipline que l’on étudie assez jeune — on commence au cégep — et même pourrait-on peut-être la commencer encore plus jeune. Je suis d’ailleurs assez curieuse de ce que donneront les programmes de philosophie pour enfant ; des gens à l’Université Laval s’y intéressent. Peut-être alors, comme dans votre question, la philosophie pourrait être une discipline que l’on étudierait très jeune. J’enseigne au cégep et je suis souvent frappée de constater que, pour les étudiants, la philosophie est souvent quelque chose de nouveau. C’est un peu comme s’ils n’avaient jamais fait de mathématiques et qu’ils commençaient à dix-sept ans ! Peut-être pourrait-elle donc quelque chose de plus général. D’un autre côté, le mot discipline, c’est aussi une mise en pratique, des exercices ; s’astreindre à une certaine façon d’être, à une certaine façon de vivre. La philosophie a été une discipline en ce sens-là surtout durant l’Antiquité, mais je ne pense plus qu’elle le soit tellement aujourd’hui.

LD : Justement. Au sens de l’Antiquité, quelle est l’importance, pour vous, d’une vie philosophique ? Vivez-vous une existence s’y apparentant ?
MB : Non ! (rires) En fait, ce n’est pas un non, mais je ne veux pas porter un jugement de ce type sur moi. La barre serait trop haute. Je laisserai les autres en juger. De toute façon, au sens de l’Antiquité, il est sûr que la réponse soit négative. Nietzsche s’est d’ailleurs beaucoup intéressé à la manière dont la philosophie, dans les écoles hellénistiques, était une discipline de vie globale qui devait avoir des effets sur le choix alimentaire, sur la manière de socialiser, parfois même sur les rythmes de sommeil. Une manière très stricte de voir comment la vie quotidienne peut être régie. Il est certain que je ne vis pas une vie philosophique en ce genre-là. D’autre part, une vie philosophique est guidée, en quelque sorte, par le savoir… Je répondrai d’ailleurs en nietzschéenne en disant que c’est une vie qui vise à savoir non pas dans le but de savoir ! Un intérêt pour le « savoir » dans le but de comprendre pourquoi nous sommes tant intéressés par le « savoir ». Par exemple, pourquoi favorisons-nous le vrai plutôt que le faux ? Pourquoi le Bien plutôt que le Mal ? Des interrogations du genre guident une vie-philosophie de ce type. Une vie de l’esprit qui est animée par une curiosité, une recherche et une capacité à ne pas vouloir à tout prix avoir la réponse. Ne pas toujours vouloir avoir la connaissance. Pouvoir accepter la question qui demeure parfois sans réponse. En ce sens-là, pour moi, une vie-philosophie est une vie où l’on est sceptique.
LD : Quelles sont les difficultés propres à l’enseignement de la philosophie ? Pourquoi enseignez-vous au niveau collégial ? Même, vous demanderais-je, de quelle manière vos travaux sur Nietzsche ont-ils influencé votre enseignement ?
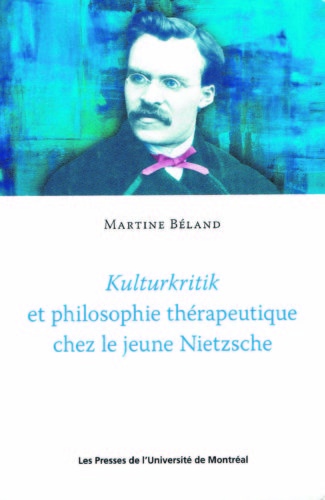
MD : Beaucoup de questions en une ! Vous me remettrez dans le droit chemin si je me perds en cours de route. Pourquoi enseigner au collégial ? Un hasard. Lorsque j’étais à ma thèse au doctorat, un ami m’a fortement encouragé à postuler au cégep, mais cela ne m’intéressait pas puisque j’écrivais ma thèse. Or, pour cet ami, enseigner au cégep était l’assurance d’avoir une profession. Il avait raison. J’ai postulé lorsque j’étais au doctorat — j’ai été engagée —, mais j’ai refusé les charges d’enseignement qui m’étaient offertes jusqu’à ce que j’aie défendu ma thèse. Au début de ma carrière, je n’ai jamais pensé que je deviendrais professeure au cégep. C’est une très belle profession, mais je ne m’étais jamais vraiment posé la question. J’espérais, éventuellement, avoir un pied dans l’université. Or, au fond, j’en ai toujours eu un en tant que chercheuse. Donc, ma carrière est bicéphale. Je suis, d’une part, professeure au cégep, mais aussi chercheuse au Centre canadien d’études allemandes et européennes (CCÉAE) dont je suis maintenant la directrice intérimaire.
Enseigner au cégep, c’est évidemment quelque chose de stimulant. C’est un beau défi que de devoir attirer des jeunes qui n’ont aucune idée de ce qu’est la philosophie. Je n’ai pas intérêt à ce qu’ils trouvent cela ennuyeux. J’ai réellement l’envie et le souhait de leur faire voir ce qu’il y a de fondamental et d’universel dans la pratique philosophique. Mon cours d’introduction vise à les accrocher à ce qu’est la philosophie. Voilà la difficulté principale répondant à votre question. Si l’on enseigne encore Platon, Épictète, Épicure — mon enseignement se concentre beaucoup sur le stoïcisme — c’est parce que leurs textes nous parlent encore, à travers les siècles.
LD : Vous me permettrez de vous redemander : de quelle manière vos travaux sur Nietzsche ont-ils influencé votre enseignement ?
MB : C’est une question difficile, en un sens, puisqu’elle demande que je me retire de ma pratique pour y déceler l’influence. Ce n’est pas si évident. En plus, cela fait si longtemps que je travaille sur Nietzsche. Il est donc difficile de me séparer de certaines méthodologies ou de certaines approches. Je vais tout de même essayer d’y répondre… Vous savez, j’ai travaillé le « jeune Nietzsche ». Il était alors philologue et s’intéressait beaucoup aux Grecs. Pour améliorer ma compréhension de ses idées et son rapport aux Grecs, j’ai beaucoup travaillé le stoïcisme. Enseigner une introduction à la philosophie m’y a d’ailleurs obligé d’autre part. Ou plutôt, ça m’en a donné l’occasion. Cela me permettait de compléter mon travail sur Nietzsche. En disant cela, je me rends bien compte que je ne réponds pas vraiment à votre question !
LD : Vous y répondez sans y répondre.
MB : Disons que je la détourne. Une influence qu’a eue Nietzsche sur mon enseignement serait probablement de ne pas croire aux idées. Former les étudiants à être peut-être davantage des sociologues des idées que des philosophes. C’est-à-dire, l’on s’intéresse au vrai, au Bien. Pourquoi ? Pourquoi juge-t-on cela si important ? Que signifie « important » ? Toujours l’interrogation par la valeur, dans la généalogie des concepts.
LD : Passons aux questions, disons, nietzschéennes ! Pouvez-vous nous parler de votre excellente analyse faite dans Kulturkritik et philosophie thérapeutique chez le jeune Nietzsche ?
MB : Ce livre est issu de ma thèse de doctorat. En thèse, je savais d’emblée vouloir travailler sur Nietzsche et je m’étais donné la tâche première de le lire complètement et chronologiquement. Cela inclut les carnets de notes associés à chacun de ses livres, la correspondance, les fragments posthumes, etc. Ce qui m’a alors frappé après cette lecture fut son projet de jeunesse. J’étais particulièrement intéressée par le fait que la critique culturelle formait un projet énorme et cohérent. Il avait le souhait de former une communauté, en parlait avec beaucoup d’amis, avec [Richard] Wagner. Or, tout cela semble avoir été laissé de côté et cela m’a apparu concomitant avec son retrait du monde universitaire.
Il est certain que Nietzsche n’est pas si original que cela en tant que critique culturel. Il l’est à une époque de critique culturelle, mais certaines de ces critiques lui sont propre et il va les développer par après. Je me suis intéressée aux formes de la critique culturelle — la dimension politique de la critique de l’État, sa critique de la musique, du journalisme, de l’éducation avec Schopenhauer et tel qu’on le voit dans la première Inactuelle (David Strauss, apôtre et écrivain ; 1873) et je me suis beaucoup intéressée — peut-être pas assez encore — à la critique du savant. La critique du type qu’est le savant, celui qui est formé par les instituts universitaires et académiques. J’ai cherché à cerner certains fronts de critique, certains fronts d’action, de la part de Nietzsche, dans son projet visant à rénover la civilisation et à comprendre, aussi, pourquoi il a laissé ce projet-là de côté.
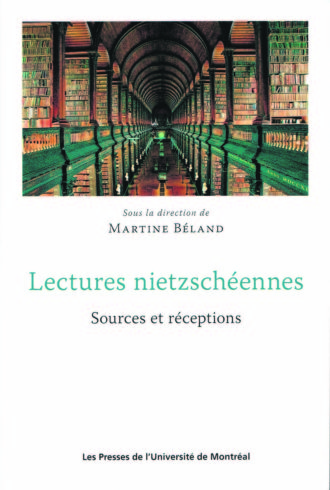
LD : Un lecteur d’Héraclite pourrait s’intéresser particulièrement à la question du polemos, à la pulsion agonale. Il s’agit d’un aspect, repris par Nietzsche, très présent dans votre livre. Cela m’amène à vous demander : quelle est l’importance de la « joute », cette pulsion politique [agonale] que Nietzsche associe à une certaine période de l’Antiquité grecque, pour notre époque ? Manquons-nous d’une éducation propre à cette pulsion ?
MB : Cela n’est plus très valorisé. L’idée de la notion d’agôn, la pulsion agonale et la notion de joute apparaissent dans les textes nietzschéens de jeunesse. Après cela, nous ne les voyons plus tant que cela. Agôn et joute, plus tellement. Par contre, ce que l’on retrouve beaucoup, c’est la notion de pulsion. Il est clair que cette notion est partout dans l’œuvre de Nietzsche et elle est particulièrement importante puisqu’elle nomme l’hypothèse globale que fait Nietzsche de ce que sont la vie et le réel comme dépassement ou [singularisation] par rapport à l’autre. Il y a cela dans la notion de pulsion, dans la notion d’âgon et dans la notion de joute. Nietzsche émet l’hypothèse que cette volonté de se distinguer, de se séparer, d’être au-dessus d’autres choses, est inhérente à la vie. Il est certain que nous n’avons pas une éducation à cela. Se distinguer des autres, être différent, comprendre une hiérarchie… ce ne sont pas des choses présentes dans notre éducation ou dans notre discours public, mais on peut consentir que cela se trouve partout au quotidien. Nous le voyons dans les milieux de travail, nous le voyons dans la rue, dans les concerts — cette volonté de se démarquer. Il est certain qu’à notre époque, nous ne voulons pas voir cela — nous critiquons même l’idée de hiérarchie —, mais elles sont néanmoins présentes. Qu’est-ce qui pourrait être une bonne éducation à cela ? Au moins, d’en prendre conscience ! C’était d’ailleurs l’un des objectifs de Nietzsche : attirer notre attention sur ce phénomène pour mieux le voir à l’œuvre.
LD : Vous mentionnez cette singularisation, cette idée qui prétend que l’on se crée en tout point différents des autres. Elle semble tout de même très présente à notre époque ! Or, tandis que, pour Nietzsche, les Grecs étaient « superficiels par profondeur », ne sommes-nous pas, aujourd’hui, profonds par superficialité ? C’est-à-dire… être différent pour être différent !
MB : Il est certain que de nos jours, l’on valorise beaucoup le fait d’être soi. J’ai vu une publicité hier, justement. Une publicité pour La Presse+. Il y avait une jeune fille et une citation censée lui appartenir. Le message disait sommairement : « C’est lorsque l’on arrête de se chercher que l’on parvient à être ce que l’on est. » J’ai lu cela en souriant. On voit bien que l’on valorise le fait d’être soi, d’être authentique, de s’exprimer librement et tout cela est très beau. C’est une situation découlant de la disparition des échelles de valeurs communes et imposées. On permet, donc, toutes sortes d’expressions et l’on valorise cela. Maintenant… y a‑t-il tant de différences entre chacune de ces personnes-là ? La personne que j’ai vue dans cette publicité m’a semblé être tellement ordinaire. C’est un constat, non une critique. J’aurais pu la voir dans l’un de mes cours ou encore dans le métro. Elle ne m’aurait jamais frappée comme étant une personne s’affirmant particulièrement dans son individualité. Qu’est-ce que cela veut dire d’être pleinement soi-même ? J’ai l’impression que l’on nous fait croire que d’être authentique va faire de nous quelqu’un de complètement différent des autres. En réalité, non. Puisque je suis professeure au cégep, je vois bien que c’est à cet âge-là que l’on peut développer cela, aussi. Je sais bien que plusieurs de mes étudiants, dans mes cours, pensent qu’ils sont tellement originaux et différents. S’ils savaient comme ils sont représentatifs d’un type ! L’important est de savoir de quel type nous sommes.
LD : Cela renvoie au « perspectivisme » de Nietzsche…
MB : Oui, bien sûr ! Lorsque j’enseignais Nietzsche, c’est d’ailleurs ce que je cherchais à enseigner. Le lien entre ce dont nous venons de parler et son « perspectivisme ». On le voit très bien dans Vérité et mensonge au sens extra-moral (1873). Nous ne pouvons pas, également, penser le perspectivisme sans l’hypothèse de la « volonté de puissance ». C’est à la fois la beauté et la difficulté de Nietzsche : ce n’est pas un philosophe au sens généralement accepté. On ne peut pas le traiter avec des tables des matières parfaitement compréhensibles ; on ne trouve pas un livre de Nietzsche où est effectivement développée l’idée de la « volonté de puissance » ou celle du « perspectivisme ». Il faut lire et relire et se montrer attentif à ce qui est écrit. Souvent, d’ailleurs, l’on me demande par quel livre de Nietzsche commencer. En fait, ma belle-mère m’a posé cette question-là hier ! On me la repose régulièrement. J’essaye de répondre à cette question-là en fonction de la personne. Pour quelqu’un qui est cultivé, une curiosité générale pour la culture occidentale et une ouverture à la littéralité du langage, je conseille de commencer par Le Gai savoir (1882) Pour un étudiant en philosophie, ce n’est peut-être pas non plus par celui-là que je le ferais commencer.
C’est à la fois la beauté et la difficulté de Nietzsche : ce n’est pas un philosophe au sens généralement accepté. On ne peut pas le traiter avec des tables des matières parfaitement compréhensibles
LD : Vous faites la dichotomie, chez Nietzsche, entre les ouvrages exotériques et ésotériques…
MB : Une question rarement abordée. C’est mon biais straussien ! J’ai été formé par un straussien.
LD : Je m’en allais justement vers là. Leo Strauss a écrit un livre expliquant, en quelque sorte, comment le lire. Chez Nietzsche, diriez-vous qu’il y a de cela ? Ou encore, un équilibre entre les œuvres exotériques et ésotériques ? Vérité et mensonge au sens extra-moral, par exemple, appartient à ce dernier groupe. C’est, par ailleurs, comme vous le mentionnez, un projet avorté tel qu’on le voit dans la correspondance entre Nietzsche et son ami le philologue Rohde. Ce dernier disait à Nietzsche qu’un tel livre ne trouverait pas son lecteur.
MB : C’est une bonne question. Au fond, je pense que si je me trouvais à réécrire mon livre, je ne suis pas certaine que je garderais cette distinction. Ce qui m’est devenu plus pertinent tient dans les stratégies éditoriales, les stratégies pour atteindre un public. Il est frappant de voir que la majorité des livres principaux de Nietzsche ont été publiés à compte d’auteur ; Par-delà bien et mal (1886) publié à compte d’auteur, c’est incroyable ! Il n’en a distribué que 200 copies dans les mois qui ont suivi sa publication. Elles n’ont pas toutes été vendues puisqu’il en a envoyé un large nombre à des amis et à des revues. Tout cela est donc peut-être plus intéressant si l’on veut comprendre la production de l’œuvre de Nietzsche ou encore toutes ses tactiques concomitantes pour trouver un lectorat. Il cherche à ce point un lectorat qu’il cherche à tout penser. La première de couverture, le carton du livre, était particulièrement importante. Il voulait que le lecteur comprenne que tel livre était la suite d’un autre. Il était important pour lui que ses lecteurs comprennent qu’il était en train de produire une œuvre complète. Le fait que La Généalogie de la morale (1887) soit une étude de cas de Par-delà bien et mal, le lectorat doit bien le comprendre. Aujourd’hui, on oublie cela.
Je bifurque, mais cette question m’intéresse. La Généalogie de la morale est souvent un texte par lequel l’on rentre dans l’œuvre de Nietzsche. Ce fut mon cas aussi. C’est un livre que j’ai lu en cours d’introduction à la philosophie à l’Université d’Ottawa. J’y suis rentrée sans que personne ne me dise « ce livre est une étude de cas » ou un terrain historique qui fait une application des idées globales développées dans Par-delà bien et mal. En plus, lorsque nous l’avons étudié [Par-delà bien et mal] au baccalauréat, nous ne lisions que le premier chapitre ! Je ne sais pas si vous avez en tête la table des matières du livre, mais dans ce chapitre se trouve une critique de la philosophie… On ne nous faisait pas lire le neuvième chapitre qui touche sur ce qui est noble ou encore les sections sur l’hypothèse de « volonté de puissance ». On ne lisait pas le travail philosophique réel de Nietzsche développé dans ces sections-là et nous l’avons étudié seulement en tant que critique — un peu étrange — avec lequel on ne sait pas trop quoi faire.
Bref, pour revenir à la dichotomie entre l’exotérique et l’ésotérique, au fond nous voyons qu’il y a beaucoup de textes que Nietzsche a effectivement laissés de côté, d’autres qu’il a publiés à compte d’auteur — il y a la quatrième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra (1883–85) qu’il ne prévoyait pas publier —, mais en même temps il y a tellement de stratégies de publicité et de diffusion énorme — qui furent plutôt un échec à l’époque — que c’est cela qui me semble plus important que la dichotomie : les stratégies pour se trouver un lectorat.
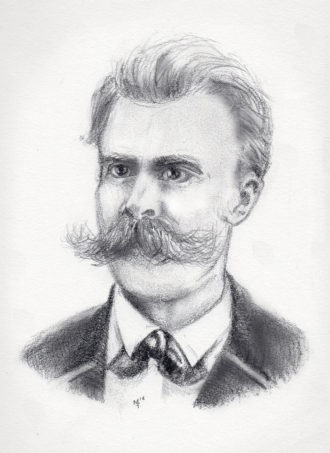
Je ne connais de plus haute fin à m’assigner que d’être un jour, de manière ou d’autre, un éducateur au sens le plus large du terme. Friedrich Nietzsche ; 1874
LD : Ne diriez-vous pas que c’est par dépit ou par faiblesse que Nietzsche en vient à oublier ce qui apparaît être un fondement chez lui — c’est-à-dire que la « vérité » est profondément meurtrière — et donc à publier, toujours en recherche d’un lectorat toutes considérations oubliées de ce qu’il put dire de la « vérité », selon des stratégies éditoriales qui laissent radicalement de côté ce qui put constituer tout le projet du « jeune Nietzsche » élaboré avec Erwin Rohde ?
MB : Je crois qu’il faut regarder la chose différemment. Nous avons affaire à un auteur qui publie 17 livres en 17 ans. C’est énorme. Nous pouvons donc regarder la chose d’un autre point de vue. Une chose qui m’a frappée — pour continuer dans les chiffres — c’est la quantité de préfaces que Nietzsche a écrites. Il a écrit bien plus de préfaces que de livres ; 25 préfaces, si je ne me trompe pas. Pourquoi autant ? À quoi sert la préface ? Elle sert à présenter une œuvre en s’adressant au lecteur. Il y a davantage de publications que de dépit ou d’abandon. C’est un homme qui passe son temps à écrire sans cesse. Nous voyons le volume que prennent les fragments posthumes. Il est certain qu’en écrivant sans cesse, il y a des projets qui sont mis de côté. Il me semble que si n’importe qui prenait vos carnets ou les miens, ils verraient la masse de projets que l’on ne traitera finalement pas. Il y aurait d’ailleurs un beau travail à faire sur les tables des matières de Nietzsche. Pour revenir à votre intervention, face à cette masse de travaux non terminés demeure la masse de travaux publiés. S’il publiait autant — et à la fin Nietzsche se pressait puisqu’en 1888, il voulait absolument rejoindre le plus de gens possible — ce n’est pas sans une bonne connaissance des tribunes qu’il y avait, à l’époque, en Europe. Il lisai plusieurs revues — des revues françaises et britanniques — et était très au fait de ce qui se passait dans l’Europe intellectuelle de son époque. Donc, il voyait très bien que pour rejoindre des lecteurs, il faut bien que les livres circulent ! Il envoie plusieurs des siens pour qu’il y ait, au moins, des recensements. Je me suis intéressée aussi à la perception de Nietzsche quant à la réception de son œuvre et il était déçu qu’elle soit si minime. Il se souciait que ses idées aient une tribune et il se doutait bien que cela pourrait prendre du temps. Finalement, cela n’en a pas pris autant.
LD : Quel est votre rapport au constat nietzschéen d’une civilisation malade ? Que pensez-vous de son diagnostic ?
MB : Pour Nietzsche, une civilisation, une Kultur en allemand, c’est un certain équilibre des pulsions, une certaine échelle de valeurs, une certaine définition de ce qu’est l’humain, de ce qui est souhaitable et de ce à quoi nous devons être formés. Qu’est-ce qui peut faire qu’une civilisation soit malade ou déclinante ? Dans ses œuvres — je pense encore une fois à Par-delà bien et mal —, nous voyons que Nietzsche utilise beaucoup la métaphore de la jungle et de la luxuriance pour décrire ce qu’est la vie à son meilleur, pour décrire ce qui est la tendance naturelle de la vie, c’est-à-dire la tendance à une diversification de ses formes et à une augmentation des échelles de différenciation, des hiérarchies. Une civilisation peut être déclinante, une Kultur peut être malade, lorsqu’elle devient « égalisante » plutôt que d’être hiérarchique. C’est le moment où elle encourage et valorise un type de vie, un mode de vie, une organisation des pulsions, plutôt que de favoriser une variété des pulsions. Donc, lorsque Nietzsche écrit que la civilisation est déclinante, c’est notamment en raison de cette uniformisation. Aussi, le déclin peut surgir d’une civilisation se mentant sur ce qu’elle est en réalité. Nietzsche critique d’ailleurs beaucoup cela dans ses œuvres de jeunesse, comme par exemple dans L’État chez les Grecs (1872), où il défend l’idée que la civilisation moderne se ment sur la valorisation qu’elle se fait du travail. Elle se ment aussi sur l’esclavage. Tout cela, nous pouvons le voir encore de nos jours. C’est-à-dire, si nous avons autant de patentes ou de bébelles autour de nous, c’est bien parce que d’autres les font. Nous avons expulsé de notre environnement immédiat toute la production du matériel et toutes les mauvaises conditions de vie qui vont avec. Une civilisation qui se ment quant à ses conditions de vie est une civilisation qui est malade.
Une civilisation peut être déclinante, une Kultur peut être malade, lorsqu’elle devient « égalisante » plutôt que d’être hiérarchique. C’est le moment où elle encourage et valorise un type de vie, un mode de vie, une organisation des pulsions, plutôt que de favoriser une variété des pulsions.
LD : Que faites-vous de ce constat ?
MB : Il me semble que son constat est tout à fait utile pour nous aujourd’hui, afin de nous amener à comprendre ce qu’est une Kultur, une civilisation. Si nous reprenons la métaphore de la jungle, elle est très convaincante par son pouvoir illustrateur. Son pouvoir vient qu’elle évalue quelque chose de réel et que nous avons une certaine difficulté à nommer. Peut-être, même, la valorise-t-on sans le savoir ! Par exemple, lorsque, de notre point de vue nord-américain, nous jetons un regard sur une société uniforme et sans liberté d’expression, où l’on doit répéter des dictats de l’État et où nous jugeons bien que ce qui est nivelant limite les capacités créatrices de l’être humain.
Il est clair qu’il y a, chez Nietzsche, un individualisme très fort. Nous le voyons très bien au début de la troisième Inactuelle (Schopenhauer éducateur ; 1874) — qui est un texte que j’adore et que j’enseigne volontiers. Dans cette troisième Inactuelle, nous voyons bien l’individualisme nietzschéen qui en appelle à chaque individu à laisser pleine voix à l’être que nous sommes. Je pense que oui, en ce sens-là, le regard critique de Nietzsche sur les dimensions « égalisantes » de la civilisation sont utiles. Qu’est-ce que l’authenticité ? Est-ce possible ? Pouvons-nous nous réaliser nous-mêmes sans même un modèle préalable ? Cela semble difficile à imaginer.

En ce qui concerne les conséquences, je regarde désormais ma main avec quelque méfiance, car j’ai l’impression que j’ai le destin de l’humanité dans ma main. Friedrich Nietzsche ; 1888
LD : À la toute dernière page de votre livre, vous citez le paragraphe 280 du Gai savoir dans lequel Nietzsche fait mention de la rareté des lieux philosophiques, ces lieux dans nos grandes villes qui, comme vous le dites, « sa[vent] montrer que la philosophie est un “faire” de la pensée, une action personnelle et, ainsi, une réflexion constamment à reprendre ». À votre avis, de tels lieux auraient-ils les effets escomptés ?
MB : C’est un bel extrait ce paragraphe 280. En lisant cela, je me demandais « où sont ces lieux-là » ? D’ailleurs, en ce moment, nous sommes à l’UQAM, dans une espèce d’agora — où il y a beaucoup trop d’écho d’ailleurs. Est-ce un tel lieu ? Sincèrement, je ne pense pas. Ce ne serait pas une agora universitaire, même si l’UQAM en a fait plusieurs contrairement à l’Université de Montréal qui veut tout sauf des rassemblements étudiants. Bon, des jardins ; nous habitons un endroit où il neige cinq mois par année, alors ce n’est pas évident ! Par ailleurs, dans les jardins, de nos jours, nous y pratiquons surtout la distraction. Aussi, pensez à tous les festivals que l’on nous sert à Montréal. Pouvons-nous vraiment, en tant que citoyens, prendre possession de ces lieux publics alors qu’ils sont sans cesse réquisitionnés pour toutes sortes de célébrations purement mercantiles ? Où sont ces lieux ? Des lieux de méditation. Or, si l’on ne pratique plus la méditation ou la réflexion, si l’on n’encourage plus cela… il est certain que nous ne construirons plus de lieux qui vont avec cette manière d’être. Ce que l’on encourage, c’est la performance, le succès, la réussite rapide, le changement, le précariat. À force d’encourager tout cela, à force d’encourager les gens à organiser leur semaine de manière à ce qu’ils soient constamment actifs, nous faisons fit de l’arrêt. Nous n’encourageons pas l’idleness. Être à l’arrêt, réfléchir… les gens en sont de moins en moins capables ! Peut-être que des lieux philosophiques seront de moins en moins présents. Vraiment, je ne sais pas ce que serait ce genre de lieu, à l’heure actuelle.
LD : Au niveau privé, il y a le Camellia Sinensis !
MB : Oui ! Il n’y a pas le réseau WiFi et l’on ne peut pas parler au téléphone. Cette maison de thé a le mérite d’être aussi assez minuscule. Ils sont plutôt à contre-courant. Par contre, ce n’est pas un grand lieu public… Vous voyez, j’arrive d’un beau lieu : le fleuve Saint-Laurent. J’y suis allée, en voyage, au large de la Côte-Nord. Ça, c’est un lieu de méditation : le fleuve. Peut-être, est-ce aussi plus largement la nature… Il est certain que des parcs, nous en avons, mais les gens y sont affairés. Ils ne sont pas à l’arrêt. L’arrêt ne rapporte rien, économiquement. Il faut d’ailleurs se poser la question : est-ce que l’on recherche des lieux de méditation ? Honnêtement, je connais très peu de gens pour qui c’est le cas. Je lis le Globe and Mail et je suis fascinée par le fait que, dans ce journal, il y ait systématiquement des articles écrits par des journalistes racontant des histoires où ils laissent leur téléphone de côté durant toute une semaine… Les gens ont énormément de réticence à ne rien faire et à être seuls. Énormément. Il est certain que ces préférences se traduisent à grande échelle dans une certaine architecture urbaine ou dans certains projets sociaux. Je le vois même à petite échelle au cégep. Nous laissons peu d’espace pour que les étudiants puissent s’intéresser à ne rien faire. Nous pouvons apprendre beaucoup en ne faisant rien. C’est même le cas dans nos bibliothèques. À l’Université d’Ottawa, ils y ont mis un café ! Cela traduit que les lieux de méditation ne sont plus ce que nous valorisons. Les lieux de méditation comme les églises sont issus d’une culture très ancienne — qui n’est plus tellement la nôtre finalement — dans laquelle l’on favorisait l’homme non affairé qui pouvait réfléchir. Aujourd’hui, nous cherchons à former des agents économiques allant le plus tôt possible sur le marché du travail afin d’être les plus rentables possible. Là, je vais citer la troisième Inactuelle pour dire « afin qu’ils aient le moins possible de temps pour penser » !
LD : Nietzsche disait de la philologie qu’elle est une science qui peut nous aider à éternellement comprendre le présent à l’aide de l’Antiquité. Bien davantage que l’enseignement des classiques ou leur interprétation, la philologie est une méthode d’apprentissage, un rythme à adopter. Qu’est-ce la philologie et sommes-nous en manque de ce que la philologie peut apporter ?
MB : La philologie est l’art de bien lire. Nietzsche était lui-même philologue. C’est une pratique qui nous amène à être sans cesse attentifs au texte qui est devant nous et aux couches d’interprétations à travers lesquelles, souvent, le texte nous parvient. Le philologue est conscient de son travail interprétatif. Il est conscient, aussi, du passage du temps. Ce serait la dimension historique. Il y a, à la fois, la langue ancienne et tout le travail d’interprétation que l’on doit faire, mais aussi l’inscription historique de ces textes-là. Il peut être difficile de détacher un texte ancien de son inscription historique, mais en même temps si cette inscription n’est plus la nôtre, comment pouvons-nous avoir réellement accès au texte ? C’est une question particulièrement intéressante pour vous si vous portez un intérêt aux présocratiques. Nous avons des fragments de texte de ces derniers — assez peu — et nous devons souvent nous fier aveuglément aux traducteurs ! Nous superposons nos regards interprétatifs sur le texte. Alors, le philologue est obligé de demeurer modeste. Il est obligé de se rappeler toutes les époques par lesquelles nous devons passer pour pouvoir comprendre ce qui est devant nous. Là où nous manquons certainement de philologie, c’est probablement dans notre manque de rigueur lorsqu’arrive le temps d’apprendre à lire. Nous sommes là, en tant que professeurs, pour attirer l’attention des étudiants sur ce qu’est un livre et ce qu’est un mot. Nous sommes là pour affiner la pratique de la lecture.

LD : Nietzsche disait du philosophe, dans La Naissance de la tragédie (1872), qu’il était ce médiateur entre l’art et la science ; comment le philosophe organise-t-il cette tension et qu’est-ce à dire plus précisément dans la philosophie nietzschéenne ?
MB : Nietzsche veut montrer — ce qu’il fit dans plusieurs livres — que même la science est une entreprise esthétique. La science est une entreprise interprétative qui transmet et construit un sens et des représentations là où il y a une masse de faits bruts auxquels nous n’avons pas accès autrement qu’en y superposant des représentations. Nous voyons bien cela chez Heidegger, aussi, par exemple dans un texte tel que « L’époque des conceptions du monde » (Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege) ; 1949) qui date de 1938. C’est un texte qui est très nietzschéen dans son amorce sur le fait qu’il y a des grilles que nous plaquons sur le réel nous menant à le comprendre le réel à partir de ce qui rentre dans nos catégories. Cela renvoie beaucoup à ce que Nietzsche écrivit dans Vérité et mensonge au sens extra-moral à travers la métaphore du buisson, c’est-à-dire la science qui cache les choses derrière un buisson et, regardant dans le buisson, s’exclame « le phénomène est là » ! Si le philosophe a à être le pont entre l’art et la science, c’est bien qu’il est de son rôle de nous rappeler les limites de la science, les possibilités de ce que peut être la science et les limites de nos catégories artificielles.
LD : Pour conclure, outre votre excellente analyse, par quel livre celui ou celle voulant s’introduire à la pensée de Nietzsche devrait-il commencer ?
MB : J’en ai parlé tout à l’heure. Cela dépend de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, du contexte dans lequel nous sommes. Pour des étudiants au baccalauréat qui ne seraient pas en philosophie, la troisième Inactuelle, pour l’appel à l’individualité et à devenir ce que nous sommes. La Généalogie de la morale est aussi une bonne amorce — c’est très accrocheur —, mais il ne faut pas oublier que c’est une mise en pratique de ce qui est développé dans Par-delà bien et mal. Il me semble d’ailleurs que si l’on étudie en philosophie, il faut lire Par-delà bien et mal. C’est capital et extrêmement important. Étonnamment pour moi qui me suis spécialisée dans le « jeune Nietzsche » dans mes études doctorales, en ce qui concerne La Naissance de la tragédie, je m’en détourne de plus en plus. C’est un texte que j’ai beaucoup aimé et travaillé, mais il me semble aujourd’hui un peu moins intéressant. Demeure toute l’analyse de la musique — toute la philosophie de la musique qui s’en dégage. Cela m’apparaît particulièrement intéressant. Peut-être pour des gens en art cela serait un beau livre. Sinon, pour des gens en général qui me posent cette question, Le Gai savoir ! Surtout pas Ainsi parlait Zarathoustra ! (rires)



