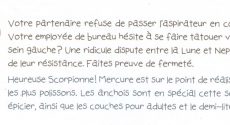Corps célestes est une pièce amenant à la vie les personnages de Lily (Julie Le Breton), sa mère Anita (Louise Laprade), sa sœur Florence (Evelyne Rompré), le mari de sa sœur James (Brett Donahue) et son neveu Isaac (Gabriel Favreau). Lily – réalisatrice de pornographie – retourne auprès de sa famille pour s’occuper de sa mère malade. Le Délit rencontre l’auteur de la pièce, Dany Boudreault.
Le Délit (LD) : Corps célestes joue en ce moment au Théâtre d’Aujourd’hui. C’était une écriture assez longue, ou en tout cas le processus d’écriture a démarré il y a un bon moment. Comment te sens-tu ?
Dany Boudreault (DB) : Ça a commencé en 2016. C’est un grand sentiment d’accomplissement. On écrit, mais c’est une pièce, il y a toujours une grande volonté de communication. Du théâtre qui se lit, ça existe comme objet littéraire, on lit du Koltès. Mais je n’écris pas pour être lu par des lecteurs individuels. Je voulais voir ce que c’était l’expérience avec un public avec ce texte-là en particulier.
LD : Tu ne joues pas dans la pièce, tu ne mets pas en scène. Peux-tu me parler du processus de création ?
DB : Je suis fondamentalement un auteur autant que je suis un acteur, donc c’est vraiment 50/50. Je fais les deux avec beaucoup de rigueur. J’ai déjà mis en scène des textes que j’ai écrit et je n’avais pas envie de le faire cette fois-ci. J’avais l’impression qu’il fallait que j’enrichisse un peu le dialogue avec quelqu’un. C’est un sport d’équipe, le théâtre. Je voulais aussi enrichir le dialogue avec une femme. J’aborde quand même le désir féminin, frontalement et viscéralement, de ce que j’en connais, ou par empathie, ou ce que j’en ai observé. Pour diriger les actrices et les acteurs, je pense que c’est important que ça passe par un véhicule un peu plus féminin.
Il y a cependant un grand sentiment de dépossession. J’endosse tout, mais il y a des choses que je n’aurais pas faites comme ça. J’ai eu des questions, des commentaires, réflexions, mais je n’en faisais pas, ou alors seulement quand c’était propice. Je suis allé voir les répétitions, mais je n’étais pas non plus suffocant, écrasant, omniprésent, parce qu’il n’y a rien de pire qu’un auteur qui est toujours là. Je parle surtout pour la metteuse en scène Édith Patenaude, je voulais la laisser s’approprier le texte, le profaner. C’est important aussi, profaner, ce n’est pas sacré [un texte].
LD : À propos de la pièce, tu affirmes « je crois en la puissance de la sexualité. Mais ma connaissance en est si réduite. Il s’agit d’une langue étrangère ». Après l’écriture de ce texte, ton approche a‑t-elle changé ?
DB : Ça m’a fait me documenter beaucoup. Ça m’a fait lire. Je l’ai écrit dans une période où je croyais que l’amour était devenu un peu interdit. Et en fait, j’ai vu la vastitude de ce que j’ignorais quand j’ai recherché. J’ai plongé dans les tenants et les aboutissants de ce qu’était la libération sexuelle des années 70, les grandes aspirations fondamentales politiques de la libération sexuelle et de l’appropriation d’une certaine intimité, l’évacuation du religieux. Certaines personnes voulaient même atteindre Dieu à travers ça. Je suis allé au Moyen Âge, chercher chez les sorcières… Bref, il n’y a pas de limites. En fait, j’ai constaté mes propres limites. Je crois qu’en ce moment, dans ma vie, il y a quelque chose que je vis de façon beaucoup plus détendue. Ce texte-là vient clore aussi. C’est comme une façon de devenir adulte. Isaac meurt dans la pièce, mais pour moi, c’est comme une part de moi qui meurt aussi, une espèce d’adolescence exacerbée, d’appétit qui se calme. Je suis plus apaisé, beaucoup plus transparent et beaucoup plus en mesure de nommer des manques que j’ai, de vivre avec, de me contenter aussi.
LD : La pornographie, c’est une approche de la sexualité qui est particulière. Pourquoi un tel choix ?
DB : Pour moi, ça pose un problème moral évident. On est au théâtre, on crée des conflits, ça impose une réflexion sur la représentation du corps sur scène. La pornographie pose la question de la représentation du corps, de l’accouplement, de la sexualité. Le but de la pornographie, même si plusieurs réalisateur·rice·s se réclament maintenant d’en faire même une forme presque artistique, ça reste quand même un outil de stimulation, lié à la consommation. En même temps, la pornographie existe depuis toujours, elle existe depuis les grottes de Lascaux. On a toujours cherché à représenter comment un homme, une femme, peu importe, s’accouplaient, se reproduisaient et comment aussi, reproduire certaines positions de plaisir. Maintenant, on est dans une conjoncture économique où elle a été complètement récupérée, absorbée par le capitalisme. Donc l’entreprise privée, maintenant, contrôle nos pulsions et les génère.
Moi-même, et je pense que tout le monde, en consomme plus ou moins de façon erratique. Où est-ce qu’on apprend maintenant à avoir un contact sexuel ? C’est beaucoup à travers la pornographie. Mais je ne voulais pas jeter de jugement moral là-dessus. On le sait, c’est dangereux. On entend toujours les mêmes discours : la pornographie, c’est mal. Évidemment le trop de pornographie, c’est mal. Je pense que la société fait la pornographie aussi. Quand on utilise les instruments pornographiques à des fins de consommation et quand le corps est complètement absent, ça, c’est dangereux. C’est pour ça que le personnage de Lily essaie de le faire autrement. C’est aussi une façon de prendre le pouvoir. Je me suis beaucoup informé autour de Ovidie, Erika Lust, qui sont des réalisatrices féministes pro-sexe. Il y a toujours un problème avec la famille et l’amour. En même temps, on pourrait changer le mot pornographie par n’importe quel statut incompatible avec le statut de la famille. C’est quelqu’un qui revient chez soi, l’enfant prodigue et qui ne fit pas. J’ai personnellement quitté à 17 ans, mais quand je vais au Lac-Saint-Jean, que je réalise de la porno ou que je sois acteur, je suis un extraterrestre !
On est au théâtre, on crée des conflits, ça impose une réflexion sur la représentation du corps sur scène. La pornographie pose la question de la représentation du corps, de l’accouplement, de la sexualité.
LD : Les thèmes de la sexualité, de la famille, ce sont des choses qui sont rarement abordées ensemble où alors dans un schéma qui est souvent le même, entouré de tabous, etc., alors que la famille est l’un des principaux vecteurs du développement, de la compréhension de la sexualité. Était-ce quelque chose que tu voulais aborder ?
DB : C’est central. Qui nous apprend comment ça se passe ? On ne s’en parle pas. On reproduit toujours les mêmes gestes, dedans-dehors, pénétré-pénétrant. Il n’y a plus de transmission d’un savoir sexuel. Encore là, l’entreprise privée nous fait croire que l’intimité est une chose privée, alors que c’est un mouvement, un mouvement vers quelqu’un d’autre. On peut parler de la honte aussi. Au Québec, on s’est vraiment débarrassé du clergé soi-disant, mais on demeure assez envahi par ce fantôme judéo-chrétien assez puissant, qui nous lie et qui nous fait suffoquer, dans nos gestes, dans nos réflexes. Il y a comme une chape de plomb judéo-chrétienne qui est assez chiante. Je pense que ça se répercute beaucoup dans notre rapport puritain [à la sexualité], même si on est plus libéré·e·s, soi-disant, que le reste du Canada, que les Anglo-saxons. Non, on est pris avec ces schémas et ça commence dans la famille.

LD : Tu parles de guerre, ce qui semble un peu en périphérie du reste de l’histoire. Pourquoi parler de ce sujet-là dans cette pièce ?
DB : La guerre n’est pas prise au sens strict, mais comme un envahissement de la pièce. C’est une espèce de lente invasion des désirs des personnages. Ils vont se laisser envahir par quelque chose de beaucoup plus viscéral. Et la guerre pour moi, c’est tout ce qui est invisible, ce qui est relié à tout ce qui est génital et capitaliste. Il y a un sens de la menace aussi je dirais quand même, parce qu’il y a de façon assez tangible, un conflit au nord du Canada imminent, avec la fonte des glaciers. J’essaie de ne pas sombrer non plus dans l’anecdote de la guerre parce que je trouve ça plus ou moins intéressant. Ce qui est intéressant, c’est que les ressources diminuent, le rationnement, le rapport à l’électricité, l’eau, les vêtements. Et puis j’ai l’impression que ça dramatise le repli de la famille. Il y a quelque chose de très proche de Tchekhov aussi, où les gens errent dans la maison sans occupation. Je trouvais que cet état d’attente d’un conflit qui n’éclate pas, alors qu’on sait qu’il va éclater, créait un rapport entre les corps, crée la proximité des corps. Et il n’éclate qu’à la fin. On va devoir vivre autrement tout notre vivre ensemble. Le rapport de proximité entre les gens va être appelé à changer éventuellement. On va devoir partager nos richesses. On ne peut pas vivre avec la tête dans le sable.
LD : Pourquoi la présence de l’anglais dans la pièce ?
DB : Je voulais un peu dépolitiser le rapport à l’anglais. À chaque fois, on en fait toujours un rapport politique comme Québécois, en dramaturgie québécoise, quand il y a un personnage qui parle anglais. Je voulais traiter de l’anglais qui n’est pas ma langue, mais en même temps, je l’écris, je parle assez bien. Je trouve que, dans la langue anglaise, en tous cas la langue de James, il y a un rapport à l’échec qui, moi, m’intéresse. Je travaille beaucoup sur l’interruption dans la langue, dans la réplique. La pensée est souvent cassée et je trouvais que ça créait une friction presque poétique. Quand il se trompe d’auxiliaire, par exemple quand il dit « j’appartiens rien », « I own nothing ». Et puis, on dit qu’il est arrivé avec le chemin, c’est un ranger qui est arrivé avec l’asphalte. À la fin, il perd le fil. Dans le livre — on l’a coupé —, il retourne dans la forêt. Une espèce de passage, c’est comme l’étranger, le survenant qui est un grand thème dans la dramaturgie, la littérature québécoise : quelqu’un qui débarque et dont tout le monde doit s’occuper. Ce n’est pas sa maison, c’est la maison d’Anita, il le dit quelquefois : « she’s the boss ». Il a fait le patio, il essaie de faire en sorte que ça devienne son lieu. Je trouve que c’est un peu la situation des étrangers au Québec, qui essaient d’appartenir. Mais on reste quand même un peuple hermétique, je trouve, très imperméable.