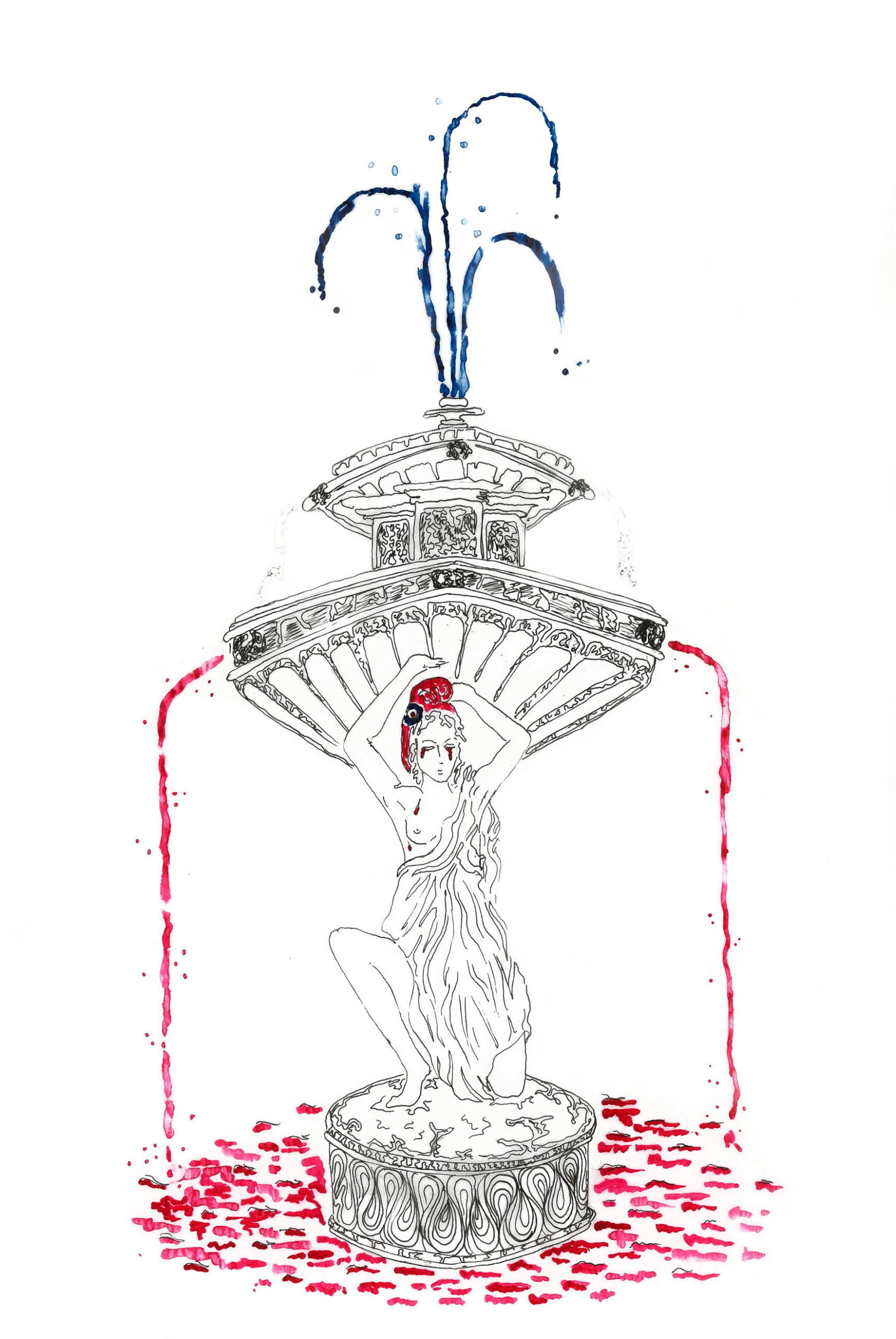À l’occasion d’un certain anniversaire, que l’on ne commémore d’ailleurs plus avec beaucoup d’entrain, se présente l’opportunité de reconsidérer l’histoire de la Révolution française, dont la mémoire officielle, réduite à ce dernier degré de commémoration qu’est la parade militaire, n’ouvre guère le champ à la réflexion.
Si la tâche rebute, c’est qu’il y a une triple complexité à confronter quand l’on aborde la Révolution. Il y a tout d’abord la complexité historique, intrinsèque aux évènements. Ensuite vient la problématique du mythe national et de la mémoire, que nous ne pouvons confondre avec la vérité historique. La dernière complexité vient du fait qu’il s’agit d’une histoire qui reste encore à écrire. Selon le mot célèbre de Zhou Enlai, en réponse à André Malraux qui s’interrogeait sur la manière qu’avait le ministre chinois de comprendre les conséquences de la Révolution française, celui-ci aurait répondu que c’est « encore trop tôt pour comprendre ». Voilà quelques pistes, si ce n’est pour la comprendre, pour penser la Révolution.
Une révolution bourgeoise
Pour la comprendre, il ne serait pas inutile de reprendre la lecture d’une « révolution bourgeoise ». En effet, la Révolution commence avec les bourgeois, et s’affiche, à ses débuts, comme telle ; le lexique et les symboles, la grammaire même de la Révolution, s’y rattachent, telle la cocarde bourgeoise et la garde bourgeoise qui se rebaptisent au cours de l’action cocarde tricolore et garde nationale, comme si ces mots étaient trop « nus », comme le dira l’historien Henri Guillemin. Lecture d’autant plus éclairante et intéressante qu’elle domine l’historiographie contemporaine, tout en étant, paradoxalement, tout à fait absente de la mémoire officielle et de la commémoration. Enfin, suivant notre troisième délimitation, la Révolution française s’aborde au travers de cette lecture de manière particulièrement pertinente, car nous donnant certains outils pour comprendre les origines de l’organisation économique et sociale qui domine l’ère moderne.
Dès la convocation des États généraux, au début de 1789, la France entre dans une période de réforme, qui, bien que provenant d’un appel volontaire du roi, amorce la transformation radicale des institutions. On parle, en effet, de capitulation et de vacance du pouvoir royal. Pour répondre à une crise financière certes, aggravée par l’engagement de la France dans la guerre d’Indépendance des États-Unis d’un côté, et par l’opulence de la cour de l’autre, mais surtout parce qu’une nouvelle force s’est formée au cours du 18e siècle qui souhaiterait se rendre commensurable politiquement. C’est la bourgeoisie, classe urbaine (le terme venant des bourgs) spécialisé dans l’échange et le commerce à grande échelle, de plus en plus mondialisé, qui s’enhardit en laissant libre cours à la circulation des biens et des capitaux. L’avocat Antoine Barnave, qui aura son importance lors de la Révolution, déclare, comme pour justifier ce qu’exige cette classe alors en plein essor : « une nouvelle distribution des richesses appelle une nouvelle distribution du pouvoir. » C’est que la bourgeoisie, qui possède la richesse mobilière, laquelle est différente de la richesse immobilière dont la noblesse est garante par une prérogative ancestrale, considère désormais les privilèges de ces derniers arbitraires, et veulent voir leurs intérêts représentés politiquement. Que leur domination économique réelle, en d’autres termes, se transforme en domination politique.
Il n’est pas question du peuple, que l’on écarte par bienséance. Le nouveau gouvernement, malgré sa Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), a rendu certains hommes plus égaux que d’autres. Sieyès conçoit la distinction à l’été 1790 entre citoyens actifs, aisés et propriétaires, et citoyens passifs, pauvres et sans pouvoir de représentation. C’est sans parler de l’exclusion des femmes et des esclaves, que le lobby esclavagiste et colonial, « puissant à l’Assemblée », (Guillemin, 1989) assimile au dogme de la propriété, que l’on nomme désormais – voyez le dernier article de la Déclaration – « inviolable et sacrée » !
L’œuvre des actifs révèle une politique de classe qui permet aux bourgeois de bénéficier de cet avantage pour faire une politique à intérêts particuliers. Citons quelques réformes. Le nouveau calendrier supprime le dimanche, le remplaçant par un décadaire, un jour de repos tous les dix jours, donc. Inutile de dire que ce sont les bourgeois qui considèrent que les pauvres ne travaillent pas assez. Plus grave encore, mais dans la même veine, la loi Le Chapelier, interdit les groupements professionnels de faire la grève ou de former des syndicats. La Révolution, sous cet aspect-là, c’est tout simplement un nouvel asservissement du peuple ; Révolution, au sens de retour du même.
La crainte des possédants
Toute la complexité, c’est reconnaître que le peuple, dans les faits, n’a pas été passif ; limite à la révolution bourgeoise et à sa lecture. Il faut, en effet, pallier avec cette grande masse politisée, qui excède dans ses revendications les ambitions d’une simple réforme bourgeoise. C’est aussi, dans une certaine mesure, le revers des discours du tiers état, où « contraints à professer l’idée générale de l’égalité pour combattre l’idée particulière d’inégalité qu’on lui opposait », (François Furet, 1978), celle de la société d’ordres, les députés bourgeois du tiers état font semblant d’étendre au peuple la Révolution. Le peuple a le malheur d’y croire. On pense notamment à la fusillade du Champ-de-Mars. Le 17 juillet 1791, le peuple de Paris, hommes, femmes et enfants, se rassemblent pour déposer une pétition pour la démocratie réelle ; ils se feront massacrer par la garde nationale.
La distinction qui s’applique entre citoyens passifs et citoyens actifs se retrouve dans la condition d’enrôlement de la garde nationale, qui joue un si grand rôle dans la Révolution. En théorie, tous pouvaient rejoindre ce que l’on appelait encore la garde bourgeoise à la veille du 14 juillet 1789. Mais il faut se payer soi-même les habits et les armes (quatre-vingts livres), somme considérable et inaccessible à l’ouvrier ou à l’artisan. Constitué autour d’un certain Lafayette, la garde bourgeoise est une milice ayant pour but de protéger la propriété (sacrée!) par méfiance envers le peuple et pour défier, ou contrarier, s’il le faut, l’hésitation du roi qui se retranche dans la réaction. Celle-ci se manifeste par le renvoi du ministre des Finances Necker par Louis XVI, un banquier plutôt favorable à la réforme bourgeoise et qui l’aurait entamée au sommet de l’État. Grand grondement de la part des bourgeois ; il faut donc, cette fois-ci, marquer le coup et s’attaquer au symbole qui se rattache alors le plus intimement à ce que la personne du roi et son pouvoir a d’arbitraire : la prison de la Bastille. Mais ce n’est pas la milice bourgeoise, constituée des gens respectables de Paris qui fait le coup, mais le peuple, à qui on a distribué des armes, faisant office de bélier. « Pour faire une Révolution, il faut le peuple », dira Victor Hugo. Pourtant, dès le fait accompli, les armes sont rapidement récupérées par la municipalité craintive, au moyen d’un dispositif qui fait mouche chez une population crevant de faim : c’est quarante sols (soit deux jours de travail) pour quiconque a en sa possession une arme ; « les fusils rentrent en foule » (Guillemin, 1989).
Mythe et héritage de la Révolution
« Ainsi vous voulez diviser la nation en deux classes dont l’une ne sera armée que pour contenir l’autre » exclame Robespierre (Discours 1791, sur l’Organisation des Gardes nationales). Voici une autre citation de cet homme, pleine de lucidité et trop peu connue pour ne pas être recopiée : « La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l’indigence à ce suprême degré d’abaissement où l’Homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donné. » (Déclaration de candidature aux États généraux, 1788) Révolution, retour du même ; au sens où ce qu’elle propose est toujours d’actualité. Certains hommes et femmes ont véritablement tenté par la Révolution de remédier aux maux qui frappent la société. Il y a là tout un héritage. Robespierre a d’ailleurs rencontré Rousseau ; il ne s’en est jamais remis. Et nous non plus n’en sommes pas sortis, car nous continuons de nous préoccuper de philosophie pour comparer la réalité de la Révolution à ce qu’elle aurait pu être, dans sa forme plus radicale. En effet, se pose la question de savoir quelle autre légitimité a la Révolution, si ce n’est d’aborder, comme l’a dit Robespierre en bon disciple de Rousseau, « les causes de la misère » en société.
Au 19e siècle, on conçoit encore la Révolution comme un « drame qui ne cesse de se rejouer » (François Furet, 1978) ; en France, 1830, 1848 et la Commune de 1870 ne se produisent pas sans référence à 1789. Et le pouvoir considère alors la Révolution comme une catastrophe : l’on interdit de chanter la Marseillaise et de célébrer le 14 juillet. Pourtant, dès lors que la République a consacré la Révolution comme étant son mythe national, en faisant notamment du 14 juillet sa fête, s’est estompée peu à peu la valeur qu’a la commémoration en tant qu’objet de lutte permanente. Révolution, retour du même ! Or, la Révolution, transformée en monument, nous apparaît comme une réussite qui aurait fait disparaître les causes qui l’avaient produites, comme l’imaginait Tocqueville. Une discussion critique de la Révolution ne la ramène pas simplement à une réussite. Il ne s’agit pas de renoncer à la célébration nationale, qui a ce but, vertueux, de réconcilier les citoyens autour d’un mythe collectif qui se rapporte à l’événement fondateur de leur identité commune. Cependant, une mythologie, quand elle est bonne, et non pas soumise à ce que la mémoire officielle raconte, est historique au sens où elle ramène à une interrogation des origines ; elle est efficace quand elle parle au cœur. La révolution n’est pas terminée.