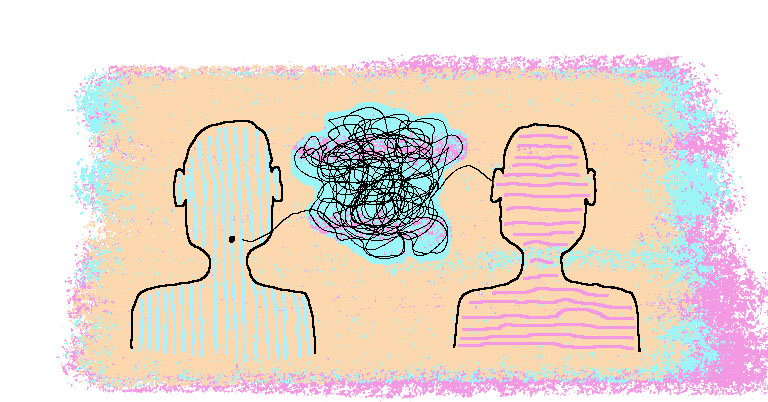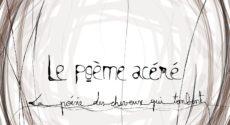Frédéric Dumont n’est certainement pas le premier nom qui se retrouverait au sommet d’une liste de « coups de cœur » littéraires d’une célèbre émission culturelle. Cependant, malgré son côté plus « underground », nous nous sommes intéressés à ce poète pour la richesse de ses contrastes et sa capacité à décrire le réel en usant d’une simplicité désarmante. Cette marginalité nous a paru comme étant le moteur de sa puissance poétique ; une sorte de poésie hors du monde qui ne cherche pas à être connue, mais qui « est » simplement, car quelque chose doit bien décrire ce que c’est que d’être hors du monde.
Frédéric Dumont a publié trois recueils de poèmes : Évènements miteux (2009) aux Éditions de Ta Mère, ainsi que Volière (2012) et Je suis célèbre dans le noir (2019) à l’Écrou. Il a accepté avec plaisir de faire cette entrevue par correspondance pour Le Délit.
Il m’apprenait qu’on pouvait faire des poèmes simples, touchants, drôles, loin de certaines traditions instituées dont je me sentais complètement éloigné
Le Délit (LD) : Avant d’entrer dans la matière même de tes recueils, nous aimerions t’interroger sur le lien entre tes sources d’inspiration et la constitution de ton écriture qui nous a semblé très unique. La question ne se restreint pas aux inspirations littéraires, elle est ouverte à des éléments de réponse de toute nature : nous parlons autant ici d’artistes que d’individus de tout domaine, de courants artistiques, bref très largement de tout ce qui peut constituer en une source d’inspiration.
Ces sources se sont-elles modifiées à travers le temps (ajout de nouvelles inspirations, délaissement d’autres)? Si oui, quelles sont les raisons de tels changements ? As-tu vu une évolution conséquente dans ton écriture (autant vis-à-vis du style que du contenu)?
Frédéric Dumont (FD) : Au tout début de ma pratique d’écriture, j’étais très influencé par certains beatniks et les auteurs américains du dirty realism. Charles Bukowski, dont j’ai lu pratiquement l’œuvre entière au début de ma vingtaine, a certainement été l’un des auteurs les plus marquants de cette période. Je dis que j”« étais », mais je le suis probablement encore. C’est juste que je ne le fréquente plus beaucoup, et je pense qu’il faut tuer ses idoles pour creuser sa voix. Pour moi, lire Bukowski, c’était un peu comme aller retrouver un ami dans un bar. Il faisait partie de ma vie d’une manière très organique. Il me donnait le droit d’écrire. Il m’apprenait qu’on pouvait faire des poèmes simples, touchants, drôles, loin de certaines traditions instituées dont je me sentais complètement éloigné. On pouvait poser un regard décomplexé sur l’écriture. Le quotidien le plus banal pouvait être raconté. Ce sont des leçons que j’applique encore dans mon travail.
Le dadaïsme et le surréalisme m’ont aussi beaucoup marqué. Je crois que ces mouvements m’ont appris l’importance du jeu en littérature. Il ne faut jamais arrêter de jouer. Jouer avec la forme, jouer avec les clichés poétiques, tuer la littérature dans la littérature, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
Samuel Beckett. Je l’avais découvert durant mon très court séjour au cégep, et je me souviens avoir eu un choc esthétique très fort en lisant une de ses pièces. J’y suis revenu un peu plus tard et je ne l’ai jamais lâché. Il m’a appris le doute. Il m’a aussi appris qu’il était possible d’écrire à partir de rien du tout. Le vide. Rien.
Je lis mes contemporains et mes contemporaines aussi. C’est très important pour moi. Je lis beaucoup plus de femmes depuis quelques années. Lorrie Moore est ma nouvelliste préférée. Maude Veilleux est une de mes poètes préférées de tous les temps. L’année de ma disparition, de Carole David, est un livre qui m’a défoncé le cerveau.
(Je name-drop et c’est un drôle d’exercice.)
J’imagine que la différence entre le tout début de ma pratique d’écriture (je considère que je suis encore au début) et maintenant, c’est simplement que mes influences majeures sont rendues un peu plus loin dans le processus de digestion.
Kill your idols.
LD : Le dépassement de ces sources d’inspiration contemporaines est-il également un enjeu important pour toi ? L’as-tu, par exemple, en tête en temps réel lorsque tu écris ?
Crois-tu que ta poésie se démarque déjà des œuvres que tu fréquentes ?
FD : Je n’utiliserais pas le terme « dépassement ». Ni pour mes idoles ni pour mes contemporains. Mes modèles continuent de m’influencer, même si j’essaie de m’en détacher le plus possible. Je suis très conscient du fait que même si je tue mes idoles, celles-ci reviendront toujours me visiter pour me souffler deux ou trois mots dans l’oreille comme des mortes vivantes.
En ce qui concerne mes contemporains, je ne sais pas. Je me laisse inspirer par ce qui est produit présentement, tout en continuant d’écrire mes petites choses dans mon coin. Je m’intéresse à mes contemporains parce que je m’intéresse à mon époque. Je ne sais pas non plus si ma poésie se démarque des œuvres que je fréquente. J’espère, mais je ne crois pas que c’est à moi d’en décider.
Je suis toujours déchiré entre communicabilité d’un propos et incommunicabilité. C’est dans ce déchirement que je déploie mes textes, en acceptant cette forme de dualité
LD : Maintenant que tu nous as éclairés sur tes influences, nous voudrions nous attarder plus en profondeur sur ton œuvre et spécialement sur ton rapport à la langue et les ruses langagières que tu emploies dans tes poèmes.
Comme tu le sais, la distance qui sépare signifiant et signifié peut complexifier le rapport à l’écriture et à la symbolisation du réel. Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer ce mélange habile entre le registre surréaliste dont tu as mentionné t’inspirer et la banalité dans ton œuvre, procédé qui peut à la fois permettre un humour unique, mais également la création de quelque chose de très poignant qui permet de construire un pont entre le langage et ton propos. Une sorte d’atténuation salutaire, un espace qui permet la poésie.
Pourrais-tu nous éclairer davantage sur cet aspect de ton rapport à la langue ? Fais-tu également usage, selon toi, d’autres ruses formelles pour arriver à transposer un certain propos en tes poèmes ?
FD : J’aime les contrastes. Je pense que j’aime beaucoup les contrastes. Par contre, je n’ai pas de formules toutes faites que j’applique dans mon travail. Ni de ruses particulières. Ces choses viennent au fur et à mesure, émergent de l’écriture en cours. Peut-être que je tente de surprendre le lecteur autant que moi-même. Comment créer la surprise avec des matériaux en apparence pauvres (espaces confinées, oisiveté, solitude, etc.) C’est quelque chose qui m’intéresse. Assembler des éléments qui n’ont à priori rien à voir ensemble est quelque chose qui me fascine. Peut-être est-ce cette liberté que permet la poésie qui m’a toujours attiré. Est-ce que cette recherche formelle a pour but d’atténuer les thèmes plutôt sombres qui m’habitent afin d’en permettre la digestibilité ? Je ne crois pas que cela soit mon but. Il est possible aussi que la violence du réel et du monde social soit toujours atténuée, mise à distance par n’importe quelle sorte d’écriture. Je ne sais pas. Je ne suis sûr de rien. Je n’écris pas avec des certitudes. Je suis toujours déchiré entre communicabilité d’un propos et incommunicabilité. C’est dans ce déchirement que je déploie mes textes, en acceptant cette forme de dualité.
Alors tu cherches un moyen de t’en sortir. Tu cherches un espace. Un lieu. Pour moi l’écriture est ce lieu
LD : Dans tes recueils de poésie, il nous a semblé que certains motifs récurrents suggéraient une poésie de l’épuisement ou encore de la maladie (physique/mentale). Nous ignorons si tu considères le « pourquoi » de l’écriture comme étant une banalité, alors nous aimerions plutôt te demander « comment » tu arrives à faire ressortir ce propos qui semble couvrir une bonne partie de ton œuvre ; quel est ton processus, ton modus operandi ? Comment réussis-tu à contourner certains tics d’écriture qui nuiraient au surgissement de ce propos ?
FD : L’épuisement et la maladie sont présents dans mes textes parce que ce sont des choses que je connais intimement ; la matière première de mes livres a toujours été autobiographique jusqu’à maintenant. C’est la raison pour laquelle il me semblerait vain de détacher le « pourquoi » du « comment ». Mon expérience du monde affecte mon écriture. Le « pourquoi », même s’il n’est pas facile à définir, n’a absolument rien de banal. S’il n’y avait pas de « pourquoi », un moteur, quelque chose qui me pousse à écrire, il n’y aurait jamais de « comment ». Et cette fatigue, cet épuisement, sont les raisons principales qui m’ont poussé à écrire mon dernier recueil. Quand tu es malade, d’une manière ou d’une autre, si tu n’es pas né dans l’opulence, tu finis par te retrouver un peu hors du monde. Sans travail, sans argent, l’avenir rétrécit et rétrécit, et rétrécit encore. Alors tu cherches un moyen de t’en sortir. Tu cherches un espace. Un lieu. Pour moi, l’écriture est ce lieu. La littérature est ce lieu. Je l’habite. Elle m’habite. Comme je cohabite avec ma fatigue. Lorsque je m’assois devant l’écran pour écrire, je ne me dis pas : « Bon, quel procédé littéraire je pourrais utiliser pour bien rendre l’affaire. »
Dans mon dernier recueil par exemple, je cherchais à atteindre une certaine sincérité, tendre le plus possible vers cela. C’était ça mon modus operandi. Comment j’ai fait ? Est-ce que j’ai réussi ? Je pense que oui, mais jamais autant que je l’aurais souhaité.
Je contourne mes tics d’écriture en relisant et en réécrivant continuellement mes textes. Modus operandi : se répéter sans se répéter. Il y a des textes auxquels je ne change pas un mot, et d’autres où je détruis et reconstruis chaque strophe, chaque vers, chaque image. Quand le pathos se pointe, je lui coupe la barbe, lui arrache le nez et le laisse seul sur une jambe avec ses deux parapluies. C’est comme ça que je fais. Avec une certaine rigueur et une certaine liberté.