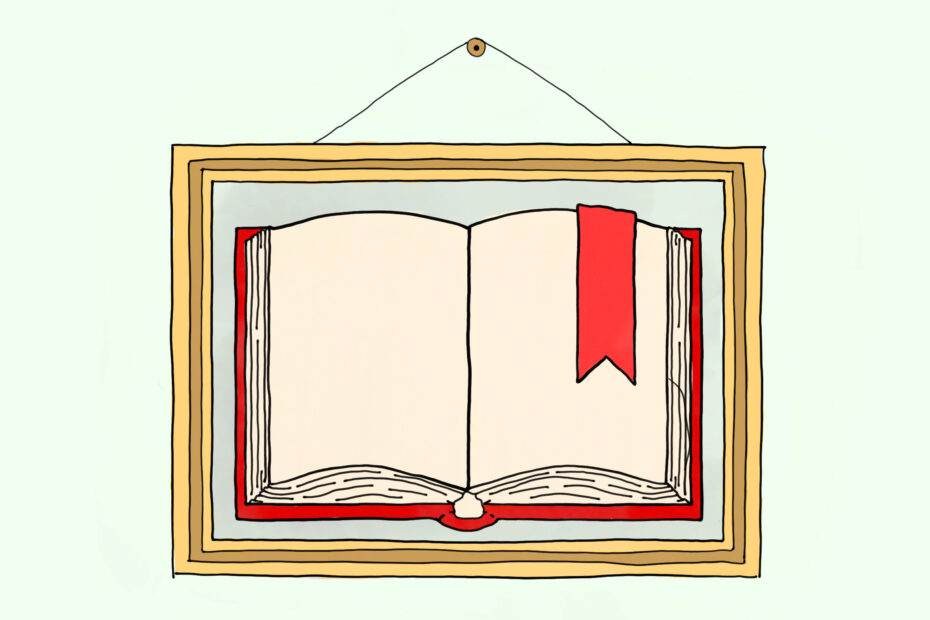La bibliophilie – l’amour et la collection des livres – est une pratique fort coûteuse qui remonte à l’Antiquité et qui a longtemps été réservée aux rois et aux plus hauts placés. En plus d’être synonyme d’érudition, la préservation des livres à travers l’histoire nécessitait un effort énorme et continuel : tandis que les hommes travaillaient la terre ou voyageaient, les moines passaient leurs jours courbés devant une page dans un scriptorium froid, provoquant des maux de dos, une fatigue oculaire et des crampes. Pour un livre. La question se pose alors : pourquoi ? Pourquoi le livre ? Quelle est son importance ? Qu’est-ce que ce livre, celui qui a traversé les siècles ou celui qu’on vient de publier ?
Si le livre a connu plusieurs formes – qui ont tour à tour permis d’améliorer la qualité d’accès à l’information, la portabilité et le coût de production –, le livre « nouveau » a toujours suscité des réactions ambivalentes. Que fait-on quand la transformation du livre quitte la matérialité de la pierre, de la peau ou du papier ? Quand le livre n’est plus obligé d’être lu, transporté, ou même ouvert ? À l’âge numérique, sa définition devra dépasser une description purement formelle du média. Il faudra s’attarder à l’expérience du livre : son langage, son contenu, son mandat, ses effets. Car considérée du point de vue ontologique, la définition du livre relève davantage de l’ordre du symbole et de la survie.
Le livre, pulsion de transmission
Dans Oralité et écriture, Walter Ong écrit que l’oralité « illumine » la conscience avec le langage articulé. Elle tisse des liens entre les mots, les phrases et les individus d’une société. Quant à l’écriture, elle concrétise et enregistre la parole dans la matière. Elle complexifie la pensée, car nous n’avons plus le souci de la mémorisation et de la simplicité. Elle intensifie le sens d’individualité et les interactions sociales. Autrement dit, l’écriture cultive la conscience (Walter Ong lui donne l’attribut « consciousness-raising »). On retiendra ce mot – cultiver –, pour s’intéresser au rapport double que le livre maintient avec la vie. D’un côté, l’écriture joue un rôle semblable à celui de l’ADN qui se charge de la transmission du matériel génétique d’une génération à l’autre. En effet, le livre permet la transcendance de la pensée, la duplication de soi dans l’autre, la transposition des regards et des couches de compréhension du monde. Il permet un enchaînement de points de vue différents, hors temps et hors espace. Vis-à-vis la mortalité, il rassure l’humain de la continuité de son individualité et de son espèce. En ce sens, le plaisir de la littérature découle directement ou indirectement d’une tentative de survie. D’un autre côté, le livre donne parfois l’impression de prendre vie par lui-même et de continuer son existence indépendamment de celle de l’auteur. Ce dernier est voué à la mort, dira Roland Barthes.
Quand on ouvre un imprimé, on est sûr de trouver le livre à l’intérieur. Cette certitude se dissipe avec l’écran, qui ne contient rien, qui est une série de lumières, de fils et de codes
Le livre, un média social
C’est le livre désacralisé, le livre à valeur capitale, le livre commercial, le livre de poche, le livre best-seller, mais c’est le livre quand même. Le livre est à la fois un puissant moyen de transfert de connaissances, d’idées et de sentiments, mais aussi un puissant artefact à part entière. Notre besoin de transmettre nos pensées, conjugué à un coût de production à la baisse, a naturellement fait du livre le premier média social. Sur une échelle communautaire, avant l’âge numérique, il joue le rôle du premier réseau social : il relie les gens, ou au contraire, les isole, leur donne des sujets de conversation, leur fait passer le temps, les cultive. Et, comme toute technologie, son utilisation peut être à bon ou à mauvais escient.
Ce qui est intéressant dans la médiatisation du livre, c’est justement la relation entre le média (la forme, la plateforme) et le message. Lire la Bible sur de la peau d’agneau et lire la Bible sur son téléphone sont deux expériences très différentes. La matérialité du livre – comme la non-matérialité du livre – influence le sérieux du message, la distance entre l’écrit et le lecteur, l’esthétisme de l’objet, le niveau de participation de celui qui lit, la valeur sociale qui lui est attribuée. Par exemple, le livre audio offre une expérience de lecture « extérieure » à soi, pendant laquelle le « lecteur » ne cherche pas les mots, mais les reçoit. L’histoire a déjà subi une première couche d’interprétation : la voix, sa tonalité, sa vitesse. Quant au livre numérique, on l’imagine plus fidèle au livre « traditionnel », c’est-à-dire au livre papier. Toutefois, la perte de la matérialité crée sans doute des effets de distanciation. À la conception platonicienne de l’Idée s’ajoute donc un quatrième degré : le livre est seulement sur l’écran, il n’est pas en dedans. Il est introuvable. Quand on ouvre un imprimé, on est sûr de trouver le livre à l’intérieur. Cette certitude se dissipe avec l’écran, qui ne contient rien, qui est une série de lumières, de fils et de codes.
Le livre, un symbole
On distingue le bibliophile du bibliomane. Le bibliomane est semblable au collectionneur de canettes de Coca-Cola, qui les accumule peut-être par compulsion. Le bibliophile, avant de collectionner ses livres, les aime. Bien sûr, cette distinction est condescendante et inutile. Elle est seulement permise en raison de la valeur que nous acceptons d’attribuer à l’imprimé ; dans ce cas, elle ne fait qu’insister sur le « fétichisme » pardonné au livre. Le livre est objet de collection, car le livre est une déclaration – au même titre que le diplôme accroché de votre dentiste, qui ne vaut rien, si on ne le voit pas. Après tout, ce n’est qu’un morceau de papier. Le livre déclare : « Cette personne est intelligente, profonde et cultivée.» Il déclare aussi : « Cette personne contient d’autres personnes intelligentes, profondes et cultivées. » Nos bibliothèques nous rassurent, nous rappellent toutes ces lectures oubliées. Alors, la réticence qu’éprouve le lecteur envers le livre numérique découlerait inconsciemment de l’invisibilité du livre-écran. La bibliothèque numérique est intérieure, ne sert à rien. Preuve que même les plus cultivés d’entre nous succombent à une forme ou une autre de superficialité.
Le sentiment du sacré repose-t-il donc seulement sur le regard social ? Non. Le livre n’est peut-être pas sacré en soi, mais son expérience l’est – du moins, devrait l’être. L’expérience du livre est presque mythologique, c’est-à-dire fondatrice, surnaturelle, personnelle. Mircea Éliade écrit dans Aspects du mythe : « La sortie du temps opérée par la lecture est ce qui rapproche le plus la fonction de la littérature de celle des mythologies, on sort du temps historique. » La lecture est un voyage – non pas spatial (dans l’univers littéraire) – mais temporel : vers une temporalité qui existe hors temps.

Le livre devrait, au contraire, être un espace ouvert que la pensée est invitée à arpenter, infiniment – un espace construit en dialogue avec un espace conquis
Le livre, un mouvement de la pensée
Depuis le début, nous avons pensé le livre, mais seulement d’une seule extrémité : celle de la lecture. Pourtant, le livre, avant d’être lu, est écrit. Le mystère du livre se trouverait ainsi, depuis le début, non pas dans son résultat, mais dans son mandat. Si l’impression que l’écriture et la pensée sont intrinsèques est juste, elle n’explique pas la nature de ce rapport. Il est tentant de penser que l’écriture permet de capturer la pensée dans sa visite pressée, de saisir le monde, le comprendre. Toutefois, capturer, saisir, comprendre ne sont pas les mots appropriés, car ils impliquent un arrêt, une réclusion, tandis que la vie est mouvement. Le livre devrait, au contraire, être un espace ouvert que la pensée est invitée à arpenter, infiniment – un espace construit en dialogue avec un espace conquis. Le mandat des plus grands livres a toujours été de créer un mouvement de la pensée qui est à la fois rationnel, séquentiel, assidu, et à la fois libre, créateur et personnel. Dans ces livres, le sujet exhibé n’est plus le livre-objet, mais la pensée de l’humain mise à nu, avec toutes ses tournures imprévues et son fonctionnement interne. Le regard ne se heurte plus à la couverture, il pénètre, interroge, réorganise, à sa façon, son regard de l’autre.