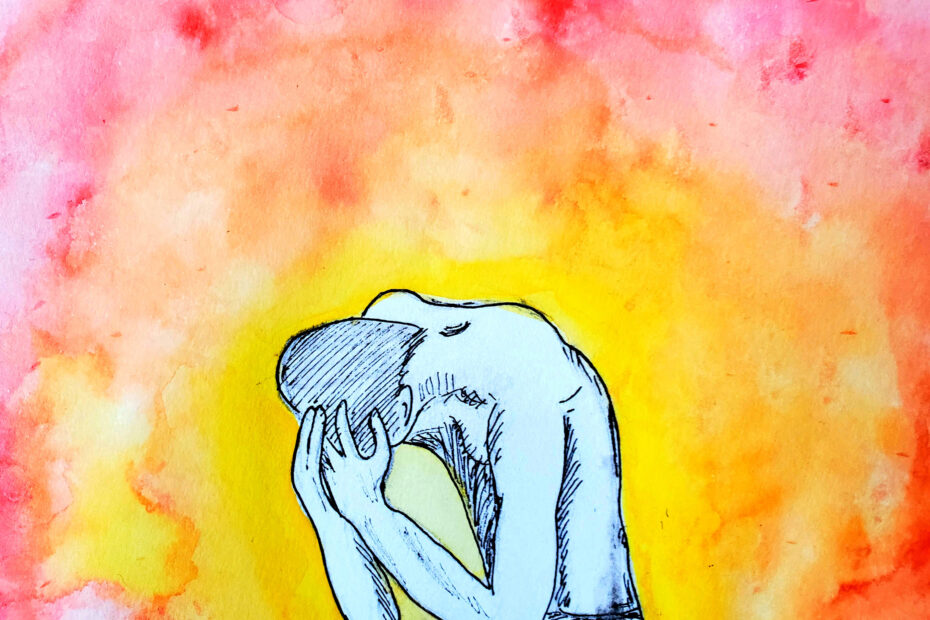Si la vision très répandue de l’existence, qui peut nous sembler la plus naturelle, consiste à traverser notre vie en évitant de souffrir, il est de nombreux penseurs qui auront plutôt défendu la nécessité de la souffrance, même sa positivité. Que ce soit pour devenir plus fort ou être libre, la souffrance joue un rôle décisif dans nos existences, un rôle dont on peut se réjouir. C’est le cas de Nietzsche, à qui on doit la célèbre phrase « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Le penseur allemand pense que la souffrance est le souffle de la vie ; de fait, la joie et la souffrance sont inséparables.
Un tel discours n’est pas sans rappeler celui du grand auteur russe Dostoïevski. Auteur antérieur à Nietzsche, son narrateur des Carnets du sous-sol jubile dans sa souffrance – qu’il entretient d’ailleurs en faisant preuve de méchanceté envers lui-même. Mais cette vision dostoïevskienne n’est pas unique à cette œuvre. « La souffrance, c’est la vie », peut-on trouver dans Les frères Karamazov. Pour l’écrivain, il vaut mieux vivre les émotions négatives que ne rien ressentir. « Souffrir et pleurer, c’est encore vivre », nous affirme-t-il enfin dans Crime et châtiments. Ainsi, la souffrance est au fondement de la vie humaine, et il est impératif de l’accepter. Mais pas seulement – il faut l’aimer.
La souffrance souterraine
Les Carnets du sous-sol, rédigé avant les « grands romans » comme L’idiot, Crime et Châtiments et Les frères Karamazov, peut être considéré comme une œuvre « laboratoire » pour ces derniers. C’est un point tournant dans la vie et littérature de Dostoïevski ; il en commence d’ailleurs la rédaction alors qu’il veille la dépouille de sa première femme.
Ce qui marque à la lecture de ce livre, c’est le plaisir que prend le narrateur à souffrir, et à raconter sa souffrance avec lyrisme. Les pages sont teintées d’ironie, de désespoir. Le personnage souffre et entretient volontairement cette souffrance, mais surtout la communique, autant par l’écriture de ses carnets que par la plainte orale aux acteurs de sa vie. Il est malade (il a un mal de dent) et refuse de se faire soigner par méchanceté. Cela n’administre de mal qu’à lui seul, et pourtant, ce mal peut être joyeusement transmis à ses proches. Ainsi, les geignements de celui qui souffre ne sont pas pour soi mais pour autrui – celui qui geint peut jouir de sa souffrance. Cet exemple, issu du quotidien, incarne les idées du narrateur – et celles de Dostoïevski lui-même : la jouissance suprême, ce serait de pourrir la vie de toute la famille qui nous entend geindre.
Le narrateur est donc en souffrance physique, mais aussi en souffrance morale et psychique. Cette dernière est indispensable pour que la vie continue, pour que l’homme soit libre, selon Dostoïevski. Les hommes peuvent ainsi préférer, peut-être étonnement, le chemin ardu à la facilité. La liberté de la difficulté les attire plus que leur avantage raisonné ; c’est là le paradoxe de Dostoïevski.
« La jouissance suprême, ce serait de pourrir la vie de toute la famille qui nous entend geindre »
Le savoir de la souffrance
Affectés par le romantisme de leur siècle, Dostoïevski et Nietzsche ont tous les deux une vision négative à son sujet. Le premier refuse que son influence n’atteigne les Russes, le second condamne son pessimisme creux. Nietzsche décrit le romantisme dans les arts et la connaissance comme ce qui répond aux besoins de « ceux qui souffrent de l’appauvrissement de la vie, qui recherchent, au moyen de l’art et de la connaissance, le repos, le calme, la mer d’huile, la délivrance de soi, ou bien alors l’ivresse, la convulsion, l’engourdissement, la démence ». Nietzsche oppose à cela « ceux qui souffrent de la surabondance de la vie, qui veulent un art dionysiaque et également une vision et une compréhension tragiques de la vie ». Cette conception rejoint la vision dostoïevskienne : mieux vaut souffrir que ne rien sentir – ceux qui recherchent l’engourdissement cherchent alors l’opposé de la vie elle-même.
Pour Nietzsche, non seulement la souffrance est-elle nécessaire et inévitable, mais elle nourrit aussi le savoir et la connaissance. Il soutient que la sagesse est dans la douleur comme elle est dans le plaisir. Les échecs sont en ce sens autant nécessaires que les réussites, et, dans les mots mystiques nietzschéens, « le chemin qui mène à notre propre ciel passe toujours par la volupté de notre propre enfer ».
Si Nietzsche décrit la « détresse de l’âme » comme une connaissance qui serait finalement « un signe d’éducation raffinée », pour Dostoïevski, la souffrance est preuve d’une sensibilité, d’une intelligence : il faut une conscience élevée pour être sensible à la souffrance, auquel cas la souffrance la plus dure – la souffrance psychique – peut être comprise.
Nietzsche mentionne aussi dans Le Gai savoir que « celui qui veut avoir le plus [de plaisir] possible doit aussi avoir le plus [de déplaisir] possible », parce que celui qui a dans son âme le « bonheur d’Homère » est aussi le plus susceptible à la souffrance. En ce sens, les stoïciens semblaient avoir compris ce lien entre les deux extrêmes, leur solution étant toutefois de désirer le moins de plaisir possible afin de subir le moins de déplaisir possible. À la fois Nietzsche et Dostoïevski refusent cette conclusion : « s’avancer simultanément vers sa plus haute souffrance et sa plus haute espérance », voilà justement ce qui est le plus héroïque, le plus louable.
« Le chemin qui mène à notre propre ciel passe toujours par la volupté de notre propre enfer »
Friedrich Nietzsche
Amor fati
Dans La Généalogie de la morale, Nietzsche révèle que l’homme « ne refuse pas en soi la souffrance, il la veut, il la recherche même, pourvu qu’on lui en montre le sens, un pourquoi de la souffrance. C’est l’absence de sens de la souffrance et non celle-ci qui était la malédiction jusqu’ici répandue sur l’humanité ». Pour Nietzsche, l’idéal ascétique aura donné à l’homme une plus grande souffrance, mais une souffrance ayant un sens. Le philosophe appelle cela une volonté de néant : « L’homme préfère encore vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout…»
Le narrateur des Carnets du sous-sol est d’ailleurs un exemple d’homme voulant souffrir pour donner du sens à sa vie, en la dramatisant. Cette souffrance est transformée en monstre dans un processus de création, d’entretien, de transmission. Ce monstre personnellement façonné peut ensuite être affronté, battu, vaincu. Mais Nietzsche remarque que la souffrance, surtout la plus personnelle, est toujours unique à soi et reste « incompréhensible et inaccessible pour presque tous les autres ». En cela, conclut-il, « nous sommes cachés au prochain ». Ainsi, la souffrance n’est pas seulement inévitable mais aussi intraduisible : c’est là le tragique de l’existence.
Si Dostoïevski voit en la souffrance une nécessité, Nietzsche adhère à cette vision en y ajoutant un impératif : non seulement faut-il accepter cette souffrance inévitable, mais il faut l’aimer. Cet amour permet de donner du sens à l’existence et de vaincre le nihilisme. Nous retrouvons ici le concept d’amor fati. C’est dans le Gai Savoir que le philosophe nous dit : « Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau : je serai ainsi l’un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati : que ce soit dorénavant mon amour ! Je ne veux pas faire la guerre au laid ».
Notons avec souci que cet amor fati n’est point un fatalisme : c’est toujours bien son contraire. Là où Dostoïevski se résigne, néanmoins avec force, à affronter les souffrances de la vie, Nietzsche souhaite dépasser cette condamnation. Sa prescription demande une action envers ce destin : il faut aimer sa souffrance tout entière.
Cette élévation de la souffrance autant chez le philosophe allemand que l’auteur russe n’est cependant pas le point-clé ; plutôt faut-il se concentrer sur la manière dont les deux hommes réagissent devant cette souffrance. Leurs visions de l’épreuve qu’est la souffrance se rejoignent : les sommets ne peuvent être atteints qu’après l’avoir traversée, car elle seule permet véritablement de grandir. À la fois Nietzsche et Dostoïevski démontrent ainsi un grand respect pour la souffrance vécue et, surtout, la souffrance vaincue.
Là où Dostoïevski est un penseur de la fatalité, Nietzsche est un penseur du tragique. Le premier affronte passivement la vie, le second accueille à bras ouverts le réel. Ce n’est alors qu’après cet embrassement que peut se pointer à l’horizon la figure du surhomme nietzschéen.