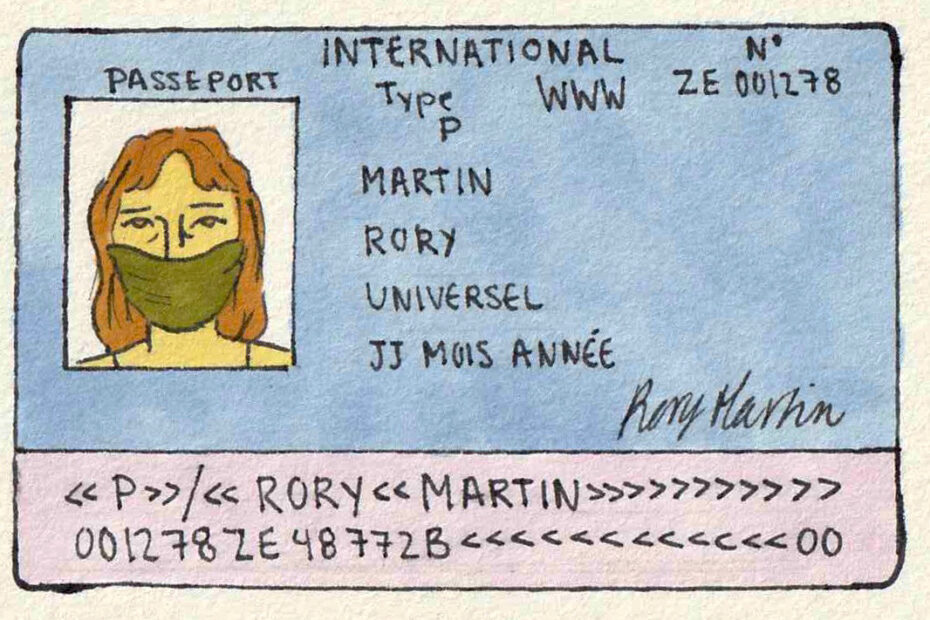Lors de son discours du trône en septembre dernier, Trudeau a souligné l’importance de l’immigration dans son plan de relance économique de l’après COVID-19. Pour des migrant·e·s, tiraillé·e·s entre la fermeture des frontières et les restrictions de voyage, c’est un message qui est le bienvenu. Une logique calculatrice se cache pourtant derrière la rhétorique d’ouverture et d’accueil. Le plan s’inscrit dans une perspective de mettre « à profit les retombées de l’immigration pour maintenir la compétitivité du Canada sur la scène mondiale ».
Le moment actuel nous offre l’occasion de réfléchir à une vision plus éclairée et humaniste de l’étranger·ère.
Une histoire d’accueil
Revenons à une époque où l’immigration ne relevait pas uniquement d’une question technique ou économique, mais également du devoir de solidarité internationale. Au Canada, les bouleversements profonds de l’après Seconde Guerre mondiale ont entraîné une certaine ouverture sur le monde et, par conséquent, le réexamen de l’enjeu de l’immigration à une époque rythmée par des questions d’égalité raciale et de droits humains. Si, jadis, le pays privilégiait avant tout l’entrée des migrant·e·s d’origine européenne, tout commence à changer à partir des années 1960. Des réformes majeures du système d’immigration ont ouvert la voie aux migrant·e·s venant des pays en voie de développement. Alors que ces changements servaient à combler un besoin de main‑d’œuvre, mettant l’accent sur l’immigration économique, ils prenaient aussi une dimension humanitaire.
L’histoire d’accueil des réfugié·e·s indochinois·es et cambodgien·ne·s est bien connue. Toutefois, on connaît moins son rapport avec l’évolution de l’identité nationale au Québec. Rappelons que les programmes de parrainage et d’asile actuels voient le jour au moment où les revendications nationales des Québécois·es atteignent une forte ampleur, incarnées par l’élection du premier gouvernement ouvertement indépendantiste sous René Lévesque. Preuve que le souverainisme et l’hospitalité ne s’opposent pas forcément, les moyens pour accueillir les exilé·e·s sud-asiatiques ont été conçus et soutenus par les souverainistes au pouvoir à l’époque, en collaboration avec le gouvernement conservateur minoritaire de Joe Clark au niveau fédéral.
Vers la fin des années 1970, les programmes de parrainage ont été mis en place. C’est Jacques Couture, père jésuite et ministre de l’Immigration du Parti Québécois (PQ) de 1976 à 1980, qui a piloté l’expansion du programme afin de permettre aux groupes de citoyen·ne·s privés de parrainer des réfugié·e·s. Les Canadien·ne·s et Québécois·es s’engageaient dans le mouvement d’accueil avec enthousiasme. Au moins 10 000 personnes ont pu ainsi s’installer au Québec, dont les réfugié·e·s indochinois·es, des émigré·e·s haïtien·ne·s, ainsi que les Chilien·ne·s et Salvadorien·ne·s fuyant les dictatures de l’Amérique latine.
« La SQSI avait pour but d’inciter les Québécois·es à une plus grande solidarité envers les pays en voie de développement »
Élu en 1976, Couture s’était engagé dans le mouvement syndicaliste québécois avant de rejoindre la politique. Cette implication passionnée aurait eu un impact sur les convictions qui l’ont animé tout au long de sa vie, comme le souligne l’historien Martin Croteau.
Le prêtre-ouvrier a également fondé la Société québécoise de solidarité internationale (SQSI) en 1980, donnant à l’organisation un rôle consultatif auprès du ministère de l’Immigration. La Société avait pour but d’inciter les Québécois·es à une plus grande solidarité envers les pays en voie de développement et les migrant·e·s et les réfugié·e·s qui en venaient. La SQSI soulignait l’importance du soutien des populations en détresse et agissait dans le domaine de l’aide internationale, notamment en Afrique et en Amérique centrale1.
Au devoir d’accueillir l’étranger·ère s’ajoute la nécessité de « corriger les situations qui amènent l’exode des réfugiés2 ». La corruption, la pauvreté et l’inégalité galopante, en passant par les dérives autoritaires et intégristes qu’elles suscitent, nourrissent le désespoir envers l’avenir, ce qui poussent de nombreux gens à quitter leur pays.
Couture et la SQSI se mobilisaient à une époque où l’idée de la décolonisation était toujours très vive, comme le constate Sean Mills. Si la Révolution tranquille avait éveillé une ferveur nationale, le ferment politique qui l’a suivie a également inspiré une réflexion critique sur les rapports de la province avec le monde extérieur. Certain·e·s imaginaient un internationalisme qui tisserait des liens entre le Québec et le tiers-monde, composé de pays qui avaient eux-mêmes lutté pour leur indépendance. On peut également déceler les aspirations d’une province qui commençait à se doter d’une politique étrangère propre à un État québécois.
Il en va de même pour le journaliste Jean-Marc Léger. Souverainiste convaincu et partisan infatigable de la langue française, il traitait la question de l’immigration au même titre que les problèmes démographiques et culturels sérieux auxquels le Québec faisait face. Pour Léger, une politique d’immigration devait reposer, avant tout, sur un souci de bâtir une nation à travers une langue et des valeurs partagées. Il souligna l’importance de veiller à ce que les capacités d’intégration de la province soient adéquates pour recevoir de nouveaux·elles immigrant·e·s. Toutefois, des facteurs économiques ne pouvaient pas l’emporter sur d’autres considérations. Écrivant en 1986, il a critiqué la tendance « à privilégier la dimension économique, voire mercantile, de l’immigrant (investisseur si possible, consommateur en tout cas) » qui témoignait « d’une sorte de mépris à son endroit comme d’indifférence à nos propres valeurs3 ».
Ce sont des valeurs – une notion plutôt galvaudée depuis quelque temps – qui vont réunir tous ceux et toutes celles qui appartiennent au collectif québécois. Léger a souligné que la volonté des immigrant·e·s de s’y intégrer pleinement et d’en faire partie dépendait également d’un peuple confiant et conscient de sa propre histoire. Ce n’est qu’avec cette confiance qu’il pourra devenir « plus accueillant à l’autre, plus ouvert et sensible au dialogue des cultures ». 30 ans après, le discours de l’ancien secrétaire-générale de la Francophonie, appelant à l’assimilation rapide des migrant·e·s au nom de la survie culturelle et à la mise en garde contre certains groupes culturels difficilement assimilables, semble aujourd’hui dépassé. On pourrait néanmoins apprécier le devoir d’ouverture qui s’impose – tant pour l’immigré·e que pour la société qui l’accueille, pour mieux se comprendre et s’engager dans un avenir partagé.
Le·la migrant·e pouvait ainsi se reconnaître dans une nation qui ne lui serait plus étrangère.
Un regard sur l’avenir
De cette histoire, peut-on tirer des leçons ? Certes, elle marque un fort contraste avec la situation actuelle. Au Québec, comme ailleurs, on resserre les restrictions à la liberté de mouvement que subissaient déjà les migrant·e·s sur place. Si tout le monde se retrouve confiné, l’étranger·ère est le·la plus confiné·e.
Pire encore, la crise sanitaire pourrait entraîner une crise économique importante. D’un côté, il est fort probable que cela accélère la tendance des pays à se replier sur eux-mêmes, voire encourager des nationalismes extrêmes et intégristes. L’après-crise, d’un autre côté, pourrait renforcer l’hubris d’une globalisation rampante, glaciale et déshumanisante qui a favorisé la propagation d’un virus au même titre que des inégalités croissantes, tout en gommant la richesse des cultures diverses, ce qui incite à des replis identitaires.
« Le système canadien a tendance à attirer ceux et celles qui viennent des couches sociales les plus aisées des autres pays »
La crise sanitaire dévoile également les répercussions poignantes des inégalités extrêmes à l’échelle mondiale qu’explique, en partie, l’immigration vers des pays riches. Certaines sociétés s’en sont tirées plus facilement que d’autres. La politique d’immigration des pays occidentaux, où les étranger·ère·s ne sont jamais traité·e·s de manière égale, renforce ce déséquilibre.
À la dévalorisation du travail dit « non qualifié » s’ajoutent les coûts pénibles associés aux tests de langue et de santé, preuves financières, renouvellements interminables des permis et visas et même aux billets d’avion. Mur impénétrable pour la plupart des migrant·e·s venant des pays en développement, à un tel point qu’un doctorant en histoire et un étudiant en gestion à McGill pourraient plus facilement accéder à la résidence permanente qu’un travailleur agricole mexicain, une préposée haïtienne ou encore une domestique philippine. Éloigné·e·s de leurs propres familles, attaché·e·s aux emplois peu désirables – à la fois fort essentiels et dévalorisés – mais ayant prodigué leur juste part aux sociétés québécoise et canadienne, entre l’un et l’autre, qui est plus « essentiel » ?
Le chemin n’est pas non plus évident pour les étudiant·e·s internationaux·ales, cette espèce d’immigrant·e apparemment la plus favorisée et privilégiée par le Canada. Au Québec, les changements controversés apportés au Programme de l’expérience québécoise (PEQ) nous promettent un accueil moins chaleureux que les politicien·ne·s ne le laissent croire.
Le système canadien, autrement dit, a tendance à attirer ceux et celles qui viennent des couches sociales les plus aisées des autres pays, déjà idéalement placé·e·s pour se faufiler dans le dédale migratoire, ce qui ne fait que reproduire les inégalités à l’échelle mondiale. C’est mieux, certes, que ce qu’on voit ailleurs. Il n’empêche qu’on peut en imaginer une alternative qui ne réduit ni le·la migrant·e à une main‑d’œuvre bon marché, ni ne fait de l’accueil des réfugié·e·s un acte de charité. Un monde où l’étranger·ère serait accueilli·e comme l’être humain qu’il ou elle est, sinon le ou la citoyen·ne qu’il·elle pourrait devenir, plutôt qu’un chiffre à entrer dans un rapport trimestriel ou, pire encore, le bouc émissaire de la prochaine élection.
Mon point de départ
Avant de conclure, je tiens à souligner mon point de départ. Je viens d’un pays qui donne, en ce moment de pandémie, une nouvelle dimension au mot « confinement ». Aux Philippines, la crise du coronavirus n’a fait que renforcer les dérives autoritaires qui l’ont précédée : voilà les bidonvilles devenus zones de guerre, les barrières et couvres-feux qui confinent tant le virus que l’opposition politique, l’omniprésence des forces de l’ordre et la violence terrible qu’exerce le pouvoir contre nos propres citoyens.
Cela dit, mon parcours n’a pas été pénible, au contraire. En arrivant au Canada, il y a cinq ans à peine, puis au Québec, je pensais avoir trouvé une certaine paix. Je me tenais à distance de mes propres origines, à tel point que j’ai décidé d’étudier l’histoire du Canada et des peuples qui, de prime abord, n’avaient rien à voir avec le mien ; et même d’écrire cet article en français, une langue d’adoption dotée d’une musique latine qui rime avec celle qui m’a habité depuis mon enfance. Je suis toujours frappé par la gentillesse et l’ouverture d’esprit des gens qui habitent ce pays, dont les valeurs sont parfois trahies par leurs politicien·ne·s.
Une tristesse indicible s’empare de moi ces derniers temps. La quête d’une vie stable, dans une société qu’on a appris à aimer, demeure une démarche kafkaïenne.
Pour moi, et pour beaucoup d’entre nous, tout est devenu flou et incertain. Reste à voir ce que l’avenir nous réserve.
Références :
- Correspondances, documents variés (entre les années 80–90), P832, S1, SS1, Historique de la Société Québécoise de Solidarité Internationale, BANQ-Vieux Port.
- Communiqué de Presse, Ministère de l’Immigration, Gouvernement du Québec, 17 juin 1980, Fonds de la Société québécoise de solidarité internationale, P832, S1, SS1, Historique de la Société Québécoise de Solidarité Internationale, BANQ-Vieux Port.
- « Avenir du Québec et Immigration », 4 septembre 1986. P599 Fonds Jean Marc-Léger, 2001–01-001, Fonction publique internationale, BANQ-Vieux Port.
L’auteur tient à remercier l’équipe de rédaction du Délit, ses professeur·e·s de français, Mme Sarah Anthony et M. Guillaume Gachet, et son copain, pour avoir corrigé ses textes.