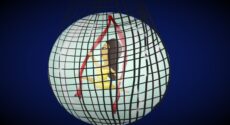Culture populaire, culture générale, cultures du monde, « cancel culture ». Quatre locutions qui, alignées l’une après l’autre, paraissent redondantes par l’utilisation d’un dénominatif commun. Quatre expressions où « culture » se confond parmi la multitude de significations qui peuvent lui être attribuées. Encore nous faut-il, dans l’ordre de la pensée, considérer les différentes réalités auxquelles la culture se rapporte. Ce faisant, il nous apparaît nécessaire de nous interroger sur le champ sémantique que recouvre ce mot, ne serait-ce parce qu’il donne son nom à la section dont nous sommes à la tête au Délit, qui se divise en rubriques telles que « Théâtre », « Cinéma », « Création »,… Sans remettre en cause l’intérêt pratique de ces catégorisations artistiques, elles s’avèrent peut-être limitatives pour appréhender de façon plus conceptuelle l’idée de culture(s).
Définitions : culture individuelle ou collective ?
Signalons d’entrée de jeu que le présent article – que l’on pourrait qualifier d’essai – ne cherche pas à parvenir à une généralisation totalisante de la culture, dont la conception fluctue selon les époques et les sociétés. Ce texte s’offre plutôt comme une piste de réflexion sur certaines problématiques entourant le terme « culture », notamment en ce qui concerne son acception individuelle ou collective. Distinguons d’abord ces deux notions.
D’une part, l’acquisition personnelle de nouvelles connaissances et le développement des facultés de l’esprit doivent être départagés de la culture propre à un ensemble d’individus. Si la culture de chacun·e contribue sans doute à l’enrichissement de la collectivité, il serait faux de penser que les positions de quelques esprits instruits puissent être attribuées à l’ensemble du groupe social auquel ils appartiennent. L’acquis intellectuel s’avère foncièrement différent de l’acquis social, le premier nécessitant un examen de la pensée avant d’être assimilé, alors que le deuxième peut très bien être hérité sous la forme d’automatismes culturels. Ces derniers se manifestent entre autres par des comportements tellement ancrés dans les usages qu’ils apparaissent innés. Nous n’avons pas besoin de réfléchir avant de dire « merci » lorsque quelqu’un nous rend service ; nous savons intuitivement, par le biais de notre éducation et du poids des attentes extérieures, que les remerciements sont valorisés socialement.
« L’acquis intellectuel s’avère foncièrement différent de l’acquis social »
D’autre part, l’individu issu d’une certaine culture n’est pas poussé à agir de la même manière que l’individu issu d’une autre culture. Les dispositions sociales dans lesquelles nous sommes poussé·e·s à remercier varient selon le contexte culturel dans lequel nous sommes immergé·e·s. Au Vietnam, par exemple, il est considéré comme superflu de remercier son interlocuteur·rice pour des échanges monnayables, alors que nous estimons qu’il s’agit d’une preuve de politesse en contexte nord-américain. Or, si une personne originaire de l’Amérique du Nord venait à passer plusieurs années au Vietnam, il est fort probable que cette dernière s’adapterait aux normes sociales vietnamiennes et viendrait à penser que les remerciements à la suite d’échanges monnayables sont superflus. En effet, une pratique qui semble « normale » au sein d’un certain groupe social peut devenir « étrange » dans un autre contexte et, avec un certain recul, nous pouvons même remettre en cause la « normalité » des pratiques et des rituels que nous tenons le plus pour acquis, comme le fait notamment l’analyse satirique Body Ritual Among the Nacirema (Rituels corporels chez les Nacirema, tdlr) d’Horace Miner, qui exoticise la société américaine.
Ainsi, nous pourrions résumer la notion de « culture collective » à l’ensemble des conventions, des coutumes et des connaissances – non individualisées, mais partagées – d’un groupe social, qu’il s’agisse de ses traditions, de ses lois, de ses valeurs, de ses pratiques artistiques ou religieuses. La définition de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) abonde dans un sens similaire : « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. » Ces « traits distinctifs », comme nous l’avons vu, forment l’unicité, les particularités et la non-conformité d’un groupe social par rapport à un autre. Mais ne permettent-ils pas, avant même de produire des différences interculturelles, de délimiter la frontière entre ce qui est hérité de la culture et ce que nous devons au monde naturel ? Considérée ainsi, la définition de l’UNESCO omet un sens « plus large » de la culture, celle qui transcende l’appartenance à un groupe social ou à un autre.
Une culture universelle ?
Si nous comprenons la culture comme « ce qui s’oppose à (ou dépasse, ou maîtrise) la nature », selon une définition de la philosophe Anne-Marie Drouin-Hans, nous pourrions avancer qu’elle opère selon un mode rationnel à des fins d’appropriation. Par exemple, l’humain du paléolithique, par sa capacité analytique, a su développer des outils lui permettant de pêcher et de chasser. Mais est-il vraiment le seul mammifère à être doté d’une intelligence lui permettant de posséder la nature ? Les chimpanzés montrent également une capacité à s’outiller de bâtons pour recueillir des termites nichés au fond des arbres, « méthode qu’ils se transmettent de génération en génération ». Les éléphants, quant à eux, sont capables de pressentir la mort et vont se mettre à l’écart de leurs semblables pour mourir. Il s’agit, pour le chercheur Étienne Danchin et plusieurs autres, d’exemples de cultures qui existent à l’état animal, même si elles demeurent, d’un point de vue externe, inégalables à la complexité du développement culturel dont est capable l’humain.
Percevoir la culture comme étant une preuve de l’esprit raisonnable exclusif à l’humain relève donc de la fausse croyance. Si la capacité cognitive de l’humain est plus développée que le reste du règne animal, elle ne permet pas de lui attribuer une nature singulière, capable à elle seule d’expliquer le phénomène de culture. La théorie darwinienne ne saurait trop nous rappeler que l’humain ne peut s’extraire entièrement de l’évolution naturelle qui a laissé certains attributs biologiques en lui, comme son réflexe de survie et son anatomie particulière. À quoi reconnaît-on alors la spécificité de la culture humaine ?
« Percevoir la culture comme étant une preuve de l’esprit raisonnable exclusif à l’humain relève donc de la fausse croyance »
Envisageons la culture comme l’expression d’une volonté d’ordonner le monde inhérente à l’humain. S’il n’est au commencement qu’un primate devant agencer les ressources à sa disposition pour fabriquer des outils lui servant à se protéger de la vie sauvage, l’humain sera au cours de son évolution amené à développer un système de pensée lui permettant de classer ses valeurs, ses opinions, ses croyances, bref, tout ce qui constitue sa culture individuelle mise en relation avec les exigences du « vivre-ensemble » auxquelles il doit se conformer. Ce désir irrépressible de classification de l’humain, selon une idée de l’anthropologue Mary Douglas, trouve à son origine un besoin de créer du sens autour de lui, plus précisément de faire correspondre sa propre capacité réflexive à la complexité du monde extérieur, pour l’appréhender selon un ordre logique et cohérent.
L’humain peut être considéré comme toujours insatisfait de sa nature instinctive, en ce qu’il ne peut se laisser gouverner par ses seules déterminations innées ; il cherche à établir ses propres lois vis-à-vis de la nature pour s’en faire « maître et possesseur », selon une idée de Descartes. Mais il ne peut non plus se limiter à contrôler la nature par la fabrication d’outils utilitaires ; il doit concevoir la culture comme créant de véritables « espaces symboliques » – selon une expression de Stéphane Vibert – qui structurent sa manière d’envisager sa place au sein du monde. La culture humaine possède une valeur surtout pour ce qu’elle représente et pour le sens que nous lui attribuons collectivement.
Le langage écrit, par exemple, est signifiant à condition qu’il établisse un consensus entre le mot et son référent ; indépendamment de toute connaissance des langues humaines, il nous serait impossible de déchiffrer les traits d’encre abstraits qui figurent sur une page. Au même titre que la passation d’histoires orales, l’écriture n’occupe aucune fonction du point de vue de la survie biologique, mais témoigne du besoin plus profond de l’humain d’immortaliser ses idées à travers le langage. Mais ce caractère de « permanence » attribué à l’écrit, que peuvent bien en faire les animaux ? Il nous serait inversement difficile de prétendre posséder une connaissance sans équivoque de la conception de la transmission chez les chimpanzés d’âge adulte qui enseignent aux plus jeunes à recueillir des termites à l’aide de bâtons. En effet, calquer notre propre conception de la culture sur leur interprétation du monde relève de la fantasmagorie. Leur manière inventive de se nourrir relève-t-elle alors d’un phénomène naturel, garantissant une meilleure perpétuation de l’espèce, ou n’est-ce pas aussi une forme de culture consolidant les liens intergénérationnels entre chimpanzés ?
« À quoi reconnaît-on la spécificité de la culture humaine ? »
Le flou entre ce qui appartient en propre à la nature ou à la culture résulte de la difficulté ontologique de l’humain à classifier ce qui, chez lui, est de l’ordre de l’inné ou de l’acquis. Nous avançons toutefois que l’humain possède une certaine propension qui le pousse à s’approprier son environnement ; il doit décomposer le monde – de manière pragmatique et analytique – pour le comprendre et par la suite s’en emparer, le maîtriser. La nature première de l’humain, ne serait-ce pas justement la nécessité de culture qui s’exprime à travers lui ?
Pour comprendre cette dernière idée, prenons l’exemple des 257 parcs naturels protégés par l’UNESCO en date d’aujourd’hui. Préserver l’« état de nature » de ces espaces géographiques, à l’image d’une carte vierge dépourvue de toute influence culturelle, participe d’un aveuglement volontaire, dans la mesure où l’impact des activités humaines sur leur écosystème est déjà irréversible. On peut prétendre autant qu’on veut que la nature autour de nous est pure, mais peu importe l’endroit où l’on se trouve, l’environnement conserve l’empreinte – directe ou indirecte – des occupations humaines actuelles ou passées. Mentionnons à ce titre le parc national de Yosemite, reconnaissable à ses vallées et ses formations rocheuses vertigineuses, qui ne peut pas être considéré hors de l’histoire culturelle des Ahwahnechee ayant pratiqué des brûlis (déchiffrement par le feu) sur ce territoire. Bien sûr, nous pourrions « camoufler » les clairières par un travail de reboisement, mais celui-ci serait issu d’une décision culturelle visant à redonner à la forêt de Yosemite son apparence première. De plus, doter un certain territoire de l’étiquette « parc naturel » dans le cas de l’UNESCO, c’est déjà le soumettre à des politiques strictes de protection et de conservation de l’environnement qui régiront et restreindront son entretien.
« Ce désir irrépressible de classification de l’humain, selon une idée de l’anthropologue Mary Douglas, trouve à son origine un besoin de créer du sens autour de lui »
Arrêtons-nous un peu sur la nature de ces délimitations arbitraires. N’est-il pas vain de tenter d’attribuer des caractéristiques exclusives se rapportant au naturel et au culturel, alors qu’il s’agirait de deux notions faisant partie d’un tout complémentaire ?
Opposer nature et culture : une construction sociale ?
Selon l’historien de l’environnement William Cronon, opposer de façon stricte l’idée de la « culture » à celle de la « nature » – et particulièrement se convaincre que la nature existe à un état « pur » qui devrait être protégé de l’activité humaine – est paradoxal, car au final, elle exclut les êtres humains du monde naturel et mène à la seule conclusion que pour « sauver » la nature, les êtres humains doivent disparaître. Or, détenons-nous autant de contrôle sur la nature que nous le prétendons ? Pouvons-nous affirmer que l’humain est d’une puissance telle qu’il peut soumettre toute forme de vie naturelle à sa volonté ? Si tel était le cas, nous serions pleinement maîtres des pulsions qui régissent nos mécanismes inconscients.
« Pouvons-nous affirmer que l’humain est d’une puissance telle qu’il peut soumettre toute forme de vie naturelle à sa volonté ? »
Avancer que l’être humain peut précisément identifier la nature et la culture comme deux concepts distincts peut sembler présomptueux, dans la mesure où l’on peut arguer qu’il n’est lui-même pas en mesure de complètement se définir. Oui, nous avons probablement toutes et tous le sentiment d’être une personne distincte, capable de se définir comme un « soi » évoluant dans le temps avec une certaine continuité, mais au-delà de ça, qu’est-ce qu’un humain ? Un « bipède sans plumes » ? Ou, comme Carl Linnaeus – premier naturaliste à avoir classifié l’être humain dans le règne animal – a originalement défini l’espèce « Homo » dans le Systema Naturae, un primate en mesure de se reconnaître lui-même et de reconnaître ses semblables ? En effet, la première édition du Systema Naturae en 1735 comportait comme seule définition de l’être humain la mention Nosce te ipsum (« Connais-toi toi-même »). Il divisait aussi l’être humain en quatre « variétés » pour le moins questionnables ; on peut donc se demander ce qui nous distingue vraiment au final des autres espèces animales.
Dans un sens, la distinction entre la nature et la culture est similaire à celle entre l’être humain et toute autre espèce de primate ; nous avons peut-être une certaine idée de ce que représente l’idée de nature par rapport à celle de culture, mais définir les deux concepts conjointement s’avère ardu et toujours sujet à débat. Pourquoi ? Le chercheur en sciences sociales Bruno Latour dirait que c’est parce que cette distinction est factice ; pour lui, nous serions dans un monde rempli d’hybrides qui franchissent sans cesse les limites entre nature et culture. La chercheuse en études autochtones Zoe Todd, de son côté, avance plutôt que c’est en raison des relations et interactions complexes entre êtres humains et non-humains. Les êtres humains et non-humains ne cessent de mutuellement s’affecter, et les actions de l’un ne cessent de se « réfracter » sur l’autre, de façons multiples et imprévisibles.
« Doter un certain territoire de l’étiquette ‘‘parc naturel’’ dans le cas de l’UNESCO, c’est déjà le soumettre à des politiques strictes de protection et de conservation de l’environnement qui régiront et restreindront son entretien »
Peu importe les causes attribuées à la difficulté de définir la « nature » et la « culture », cette division demeure sujette à débats, tout en comportant des conséquences concrètes – en affectant notamment ce que diverses luttes environnementales décideront de protéger ou de ne pas protéger. Les activités humaines accélèrent les extinctions et autres catastrophes naturelles. Toutefois, affirmer que les interventions humaines à elles seules peuvent complètement contrôler la nature ne reflète pas la force de cette dernière, qui persiste dans son refus de se plier aux désirs humains, comme lors de la campagne des quatre nuisibles de Mao Zedong à la fin des années 1950. Sans personne pour la défendre, la distinction entre nature et culture n’existe pas, ses limites sont mouvantes et contestées ; cette distinction est socialement créée, et sans cesse recréée.
La culture, une prison de sens ?
L’anthropologue Clifford Geertz, en s’inspirant de Max Weber, avance que l’humain est un animal pris dans une toile de significations qu’il a lui-même tissée, et que cette toile se nomme « culture ». Pour Geertz, la culture ne comporte donc pas de lois objectives et ne peut pas être testée à l’aide de la méthode scientifique. Il suggère plutôt que la seule façon de s’intéresser à la culture serait de l’approcher herméneutiquement, en l’interprétant. Devons-nous alors conclure que nous sommes prisonnier·ère·s de la culture ?
« L’anthropologue Clifford Geertz, en s’inspirant de Max Weber, avance que l’humain est un animal pris dans une toile de significations qu’il a lui-même tissée, et que cette toile se nomme ‘‘culture’’»
Jusqu’à un certain point, oui. Mary Douglas suggère, comme précédemment mentionné, que tout groupe social possède un système de classification de la réalité, et que lorsqu’un élément chamboule l’ordre de ce système, il est classifié comme étant « souillé », ce qui expliquerait en partie le fait que chaque groupe social avait déjà une notion de « propreté » et de « souillure » bien avant la découverte des germes. Nous sommes d’une certaine manière prisonnier·ère·s de nos cultures, en ce que les systèmes de classification de la réalité créés par les toiles de significations que nous tissons s’imposent à nous et influencent nos comportements.
En revanche, voir la culture strictement comme un système de classification propre à un groupe social défini peut s’avérer réducteur, car cette idée insinue que chaque groupe social détiendrait sa propre culture qui s’inscrit comme un tout cohérent aux limites sociales et géographiques claires. Comme le soulignent Akhil Gupta et James Ferguson dans leur essai Beyond Culture : Space, Identity, and the Politics of Difference (Au-delà de la culture : espace, identité, et les politiques de la différence, tdlr), accepter sans équivoque que chaque groupe social peut être associé à une culture définie selon un emplacement géographique ne reflète pas les réalités de plusieurs groupes sociaux.
« Peut-on affirmer que les hybrides postcoloniaux sont de ‘‘nouvelles’’ cultures à part entière sans décontextualiser les histoires coloniales ? »
En effet, cette idée exclut les habitant·e·s des régions frontalières et celles et ceux qui ont un mode de vie transnational ou nomade ; le concept de culture en tant qu’entité discrète et définie ne permet pas, par exemple, de représenter adéquatement le mode de vie des travailleur·se·s agricoles migrant·e·s qui passent la moitié de l’année dans un pays et l’autre moitié dans un autre. Délimiter une culture à l’aide d’une région géographique et d’un groupe social particulier ne tient non plus compte des différences culturelles au sein d’un même groupe social ; dans un monde de plus en plus mondialisé, les identités et les sentiments d’affiliation à certaines pratiques et groupes sociaux s’avèrent de plus en plus mouvants et contestés. Gupta et Ferguson soulignent aussi que les hybrides culturels postcoloniaux remettent en question la façon de concevoir la culture comme étant imperméable et associée à un lieu géographique précis ; peut-on affirmer que les hybrides post-coloniaux sont de « nouvelles » cultures à part entière sans décontextualiser les histoires coloniales ? Finalement, aborder les associations fréquentes, voire presque automatiques que nous avons l’habitude de faire entre groupes sociaux, emplacements géographiques et cultures délimitées permet de mettre de l’avant les diverses relations de pouvoir responsables des changements sociaux et culturels plutôt que de créer la fausse impression que ceux-ci sont principalement dûs à des dynamiques géographiques.
À quoi réfère donc la notion de culture ? Une catégorie arbitraire ? Un terme vidé de sens par la surabondance de ses acceptions ? Ou encore, lorsque nous envisageons la pluralité des cultures, une somme de réalités intersubjectives partagées par un groupe social ?
« Les rubriques de la section Culture au Délit formalisent elles aussi une certaine conception de la culture »
Notre façon limitée de percevoir la culture en tant que concept fixe, facilement défini, ne correspond pas à la réalité culturelle, qui est, quant à elle, mouvante, instable, et contestable. La culture dépasse les définitions uniques, mais cela ne devrait pas nous inciter à complètement la rejeter ou encore tenter d’arrêter d’y penser ; que nous le voulions ou non, le terme continue d’être utilisé pour discriminer et exclure certains groupes sociaux, mais il réfère aussi à toutes les formes d’arts et autres créations humaines et non humaines qui ont un pouvoir unificateur significatif.
Les rubriques de la section Culture au Délit formalisent elles aussi une certaine conception de la culture, en ce qu’elles sont caractérisées par la pluridisciplinarité du champ artistique. Or, il nous faut envisager la culture dans ses dimensions élargies et plurielles, sans toujours vouloir l’opposer à la conception peut-être fautive de ce que nous avons assimilé comme appartenant au « monde naturel ».