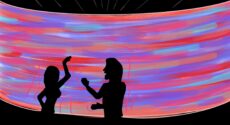Pourquoi sommes-nous là, assis dans l’obscurité d’une salle de théâtre, à attendre que quelqu’un s’adresse à nous, que le rideau s’ouvre et que le spectacle commence, quand nous pourrions au même instant combattre le capitalisme mondial ?
Cette question, qui semble incongrue au premier abord, est pourtant bien au coeur du solo de danse théâtral imaginé et interprété par le danseur-chorégraphe montréalais David Albert-Toth à l’Agora de la Danse du 2 au 5 novembre derniers.
Pendant une heure, l’homme danse, s’agite, provoque rires et essoufflement, transe et questionnement dans une double proximité avec le public : d’abord, parce qu’il passe son temps à s’adresser à lui directement, les yeux dans les yeux, dans un bilinguisme inégalable ; ensuite, parce que les fauteuils de l’Agora sont disposés sur une pente tellement abrupte que le public manque de s’écraser sur la scène au moindre mouvement. Contredisant son nom, la disposition de la salle envoie un message clair : ici, la danse est reine, le mouvement est roi, et le spectateur n’a qu’à bien se cramponner à son strapontin.
Cofondateur avec Emily Gualtieri de la compagnie Parts+Labour_Danse, David Albert-Toth est un danseur, chorégraphe et compositeur qui, depuis plus d’une décennie, multiplie les collaborations artistiques à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Parmi les nombreuses créations de sa compagnie, on peut nommer : In mixed company (2013), La chute (2013) et La vie attend (2017).
Le spectacle commence de manière assez inattendue, puisque, le rideau encore fermé, l’artiste s’installe à quelques centimètres de l’auditoire, nu sous un peignoir de soie, et entame, dans une fausse introspection, une vraie harangue anticapitaliste. Le ton du solo est donné : à la fois décalé et profond, drôle et incarné.
En réinterprétant le supplice de Tantale, condamné par les dieux à souffrir pour l’éternité d’une soif et d’une faim inextinguibles sans possibilité physique de pouvoir satisfaire ni l’une, ni l’autre, David Albert-Toth explore l’un des grands paradoxes humains : l’infinitude du désir et l’éternelle insatisfaction qui en résulte.
À l’époque moderne, cette frustration semble d’autant plus minable qu’elle est générée par des mécanismes de marketing et de publicité fort galvaudés. Il s’agit de reconsidérer toutes ces choses qui nous font envie et que l’on ne peut atteindre qu’« à bout de bras ».
Au paroxysme du spectacle, par exemple, le danseur épuisé, assoiffé, réclame au public une boisson gazeuse qu’il n’obtient pas. Alors il s’effondre, traîne son corps décharné tout autour de la scène. Mi-mendiant, mi-rappeur, il chante sa misère, sa frustration sans limite, et tout ce qu’il donnerait pour entendre s’ouvrir auprès de lui une canette de Coca-Cola. Dans cet instant, il aliénerait sa vie pour un lamentable coke. Au risque de déplaire à certains, À bout de bras semble parfois tenir davantage de l’improvisation, d’une expérience de transe inédite et personnelle, que d’un spectacle rigoureusement chorégraphié. Cette chorégraphie contradictoire, sans règle ni mesure, est aussi ce qui fait son charme et sa fraîcheur. Le spectateur se reconnaît sans difficulté dans cet individu contemporain que l’artiste singe, mime de manière frénétique et inspirée.
Au bout d’un petit moment, sans prévenir, on se laisse prendre à cette transe solitaire de l’homme moderne, et notre imagination nous joue des tours : les incantations répétées de l’artiste « tout est faux, all is fake » pour dénoncer l’illusion (du désir, de la vérité) nous interpellent. On en viendrait presque à mettre en cause la réalité de l’expérience qu’on est en train de vivre, à douter de l’existence même d’un homme sur scène.