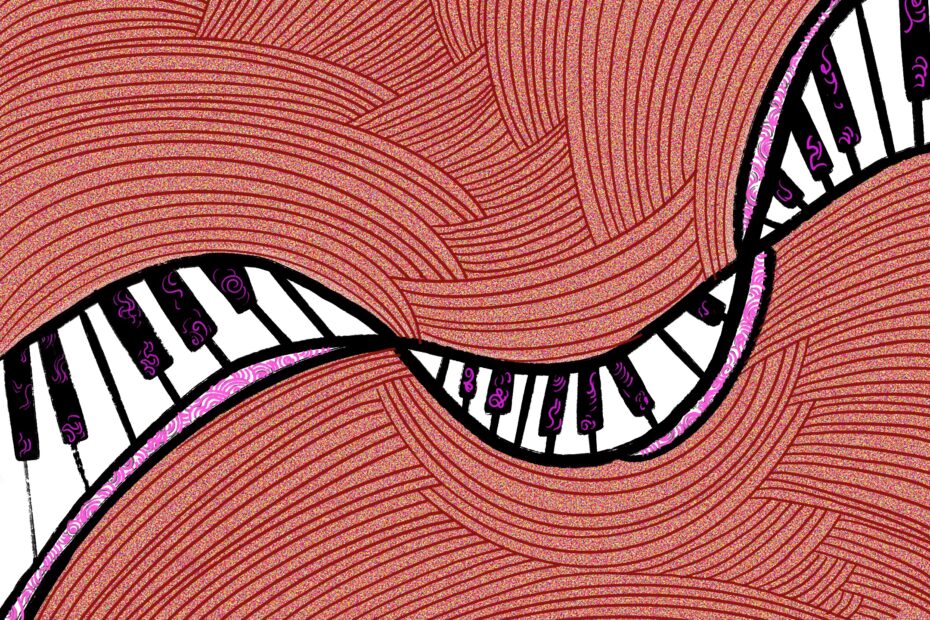En septembre, je me suis acheté un clavier à trois cents dollars afin de jouer mes partitions préférées. En parallèle, je me suis inscrit à une académie musicale montréalaise. J’ai réussi à convaincre mes parents de me financer la moitié des cours, m’acquittant du reste avec l’argent qu’ils me donnaient pour vivre.
Le piano me séduit depuis que je sais différencier le blanc du noir. Tout jeune, on m’a inscrit au conservatoire où je trainais mes doigts, trois fois par semaine, avec le même enchantement à chaque début de cours et la même frustration à chaque fin. À mesure que les années passaient, ce cycle répétitif a figé ma relation au piano dans un refrain d’éternelle lassitude. À quatorze ans, j’ai quitté le conservatoire pour m’ouvrir à des horizons plus séduisants. Entre les cours de mathématiques et mes premières ivresses, le solfège ne rythmait plus mon adolescence. J’avais procédé à une cure de désintoxication musicale, remplaçant toutes les musiques classiques de mon téléphone par du rap. Je parlais du conservatoire et des cours de piano comme on parle d’une relation brisée, d’un premier amour gâché. « C’était affreusement toxique comme relation ». « De toute façon, je crois ne jamais l’avoir aimé ». « J’aurais dû m’arrêter plus tôt ».
Puis, cet été, à force de concerts de piano et d’argumentaires en ostinato de mon oncle, qui pouvait répéter dans la même journée cinq fois les mêmes mots, dans le même ordre, avec la même intonation. Pour lui, la musique était une intarissable avenue de découvertes, qui m’offrirait plus de plaisir que n’importe quelle activité dans mon quotidien. J’y ai été sensible. Cette notion de plaisir me touchait particulièrement car elle me plongeait dans un état proche du souvenir amoureux. Pour la première fois, j’étais nostalgique du piano. J’avais l’impression de croiser mon premier amour au hasard dans la rue. Je savais que je ne résisterais pas à une nouvelle ballade avec elle.
Le clavier acheté et les cours organisés, je me lançai dans les tourbillons des clefs et des bacs à silence. Je jouais une heure par jour en rentrant de la bibliothèque et j’avais une heure de cours le lundi après-midi. Le premier mois fut excitant. Je retrouvai les tours dont mes doigts étaient capables. J’entendais les sons satisfaisants que les suites de caresses et de frôlements suscitaient. Après un si long interlude, le désir ressurgissait. Au bout du deuxième mois, pourtant, je retrouvais ses défauts : l’effort constant que cette amante exigeait, le temps qu’il fallait lui dédier, et puis l’insatisfaction rongeante qu’elle provoquait. Alors, j’ai commencé à me dire que je ferais plus d’heures de piano la fin de semaine pour rattraper celles que j’avais séchées pendant la semaine. Puis, j’ai arrêté d’aller à mon cours hebdomadaire, prétextant une trop grosse charge de travail.
Un jour, j’ai remarqué que notre canon s’était légèrement déplacé. J’avais initié la coda lorsqu’une fois je m’étais assis sur le siège mais dos au piano. Le clavier s’était intégré au décor en se fondant parmi tous les autres meubles. A suivi une cacophonie progressivement désagréable. Au lieu de travailler ma patience, je me suis épris de paresse reproduisant le schéma de la première rupture. Ennui, découragement, distraction, oubli, ressentiment, colère, diabolisation, indifférence : j’ai débranché le clavier. En écrivant ce texte, j’entends encore le triste decrescendo de notre séparation. « Le premier amour est toujours le plus pur ». « Nous avons chacun besoin de temps en solitude ». « Cette histoire n’est pas finie ».