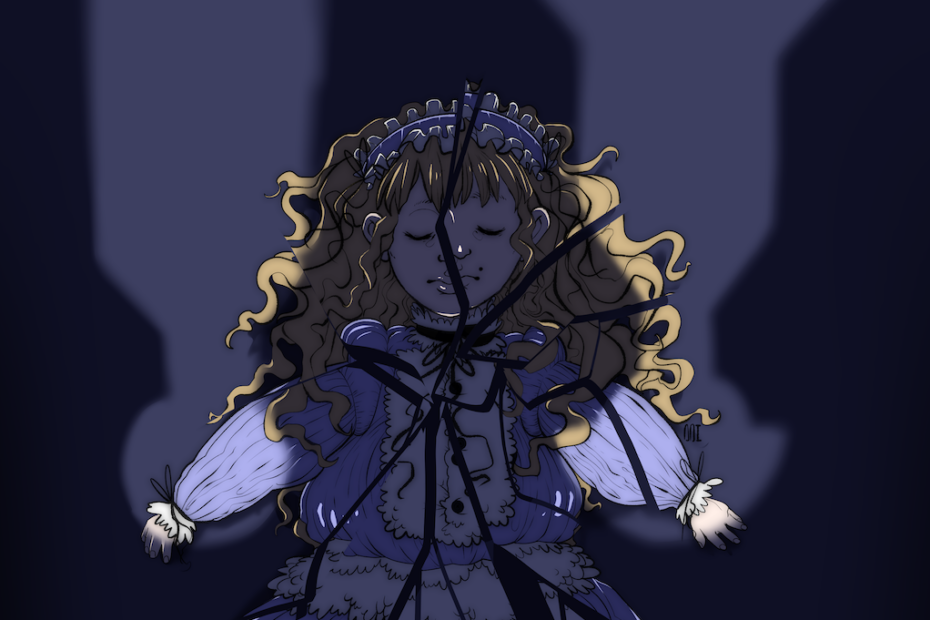C’est en 2019 que Marie-Pier Lafontaine publie Chienne, son premier roman, adapté de son mémoire de maîtrise. Les réactions sont immédiates : le roman se voit récompensé du Prix Sade en 2020, et devient finaliste du Prix littéraire du Gouverneur Général la même année. L’autrice québécoise explore les profondeurs de la violence familiale et la fragmentation de la mémoire traumatique à travers une écriture viscérale, hachurée, où chaque mot semble arraché à la rage qui habite la narratrice. J’ai eu la chance de la rencontrer et de m’entretenir avec elle lors d’un après-midi dans un café, où nos interactions ont été d’une grande richesse. Place à une discussion intime et riche, où Marie-Pier Lafontaine revient sur son parcours, ses choix stylistiques, et l’élaboration de Chienne, tout en levant le voile sur ses futurs projets.
Anouk Lefebvre (AL) : Comment la ponctuation et la phrase asyntaxique se sont-elles présentées à toi lors de l’écriture ? Est-ce venu naturellement dans les premiers moments d’écriture, ou est-ce plutôt un travail de la phrase qui s’est imposé plus tard ?
Marie-Pier Lafontaine (MPL) : C’est une question intéressante parce que c’est un mélange des deux. J’ai d’abord été formée en théâtre par la comédienne Rita Lafontaine. Un bon texte, pour elle, était un texte qui n’avait pas un seul mot de trop. Cette idée me parlait énormément. Il y avait donc déjà cette tension dans mon écriture : essayer d’être précise, concise et juste. Puis, au fil de l’écriture de Chienne, je me suis mise à hachurer la phrase de plus en plus. Comment pouvais-je essayer de montrer, dans la syntaxe ellemême et dans la construction de la phrase, la répétition de la violence ? Il y avait quelque chose de répétitif dans l’idée de la phrase courte et des hachures, qui rejoint un peu la question du coup de poing : comment arracher la violence des mains du père et la retranscrire dans l’écriture ?
Ce qui était important pour moi d’exprimer, c’est qu’il y a des conséquences aux violences commises par le père. Il pense qu’il crée des pures victimes, qui seront soumises et dominées, mais le langage qu’il apprend à ses enfants, c’est le langage de la violence. Nécessairement, il leur montre comment être violents et comment employer cette violence. Il ne pense pas, à ce moment-là, qu’elle sera utilisée contre lui parce qu’il se croit tout-puissant. Alors, l’écriture me permettait de dire : « Ah ah ! Moi aussi je suis capable de donner des coups ! » C’est dans cette esthétique du coup de poing que j’ai voulu écrire, mais ça ne s’est pas fait spontanément. Au fil du travail, de la réflexion et de toute la littérature que je lisais autour des théories et concepts féministes, j’ai pu trouver la bonne écriture. C’était la bonne forme et la bonne construction syntaxique pour ce sujet-là. J’ai écrit d’autres textes qui ne sont pas hachurés, parce que cette logique du coup de poing ne s’appliquait pas. La forme, pour moi, est vraiment reliée au sujet. Le livre que j’écris en ce moment n’est pas construit tout à fait de la même manière.
AL : Comment as-tu réfléchi au personnage de la mère lors de l’écriture ?
MPL : Le personnage de la mère a été le plus dur à écrire parce que je me posais beaucoup de questions sur la représentation et ce qui pouvait exister dans l’espace littéraire. Chienne est mon mémoire de maîtrise. Je me disais que personne n’allait le lire, mais il était tout de même important pour moi que sa représentation se fasse de manière éthique. J’avais lu un article qui portait sur le trauma, mais étudié d’une perspective féministe, et écrit par une psychologue qui venait des États-Unis dans les années 1980–1990 [Not outside the range : One feminist perspective on psychic trauma, Laura S. Brown, ndlr]. Elle mentionnait qu’on a souvent tendance à blâmer les femmes, lorsqu’il y a de l’abus sexuel commis par le père envers les enfants, dû à leur aveuglement volontaire.
Mais on ne peut pas tenir les femmes responsables des violences commises par les hommes. Dans mes convictions féministes, je suis bien d’accord, mais intimement, ma mère, je veux qu’on la tienne responsable de sa complicité. Alors j’étais coincée entre l’éthique féministe et mon propre féminisme ; comment je voulais le vivre et comment je voulais qu’il soit incarné dans ma vie intime. Ayant vécu ces abus là, j’ai le désir d’avoir justice, d’avoir droit à la dénonciation et à la colère contre cette femme-là.
Dans la représentation de la mère dans Chienne, au final, j’ai décidé d’écrire ce personnage en essayant d’être le plus impitoyable possible, tout en venant suggérer qu’elle aussi est victime du même homme que ses filles. L’accent est tout de même mis sur sa participation. Je voulais vraiment qu’on comprenne sa complicité. Je me suis dit qu’il y aurait un autre livre à écrire, et que dans cet autre livre, je pourrais alors complexifier le personnage de la mère. C’était vraiment compliqué, mais j’ai fait ce choix, et j’en suis contente. Je voulais une écriture assez radicale, directe, sans compromis, presque injuste, alors je voulais dépeindre la mère à partir d’un sentiment d’injustice et de mauvaise foi. La question de la représentation est vraiment complexe. Même si la mère est victime d’abus de violence conjugale sévères et répétés, il y aussi sa propre jouissance dans la situation. J’essaie de réfléchir, dans mon prochain roman, à comment la violence de son mari à l’égard de ses enfants la protège ; parce que pendant ce temps, elle ne vit pas de violence. Il y a aussi la question de la séparation entre femme coupable et femme victime. Elle ne peut pas être pure victime ou pure coupable, et c’est tout le chemin entre ces deux pôles que je trouve complexe.
AL : J’ai pu remarquer l’utilisation des déterminants « le » et « la » pour désigner le père ou la mère, ce qui me semble noter une distanciation et une réification des figures parentales. Pourquoi, à certains endroits, les déterminants possessifs ( « mon » et « ma » ) sont-ils utilisés ?
MPL : J’ai voulu utiliser « le » et « la » pour créer cette distance, pour que les parents soient nommés par leur fonction, que ce soit réducteur : c’est le père, c’est la mère, et c’est tout. Aussi, puisque je travaille près du réel, cette distance suscitée par les pronoms, elle me met à l’abri, dans le sens où les parents sont limités à leur statut de personnage. Mes parents existent dans le monde réel et sont de vraies personnes, avec d’autres enjeux que leur rôle de parent, mais ces personnes-là ne sont pas dans le livre. Je m’inspire du réel, mais la distanciation avec ma vie intime et la narratrice est importante pour moi. La narratrice, c’est la narratrice. Elle est créée et n’est pratiquement qu’un être de colère. Ce n’est pas moi, même si elle me ressemble beaucoup. Alors je pense que la distance avec les pronoms me protégeait de ma vie intime et créait une séparation entre le littéraire et le personnel.
Je pense que si « ma » ou « mon » se retrouvent dans le livre par moments, c’est parce que c’était naturel au moment de l’écriture. Je ne saurais pas te dire où j’ai écrit ces pronoms, précisément. En fait, je n’ai su qu’il y avait ces déterminants dans mon livre que lorsqu’il a été traduit en espagnol. La traductrice m’avait demandé si je voulais qu’elle laisse les « mon » et « ma » dans le texte et je lui avais répondu : « Mais il n’y a pas ces déterminants dans le livre ! », et elle m’avait confirmé que oui. Je ne le savais pas et je connais mon texte par cœur ! Si c’était à réécrire aujourd’hui, il n’y aurait pas de « mon » ou de « ma ».
AL : À un moment du récit, on voit le renversement de la parole et de l’écriture, c’est-à-dire que la parole de la narratrice, et non plus celle du père, devient toute-puissante, tandis que l’écriture manque à modifier le réel de la narratrice. Pourrais-tu me parler de ce renversement ?
MPL : C’est intéressant parce que cette scène du « non » de l’enfant m’est arrivée telle quelle dans ma propre enfance. C’est mon plus beau souvenir, j’étais tellement fière de moi. Il y avait quelque chose de tellement immense dans ce mot-là. Finalement, ce qui est si marquant de ce « non », c’est que le père part enfin. Je pense que je le regardais avec tellement de confiance, avec défiance presque. « Vas‑y, saute-moi dessus, on va voir ce qui va se passer. » Je l’aurais dénoncé, je serai partie. Il y avait quelque chose de tellement radical en moi, que même lui, il l’a perçu.
Dans mon essai Armer la rage, je parle de cette banalisation des événements violents par les individus qui la perpétuent ; ils reprennent le langage à leur compte, et la victime de cette violence perd l’espace d’énonciation. Avec mon « non », il y a eu un renversement. Mais il y avait également cette inquiétude qui persistait face à l’insuffisance de l’écriture parce qu’au final, le fait de dire non ne sauve pas l’enfant. C’est un moment de victoire, où soudain, le père se rend compte que l’enfant n’est pas totalement impuissante. Mais il revient. Et je pense que c’est peut-être ce que l’inquiétude représente : ce moment ultime dans la vie de l’enfant, qui s’avère insuffisant. La violence recommence. Si la colère de l’enfant qui dit non a été suffisante pour chasser le père, mais pas assez pour l’empêcher de revenir, serait-ce possible d’avoir une écriture qui le tue ? Soudain, on dirait que le langage manque. Je pense que ces deux moments se sont articulés de cette façon dans l’écriture, mais je n’avais jamais réfléchi à cette inversion.
AL : Crois-tu que l’écriture a réussi à t’émanciper de cette violence ?
MPL : Je pense que oui, à cause de la liberté et la reprise en charge de cette violence par l’écriture. Le choix des mots est vraiment important pour moi. Ce qui me fait le plus violence dans ma vie, c’est lorsqu’on me fait dire quelque chose que je n’ai pas dit, quand on n’utilise pas les bons mots, ou lorsque je raconte un événement et qu’on le raconte autrement ensuite. On m’a tellement dit de me taire, que j’étais folle, que ce n’était pas arrivé, que c’était dans ma tête, que c’était légal au Québec de battre ses enfants. Or, dans l’écriture, il y a une reprise en charge. C’est moi qui choisis les mots. Même lorsque l’écriture est de la pure fiction, c’est moi qui rends l’histoire avec le plus de justesse possible. Ce geste m’ancre énormément dans le réel, même dans le cas de la pure fiction. C’est là que je sais qui je suis. Personne ne peut m’enlever ça.
AL : L’écriture renverse totalement la parole supposée toute-puissante du père, n’est-ce pas ?
MPL : Du père qui possède le langage, oui. C’est le langage qui est utilisé pour violenter, réduire et écraser. Mais la littérature ne sert pas à réduire ou à écraser, parce que ce n’est pas le but du langage. En tout cas, pas dans la question esthétique, même quand on aborde ces violences. J’essaie d’atteindre une certaine beauté par la justesse de la phrase et de l’émotion. Pas pour écraser qui que ce soit, mais pour dénoncer. Lorsqu’on dénonce, c’est pour s’émanciper et essayer d’avoir un minimum d’impact social, ne serait-ce que sur une seule personne, par la littérature. Donc, il y a le pouvoir de la parole dans cette reprise en charge, le pouvoir de faire mieux. Je cherche à m’éloigner le plus possible de ma famille, de cette logique de la violence, et la littérature m’y aide. Changer de nom m’y a aidée. L’instruction m’y aide également ; on organise et on nuance notre pensée. Dans la violence, il n’y a pas de nuances, il y a une radicalité dans le franchissement de toutes les limites et de tous les interdits. Je veux tenter d’intégrer cette part de nuance dans mes prochains romans.
AL : Et pourquoi représenter la parole en italique, la rapporter telle quelle ?
MPL : Je voulais qu’il y ait un contraste. Quand j’ai lu Histoire de la violence d’Édouard Louis, je trouvais que souvent, lorsqu’il donnait à lire la parole de sa sœur, il y avait un contraste dans la forme. C’était plus près de l’oralité que de l’écriture. Je voulais qu’il y ait ce genre de contraste dans la parole du père et de la mère. Je voulais qu’on l’entende, qu’il y ait un clash entre la forme esthétique de l’écriture et la parole, qu’elle soit donnée dans toute sa vulgarité, toute son oralité, afin de créer une plus grande distance.
La littérature donne du vocabulaire, du langage ; on a accès à des mots plus scientifiques, à des notions et des concepts. Je viens d’un milieu très pauvre aussi bien financièrement et émotionnellement qu’intellectuellement. Cela peut sembler élitiste, mais je pense qu’avoir une maîtrise du langage, mieux parler et moins « sacrer » sont des manières de m’éloigner de ma famille. Dans la littérature, je peux le faire en rapportant la parole telle quelle, en demeurant très près du langage. Non pas pour signaler une pauvreté, mais pour amplifier ce clash entre la parole et l’écriture. C’est ce que j’essaie de travailler, non pas pour mépriser l’oralité en général, mais plutôt pour distancier la voix narrative de la parole des parents. Leur parole en est une qui sert à violenter des enfants. Je veux m’en distancier le plus possible, sur toutes les dimensions.
Si Chienne a marqué par son écriture coup de poing, les prochains textes de Marie-Pier Lafontaine s’annoncent tout aussi percutants. Elle travaille désormais sur son doctorat en recherche-création dans lequel elle y complexifie la figure de la mère. Plus nuancée, mais toujours radicale, son écriture continue d’explorer des zones sombres, avec une lucidité implacable et un désir d’émancipation profonde, que l’écriture lui permet de transmettre.