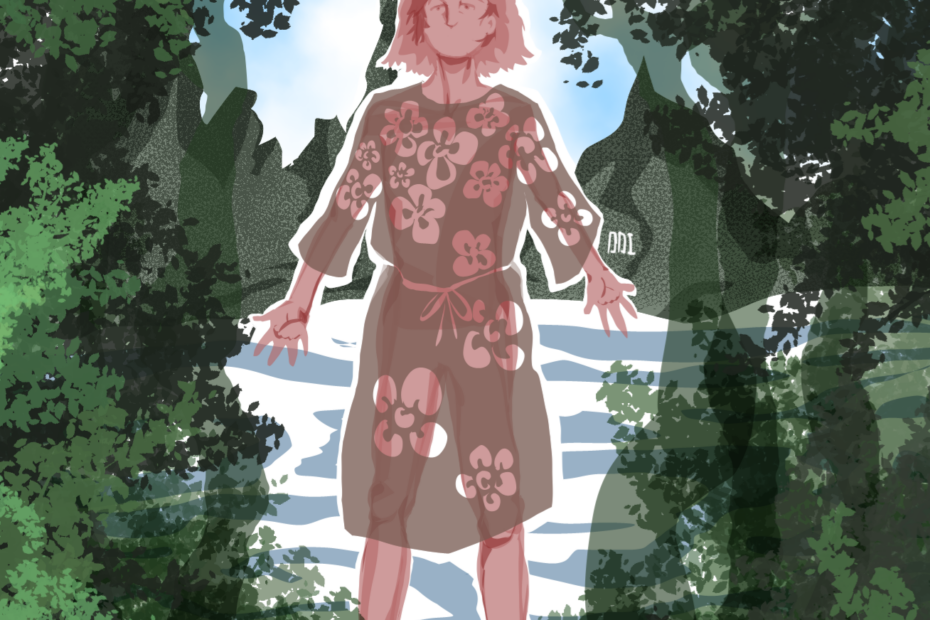L’adaptation théâtrale de Kukum, le roman acclamé de Michel Jean, fait une entrée remarquée sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), portée par la vision audacieuse d’Émilie Monnet. Ancrée dans la culture innue, la pièce se veut un hommage vibrant à la mémoire et à la résilience d’un peuple. Si l’intention est noble et l’exécution visuellement saisissante, le spectacle peine parfois à tenir la promesse de son ambition, avec une narration qui vacille et un rythme parfois déroutant.
Un hommage sonore et visuel
Dès le lever de rideau, l’univers innu se déploie avec éclat grâce à la scénographie immersive de Simon Guilbault. La mise en scène d’Émilie Monnet s’entoure d’une équipe où les voix autochtones brillent non seulement sur scène, mais aussi en coulisses. Les costumes riches en symbolisme conçus par Kim Picard, et les projections d’archives mêlées à l’art visuel de Caroline Monnet plongent le spectateur dans le monde innu, magnifiant les paysages et les traditions évoqués par le texte. Les chants et dialogues en innu-aimun, une première sur la scène du TNM, résonnent comme un puissant acte de réappropriation culturelle. Cependant, ces moments de grâce sont parfois interrompus par des failles techniques – micros défectueux, sous-titres mal synchronisés – qui viennent rompre la fluidité de l’expérience.
Une narration éclatée
L’histoire s’ouvre sur la rencontre entre Almanda et Thomas Siméon, un chasseur innu qui devient son époux. Ce point de départ, d’apparence classique, laisse entrevoir une intrigue centrée sur l’évolution de leur relation. Pourtant, la pièce prend une direction plus fragmentée, où les souvenirs d’Almanda s’entrelacent aux récits ancestraux, tissant une trame davantage poétique que narrative. Loin d’une progression linéaire, le récit évolue au rythme des saisons et des légendes, reflétant une conception du temps propre à la culture innue, où mémoire collective et récits oraux l’emportent sur une structure dramatique conventionnelle.
La poésie comme souffle identitaire
La poésie de Joséphine Bacon, omniprésente dans cette adaptation, transcende la scène. En collaborant avec Laure Morali, Bacon insuffle une force lyrique au texte, conférant à l’innu-aimun une gravité et une beauté rarement entendues sur une scène québécoise. Ce faisant, la langue devient un outil de résistance et de réaffirmation de l’identité innue, un geste qui défie l’hégémonie culturelle et revendique la légitimité de cette culture sur la scène nationale.
C’est dans cette relation, portée par une chimie palpable, que le concept du « chez-nous » prend vie : un espace d’appartenance, et non de propriété.
Le territoire comme chez nous
Au cœur de la pièce, une opposition fondamentale se dessine entre la vision innue du territoire – espace partagé et respecté – et celle imposée par le colonialisme, réduisant la terre à un objet de possession et d’exploitation. Avec délicatesse, la pièce illustre la vie nomade des Innus, un « chez- nous » immatériel façonné par une relation harmonieuse avec la nature et une langue vivante, en contraste brutal avec la violence de la sédentarisation.
L’histoire d’amour entre Almanda et Thomas Siméon – interprétée avec justesse par Étienne Thibeault et Léane Labrèche-Dor – sert de point d’ancrage pour explorer ces thèmes. Si Labrèche-Dor livre une performance sincère, elle peine parfois à transcender les contraintes du texte pour en extraire une intensité dramatique plus viscérale. Leur union, bien que teintée d’idéalisme, incarne une alliance symbolique entre deux mondes tout en interrogeant ce que signifie réellement habiter un territoire. C’est dans cette relation, portée par une chimie palpable, que le concept du « chez-nous » prend vie : un espace d’appartenance, et non de propriété.
Avec Kukum, le Théâtre du Nouveau Monde marque un jalon important pour le théâtre québécois, une ode à la mémoire, à la langue et à l’amour, un rappel puissant que le passé colonial continue d’imprégner notre présent. Une invitation à réimaginer notre propre rapport au territoire, et à reconnaître la sagesse des voix autochtones qui, aujourd’hui plus que jamais, éclairent notre avenir collectif.