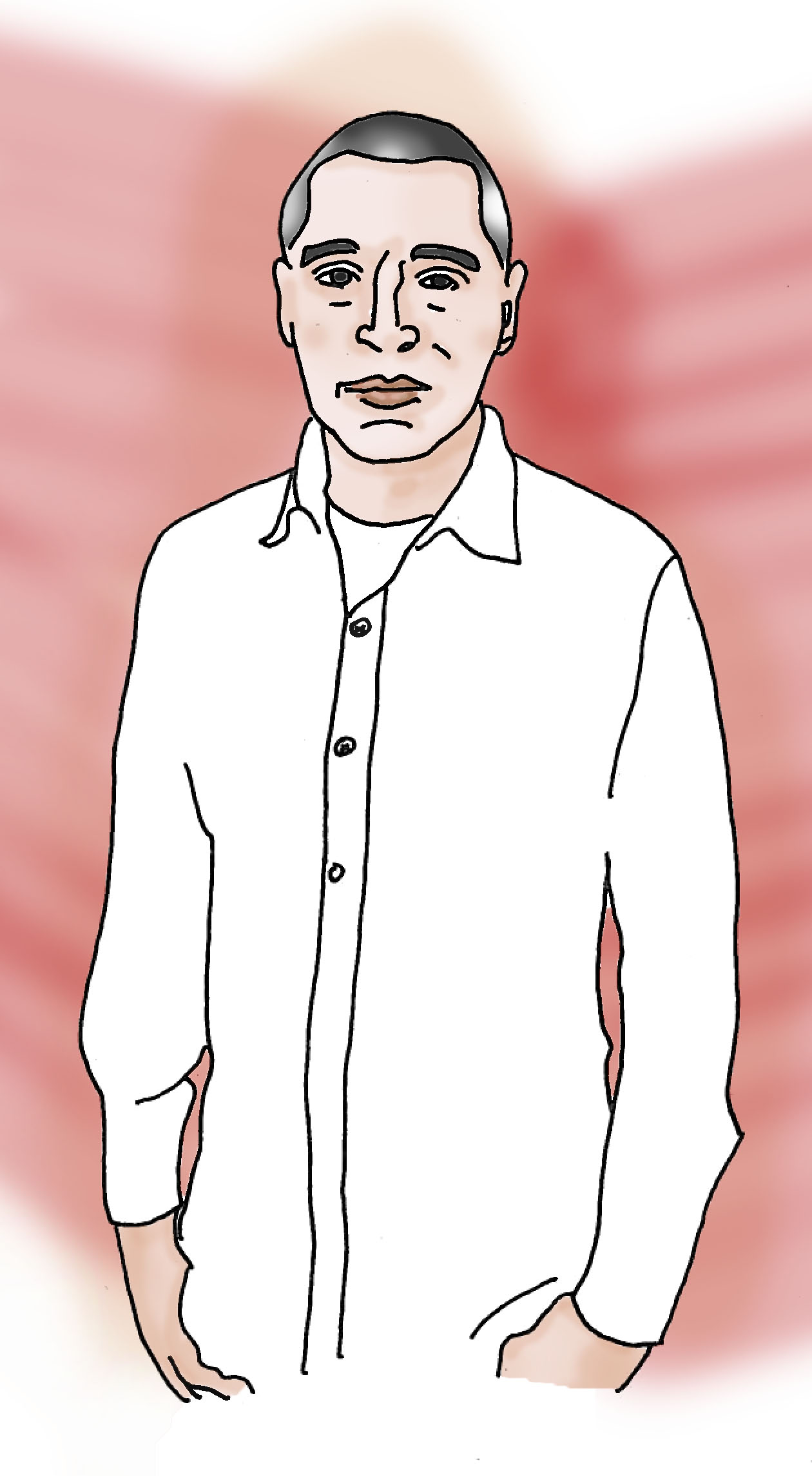Auteur de La coopération franco-québécoise dans le domaine de l’éducation : De 1965 à nos jours (2014, Septentrion). Titulaire d’un doctorat de l’Université Paris-VIII et de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), Samy Mesli enseigne au Département de science politique de l’UQÀM. Auteur de nombreux articles scientifiques sur les relations internationales du Québec et du Canada, il a également codirigé un ouvrage sur Hector Fabre, premier représentant diplomatique du Québec à Paris.
Le Délit (LD): La signature de l’entente de coopération du 27 février 1965 constitue un précédent historique pour le Québec qui, de facto, inaugure sa participation au forum diplomatique international. Serait-il possible de surestimer l’importance de ces accords dans la « francisation » de la conscience nationale québécoise ? Qu’est-ce qui se dégage, pour vous, des répercussions identitaires de la coopération ?
Samy Mesli (S. M.): D’une part, ce qu’il faut constater c’est que la signature est bel et bien historique : il s’agit du premier accord signé par le gouvernement du Québec avec un interlocuteur étranger. C’est la base sur laquelle va reposer la paradiplomatie québécoise – paradiplomatie, c’est-à-dire les relations internationales des entités subnationales comme les provinces canadiennes, les länder allemands, etc. D’autre part, cette signature est à la base de la coopération entre la France et le Québec. Les premiers organismes bilatéraux sont d’abord mis en place à partir de la coopération en éducation ; ils se diversifieront ensuite.
Assurément, la coopération a contribué à la réalisation de politiques linguistiques au Québec. Un cas mérite d’être évoqué : la signature des accords Bourassa-Chirac en décembre 1974, qui va permettre l’implantation du programme « francisation des ateliers et laboratoires scolaires ». C’était quelques mois après que Bourassa a décidé d’adopter la célèbre « loi 22 » pour la francisation des milieux professionnels. Quel était le constat de Gaston Cholette, qui dirigeait à l’époque l’Office québécois de la langue française ? C’était que dans les domaines techniques, la plupart des employés travaillaient en anglais, que toute la littérature technique était en anglais ! L’objectif du gouvernement québécois était alors d’aller chercher une expertise en France, en important des termes francophones. Ainsi, 1 836 professeurs et administrateurs scolaires québécois ont bénéficié d’un stage en France dans le cadre des accords Bourassa-Chirac, soit environ 20% de professeurs de l’enseignement technique au Québec – chiffre non négligeable.
LD : Aux débuts des échanges, il était surtout question d’une formation que la France offrait au Québec : les instituteurs, enseignants, cadres ou ingénieurs français partaient former les Québécois tandis que ces derniers étaient plutôt reçus en stagiaires. La cooptation des accords de 1965 serait-elle sous-tendue plus par une politique latente d’assimilation (on pense au « Les Français du Canada » gaulliste) que par une volonté de coopération paritaire ?
S. M.: Est-ce que de Gaulle avait vraiment une politique d’assimilation ou des visions oserais-je dire annexionnistes quant au Québec ? Non ; la France n’avait plus les moyens de rayonner à l’international si ce n’est que par la coopération. Dans ses toutes premières années, il y a eu une volonté de la France d’aider le Québec en lui faisant profiter de son expertise en éducation, là où les besoins étaient criants – le Québec, en 1965, était demandeur dans le domaine de l’éducation. Rappelons-nous que le ministère de l’Éducation du Québec a été créé un an plus tôt ! En 1964, c’est une tâche immense à laquelle s’attaque Paul Gérin-Lajoie. On réforme l’éducation secondaire, on créé les polyvalentes, les cégeps (qui ouvrent en 1967), l’Université du Québec (qui ouvre en 1969); l’enseignement en maternelle était squelettique… les réformes à mener étaient colossales. À cette période, le Québec avait un besoin considérable de main d’œuvre et d’expertise ; c’est vers la France qu’il s’est naturellement tourné. Celle-ci avait une oreille très attentive – c’est le cas de de Gaulle, bien sûr – aux demandes du Québec. S’il est vrai que dans les premières années, il est plutôt question d’une action de la France, force est de constater que ce mouvement va s’équilibrer, particulièrement dans le cadre du programme de jeunes maîtres où là, ce sera vraiment une volonté du paritaire – du poste pour poste. Ce ne sera pas long avant que l’unilatéralisme devienne un bilatéralisme institutionnalisé.
LD : Avec la situation de départ, je ne peux pas m’empêcher d’imaginer un « King-Kong » français tenant sa belle québécoise sans défense en affrontant les « avions » de l’assimilation anglophone ! Combien de temps cette institutionnalisation du bilatéralisme a‑t-elle pu prendre ?
S. M.: Cela se fait d’initiative en initiative, mais très rapidement. À partir de 1973, on met sur pied des projets intégrés qui sont décidés par les universités. Par contre, au début, il y avait effectivement ce sentiment de besoin, d’urgence auquel la France a répondu pour soutenir les réformes et le développement du système scolaire au Québec. Je pense notamment aux jeunes coopérants militaires, les Volontaires de Service National Actif qui ont été 1500 à venir enseigner dans les universités québécoises parce qu’on créait des départements entiers. Il y avait quatre ou cinq profs, trois ou quatre coopérants… et c’est par là qu’on a mis sur pied des départements !
Question de mettre les choses en perspective, il est intéressant de noter que bien des modèles de la coopération France-Québec ont été copiés sur ceux de la coopération franco-allemande. L’Office franco-québécois pour la jeunesse a été créé sur le modèle de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, par exemple. Le fait de s’inspirer de l’Allemagne – et de Gaulle a été le pilier de ce rapprochement – démontre l’importance qu’a pu avoir le Québec dans la pensée des dirigeants français.
LD : Le Québec, homologue de l’Allemagne ? On comprend que la coopération franco-québécoise ne se soit pas développée sans générer un certain inconfort à Ottawa. Par exemple, vous relevez un incident diplomatique. Lorsque Jean Lipkowski, en visite diplomatique à Québec en 1969, refuse de se rendre aussi à Ottawa, Trudeau le qualifie « d’insolent ». Pompidou reçoit la dépêche et, froissé, émet un communiqué qui se termine par « Jusqu’à nouvel ordre, nous ignorons Monsieur Trudeau ». Hormis les histoires de bouderies passagères, comment s’est développée la complexité des relations tripartites que ces accords posent entre Paris, Ottawa et Québec ?
S. M.: Ottawa n’a jamais vraiment accepté – surtout avec le combat Trudeau-Lévesque – que Québec ait des relations diplomatiques distinctes avec Paris. Celle-ci entretient des relations indépendantes avec Ottawa et avec Québec. Pour Trudeau, cela est hérétique, contraire au droit international.
Dans la genèse des accords de 1965, Ottawa n’avait pas mis de barrières puisqu’il se négociait en même temps un accord culturel franco-canadien. Dans la tête des représentants fédéraux, il était clair que l’entente France-Québec n’entrerait officiellement en vigueur qu’avec la signature France-Canada. Tout cela s’est fait au grand jour. Raymond Bousquet, ambassadeur de France à Ottawa, appelle le ministère des Affaires extérieures à Ottawa en leur disant qu’il négocie un accord avec le Québec pour faciliter les échanges d’enseignants, ce à quoi Ottawa répond « pas de problème ». Au départ, ça c’était vu uniquement comme un accord technique négocié entre fonctionnaires. Or, Ottawa n’a jamais réussi à contrôler la coopération franco-québécoise, et Paris a toujours maintenu une cloison étanche dans ses activités avec Québec et le reste du Canada.
Ce n’est qu’en 1984 avec le gouvernement de Brian Mulroney que les tensions au sein du triangle Paris-Québec-Ottawa vont s’apaiser. Mulroney reconnait officiellement la relation particulière du Québec vis-à-vis la France, ouvrant ainsi la porte à sa participation au sein du sommet des chefs de la Francophonie en 1986, dossier enlisé depuis 15 ans.
LD : Encombrante chicane ! Dans l’actuel, le président Hollande est de passage au Canada afin, entre autres, de renégocier les modalités de cette coopération en éducation. Vous pourrez assurément approfondir cette question lors d’une conférence le 3 novembre 2014, mais quant au futur, sauriez-vous commenter brièvement la pertinence de cette coopération ?
S. M.: Le Québec et la France y gagnent d’entretenir des liens de coopération ; ils ont gagné par le passé et ils y gagnent encore aujourd’hui. C’est un partenariat dynamique et innovant, tout à fait branché sur les enjeux actuels. En plus de témoigner d’un très bon bilan par le passé, ça reste quelque chose de très – je ne dirais pas capital, mais très nécessaire pour le Québec. Au plan politique et diplomatique, la France demeure le principal partenaire du Québec. S’il est vrai que le nombre toujours plus élevé d’étudiants venus de l’Hexagone à s’inscrire dans les universités québécoises peut susciter des polémiques, le Québec est une terre d’immigration. Les Français débarquent, et s’y sentent souvent très bien. Encore une fois, le Québec ne doit pas oublier l’intérêt de sa relation avec la France, et les acquis réalisés sur la scène internationale. C’est primordial. Il s’agit désormais de s’appuyer sur les fondements de cette relation et d’explorer les besoins et les complémentarités des deux sociétés pour qu’elles adoptent, ensemble, de nouvelles avenues pour leur coopération bilatérale.