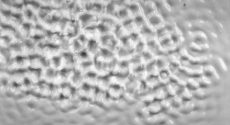Jules Gauthier, 23 ans, aspirant photo-journaliste, raconte son expérience au Liban et en Syrie. Alors que le spin médiatique bat son plein, que la Syrie entrait dans sa cinquième année de guerre le quinze mars, Jules confie au Délit ses impressions et met des mots sur les images qu’il a rapportées.
Le Délit (LD): Bonjour Jules, je suis tombée sur cette photo (trois jeunes et un fusil) et je me suis demandée si tu pouvais m’expliquer un peu le contexte dans lequel tu l’as prise ?
Jules Gauthier (JG): C’était en décembre 2013, dans la ville de Tripoli, la deuxième plus grosse ville du Liban. C’est une ville où il y a souvent eu des affrontements armés entre les sunnites et les alaouites donc c’est un peu le conflit syrien qui se déplace au Liban. Les alaouites qui supportent le régime de Bachar el-Assad affrontent les sunnites qui supportent la rébellion en Syrie. Quand il y a des combats en Syrie, ça déclenche souvent des combats à Tripoli. Ces enfants-là, toute la série sur Tripoli en fait, c’est avec ceux qui supportent la rébellion, les sunnites. C’était dans le quartier de Bab al-Tabbaneh, là où les affrontements ont souvent lieu dans cette grande ville du Nord du Liban. Cette photo-ci a été prise après une nuit où il y avait eu des combats entre les deux groupes, en milieu d’après midi dans un des souks de la vieille ville de Tripoli. Les combattants se reposaient sur des sofas et leurs enfants, ou les enfants du quartier, étaient en train de nettoyer et recharger les armes,.J’ai trouvé ça assez surréaliste : quand on habite en Occident, on n’est pas habitué de voir des enfants de onze ou douze ans nettoyer des mitrailleuses et charger des fusils tandis que sporadiquement, au loin, des tirs de sniper se font entendre. Le gros des combats se passe souvent durant la nuit, mais tout le monde reste chez soi, parce [que] les snipers sont quand même en action le jour. Si tu traverses une rue sans faire attention, tu peux te prendre une balle dans la tête.
LD : Mais comment t’es-tu retrouvé là-bas ?
JG : Je suis parti en échange pendant un an. J’étudie les sciences politiques à l’Université de Montréal et j’ai choisi d’aller à Beyrouth, à l’Université Saint-Joseph, fondée par des jésuites francophones. Il y avait environ moitié moins d’étudiants étrangers cette année-là, à cause des conflits. La majorité des étudiants en échange viennent de France, j’étais le seul Québécois, même le seul Canadien.
LD : Tu vivais à Beyrouth mais tu prenais des photos à Tripoli ?
JG : Je vivais dans un appartement pas trop loin de la gare routière. Tous les jours je regardais les infos et si je voyais qu’il y avait un affrontement [il claque des doigts], ou « ça pète », « il y a de la tension », je prenais mon appareil photo, je sautais dans le bus et je fonçais… Si je n’avais pas de cours. Bon, parfois j’ai manqué des cours, comme tout le monde… Tu débarques du bus et t’entends des mitrailleuses qui tirent partout, c’est… c’est assez étrange. Tout le monde connait un peu la situation là-bas, Tripoli c’est très facile d’accès, à seulement à 80 kilomètres de Beyrouth. Tu peux y aller comme ça [il claque des doigts]. C’est difficile, par contre, de trouver des contacts. Un jour, en me promenant dans le souk, j’ai rencontré un vieux monsieur auquel j’ai expliqué que je voulais prendre des photos des combattants, de ce qu’il se passait à Tripoli. Et puis il m’a répondu : « oui, moi même je suis un ancien combattant, viens je vais t’amener. » Il m’a fait rentrer dans des quartiers où normalement on ne peut pas trop aller comme ça avec un appareil photo.
LD : Et tu restais dormir à Tripoli ?
JG : Je partais le matin de Beyrouth, ça prenait deux heures pour aller jusqu’à Tripoli. J’arrivais vers midi, je faisais mes photos et je repartais vers huit heures le soir dans un petit bus. Des fois, quand je prenais des photos plus tard le soir ou la nuit, je dormais dans une auberge à Tripoli, ça coutait quinze piaces la nuit. Je me débrouillais, c’est assez accommodant quand même.
LD : Il y avait beaucoup de monde qui allait prendre des photos ?
JG : Non, non. Enfin il y a beaucoup de photographes qui y ont été mais, personnellement, je n’en ai pas croisé pendant que j’y étais. Tripoli, ce n’est pas un sujet très original, mais c’est une façon de faire ses armes un peu. C’était un conflit quand même contenu dans une ville, même s’il y a parfois des affrontements dans d’autres villes du Liban, ça reste assez localisé. Après j’ai été en Syrie.
LD : Ce weekend, la Syrie entrait dans sa cinquième année de conflit, comment c’était quand tu y es allé, en janvier 2014 ?
JG : J’y suis allé dans un contexte assez particulier. La plupart des journalistes qui ont couvert le conflit l’ont fait du côté de la rébellion. Ils sont entrés illégalement sur le territoire via le Liban ou la Turquie et ont rejoint les groupes rebelles qui affrontaient le régime syrien. Aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus compliqué de couvrir cette guerre syrienne, les risques d’enlèvement sont beaucoup plus grands à cause de la présence de l’État islamique et les groupes djihadistes se sont multipliés. Moi j’ai pris des photos de l’autre côté. Je ne prends pas du tout parti dans cette guerre-là, j’ai mes propres idées là-dessus. Je l’ai fait d’un point de vue journalistique, photographique. Quand tu fais de la photo journalistique, peu importe le côté où tu vas, tu le fais pour documenter. J’ai été du côté de Bachar el-Assad, j’avais des contacts via une organisation humanitaire. On a obtenu des visas, on a été logés, nourris et on se déplaçait avec l’armée pour éviter tout enlèvement. Nous étions avec SOS chrétiens d’Orient qui allait porter des cargaisons de vêtements, de jouets et de vivres aux différentes communautés religieuses à Damas. Pendant qu’on se déplaçait, je prenais des photos. Je n’étais pas là en tant que journaliste : le régime surveille qui prend des photos sur le territoire, ça reste un régime autoritaire. Je n’avais pas le droit de photographier des soldats et des installations militaires.
J’essayais d’être discret même quand je prenais des photos de gens dans la rue. La photo des enfants qui dansent en rond a été prise dans un orphelinat près de Damas.
LD : Et l’interaction avec les civils, c’était comment ?
JG : Dans un régime autoritaire, les gens se sentent surveillés. Si quelqu’un parle en mal du régime, les policiers peuvent arriver chez lui et l’arrêter. Si par exemple, je me balade dans la rue et que je demande à un commerçant dans sa boutique : « Et puis, toi tu penses quoi du régime ?», il y a peu de chance pour qu’il me réponde. Il y avait une tension, l’ armée nous surveillait, on se déplaçait mais on ne pouvait pas vraiment entrer en contact avec les civils syriens.
LD : Ta perception des choses a‑t-elle changée ?
JG : À propos des camps de réfugiés syriens au Liban, avant d’y aller, je voyais les nombres dans le journal. Des chiffres, ok, on en voit chaque jour… C’est horrible mais sans plus. Quand tu arrives dans le camp et que tu vois des gens qui s’entassent dans des tentes, au milieu d’un paysage presque désertique à la frontière entre la Syrie et le Liban ; qu’il fait 40 degrés dans leur tente le jour et 2 degrés la nuit ; qu’ils ont pas une cent ; que les enfants vont pas à l’école ; que les parents ont pas de travail… et que t’es là, toi, petit occidental avec ton Canon 5D, ça fait un peu cliché mais ça te donne un coup. Pour vrai, ça fesse pas mal.
Quand je reprenais la voiture après, pour retourner chez moi à Beyrouth, ça faisait un peu comme après un film qui t’a bouleversé, tu ne dis pas un traitre mot.
LD : Et quand tu reviens ici, que tu te retrouves au milieu des autres étudiants montréalais, tu te sens comment ?
JG : C’est un retour à une vie où on a aussi nos propres problèmes, c’est sûr, c’est pas les mêmes… Je n’ai pas oublié ce que j’ai vécu, j’ai envie d’y retourner pour documenter les choses. Oui, ça a changé une certaine partie de moi, une certaine perception mais ça va pas non plus m’empêcher de vivre ma vie, moi aussi j’ai le droit de m’amuser, de lire… mais toujours en sachant que… oui ça a changé quelque chose, je regarde plus les infos pareil. Ici, les gens s’en fichent de la Syrie…
LD : Ce weekend, tout le monde en parle.
JG : Oui, et dans deux semaines on n’en parle plus. On parle de l’État islamique mais pas du régime de Bachar el-Assad. On parle des décapitations, pendant ce temps là, ailleurs dans le pays, il y a des combats qui continuent et des civils qui payent le prix fort : des barils de bombes, des attentats, des enlèvements…
LD : Si on te proposait d’y aller sans appareil photo, tu partirais quand même ?
JG : J’en serais incapable aujourd’hui, je dois avoir mon appareil photo. Ne serait-ce que pour un voyage, même si c’est pour aller voir la famille dans une autre ville, tu te promènes dans la rue et tu vois un truc, [il claque des doigts] hop, tu l’as ! Maintenant que j’ai mon appareil photo et que je m’investis dans cette pratique, que j’espère un jour être photographe, je ne peux pas me permettre d’en manquer une, c’est trop frustrant. Je me rappelle encore d’une scène que je n’ai pas réussi à photographier parce que mon appareil était au fond de mon sac ! Non vraiment, je ne pourrais pas. Pour moi, le voyage et l’étranger sont vraiment associés à la photographie.
LD : Tu as dis que tu voulais y retourner, ce serait quand ?
JG : Je vais essayer d’y retourner en août, mais mes parents ne sont pas très chauds pour que je retourne en Syrie. J’aimerais aller faire une sorte d’état des lieux après cinq ans de conflit pour documenter sur les relations entre les différentes communautés, la reconstruction du pays, la formation des milices locales et d’autres sujets comme ça.
LD : C’est vraiment ta passion alors ?
JG : J’ai toujours été intéressé par les conflits armés : le pourquoi, le comment, les destructions. Je ne pense pas pouvoir répondre un jour, mais je me demande pourquoi les humains continuent à s’entretuer. Ça m’attire. C’est proche parce que sur internet on a accès à plein de choses, mais en même temps ça parait tellement loin de notre monde et c’est juste à sept heures d’avion tout ça. Même si je suis profondément athée, je voudrais pouvoir comprendre les rouages des religions et les tensions entre les différentes communautés. Pour moi, c’est à la fois fascinant et absurde quand je pense à quel point ça peut faire des ravages.
LD : Y‑a-t-il une leçon que tu as tirée de ce que tu as vécu là-bas ?
JG : Il faut vraiment être sur le terrain pour mesurer la chose. Il ne faut pas se fier toujours aux informations, aux journaux qui se nourrissent de sensationnalisme. Ça peut paraitre ironique parce que moi, ce que je ramène, c’est de l’information, mais il faut y aller pour voir. C’est du fragile équilibre entre sensationnalisme et documentation dont il est question quand on parle de ce qui se passe à l’étranger, surtout en temps de guerre.