« À dix-neuf ans, Juliette n’est pas en phase avec les garçons de son âge. C’est alors qu’elle rencontre Victor, le nouveau professeur de philosophie. Partagés entre amour et raison, ils tenteront d’échapper à l’évidence de leurs sentiments. » Tant de films, livres et séries ont usé de ce fantasme populaire, cet amour interdit entre professeur·e et élève. Tabous, ces relations intimes nous sont vendues comme « sexy », désirables — le nec plus ultra de l’expérience amoureuse et sexuelle à l’université.
Pourtant, les paroles des victimes de violences sexuelles qui progressivement se libèrent sur les réseaux sociaux (#metoo, #balancetonporc), et à travers différents médias — notamment les récentes accusations d’agressions sexuelles du réalisateur Harvey Weinstein par plusieurs femmes — nous montrent que les dynamiques de séductions entre individus de statuts différents ne sont pas aussi alléchantes qu’elles en ont l’air…
Un traitement médiatique sexiste
Si une prise de conscience sur les violences sexuelles s’opère, aussi bien dans l’industrie du cinéma que dans le milieu universitaire, c’est qu’il existe aujourd’hui en 2017, dans les pays occidentaux, un meilleur traitement journalistique du sujet. Les paroles des femmes sont moins remises en question, et les affaires d’agressions sexuelles sont sujettes à davantage d’enquêtes, et surtout de contextualisation. Autrement dit, parler de harcèlement sexuel ou de viol amène à s’interroger sur un problème structurel : notre société patriarcale où une culture — « culture du viol » — perpétue des normes sexistes qui banalisent, voire érotisent, les violences sexuelles envers les femmes. Une autre caractéristique de cette culture est la constante culpabilisation des victimes, qui empêche bien souvent ces dernières de rompre le silence.
Toutefois, halte à trop d’optimisme. Nombre de médias ont continué à parler des récentes accusations d’agressions sexuelles (l’affaire Weinstein, l’affaire Kevin Spacey — l’acteur de House of Cards), sous l’angle du sensationnalisme et de l’anecdotique. Pis encore, ces affaires sont reléguées aux rubriques « Célébrités », « Faits divers » et « Culture et Loisirs » des journaux (voir exemples ci-dessous). Dès lors, cette couverture médiatique occulte le problème sociétal et continue de rendre invisibles les violences sexuelles en les réduisant à des scoops.
Quant aux « idylles » entre professeure·s et étudiant·e·s, il reste du chemin à parcourir afin de déconstruire et démystifier ces relations.
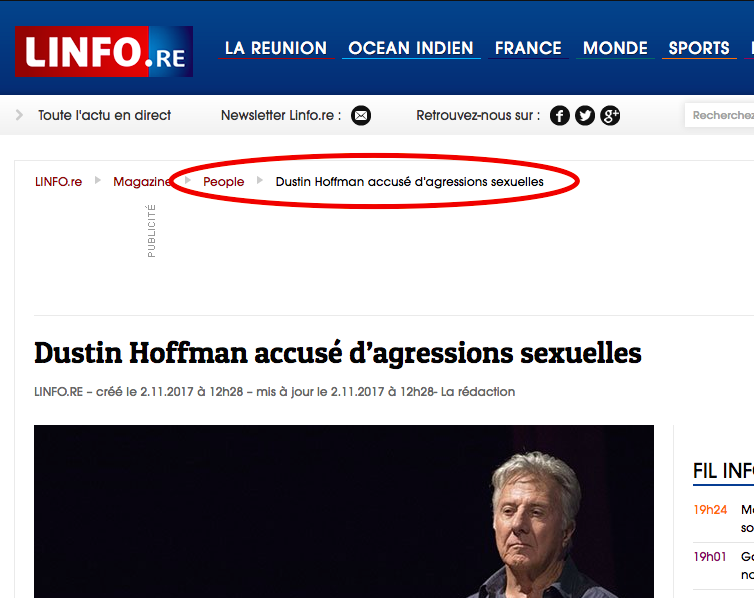


Remue-ménage au Québec
Contrairement à ses voisins francophones outre-Atlantique, le Québec a connu ces dernières années une sensibilisation aux violences sexuelles sur les campus. La vague d’agression sexuelle à l’Université Laval en octobre 2016 avait été fortement médiatisé et avait engendré plusieurs marches afin de protester contre la culture du viol.
Par ailleurs, six universités québécoises ont publié en décembre 2016 des données chiffrées sur les « situations de violence sexuelle vécues en milieu universitaire ». Cette enquête « Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire » (ESSIMU) vient combler un grand vide en terme de statistiques.
Qu’y apprend-on ? 33,5% des répondant·e ·s (étudiant·e·s et employé·e·s universitaires) ont vécu des gestes de harcèlement sexuel depuis leur début à l’université, et 18,3% rapportent des comportements sexuels non désirés avec ou sans contact physique. Lorsqu’on aborde le harcèlement sexuel sur les campus, ce sont généralement les activités sociales et festives qui viennent à l’esprit comme instances favorables à ces événements. À l’évidence, l’université, comme le reste de la société, est imprégnée de normes sexistes et violentes, qui se manifestent par des agressions d’un·e étudiant·e à l’autre lors d’évènements « extra-scolaires » principalement — mais pas que…
« L’université, comme le reste de la société, est imprégnée de normes sexistes et violentes »
Professeur·e et étudiant·e : une relation épineuse
Comme les autres institutions, les universités impliquent des relations hiérarchiques entre ses membres ; entre employeur·e et employé·e, mais aussi entre professeur·e et étudiant·e. Les abus et le harcèlement au travail font l’objet depuis plusieurs années d’une certaine médiatisation. Néanmoins, la spécificité de la relation professeur·e/étudiant·e est beaucoup moins explorée. En réalité, cette relation hiérarchique est bien souvent perçue comme stimulante et positive — surtout pour les étudiant·e·s de master et de doctorat qui bénéficient d’un·e tuteur·rice tout au long de leur parcours académique. En effet, que pourrait-on redouter d’individus cultivés pour qui l’éducation et l’échange de savoirs font parties intégrantes de leur mandat ? Tout, à en croire les chiffres et témoignages récoltés par l’enquête ESSIMU, ainsi que par les multiples associations luttant contre les violences sexuelles à l’université.
Plus précisément, deux statistiques sont révélatrices. Presque un tiers des personnes ayant subi une forme de violence sexuelle indiquent qu’au moins une des situations impliquait une personne détenant un statut supérieur. D’autre part,dans 25,6% des cas, ces gestes ont été commis au moins une fois par des enseignant.e.s .
Les rapports hiérarchiques s’imbriquent dans des rapports de pouvoir liés au prestige d’un·e professeur·e, à sa fonction, son grade, son autorité, exacerbant la vulnérabilité des étudiant·e·s. Dans le cas d’encadrement de thèse, le professeur est souvent l’interlocuteur premier et principal des étudiant·e·s dans leur milieu universitaire. S’ajoute à la personnalisation de la relation pédagogique et la proximité de travail une forte dépendance en terme de réussite académique. Lettres de recommandation, démarches administratives (demandes de bourse), et autorisations de publications sollicitent l’intervention du professeur·e. Cette relation de dépendance est non seulement un facteur de risque, mais empêche souvent les étudiant·e·s de porter plainte lors de harcèlement et/ou d’agression sexuelle. Les répercussions sont alors néfastes : abandon de thèse, traumatisme psychologique, ou encore isolement social.
Quelles solutions ?
Suite aux révélations d’agressions sexuelles sur les campus québécois, plusieurs universités se sont dotées de politiques de lutte contre la violence sexuelle, à l’instar de l’Université McGill. Ces mesures prises par l’administration suite à une initiative étudiante prévoient des structures de sensibilisation (comité, cours obligatoire de prévention, etc.), et du soutien aux victimes, ainsi que la clarification des procédures disciplinaires sanctionnant les présumés coupables.
Des bureaux ou cellules de veilles sont également présents dans la plupart des universités (UQAM, UdM, McGill, etc.), ou vont ouvrir leurs portes. Ces efforts sont néanmoins susceptibles d’être mis en péril par des investissements financiers insuffisants. Dans les Cégeps, le manque de fonds se fait sentir, notamment en région. De plus, les 23 millions de dollars versés par le gouvernement aux établissements supérieurs en août dernier ne permettent pas de pallier leurs moyens limités.
Récemment, la ministre de l’Enseignement Supérieur, Hélène David, a apporté un brin d’espoir et a permis de faire un nouveau pas dans la lutte contre l’impunité des agresseurs. Le projet de loi 151 prévoit en effet « d’encadrer les liens intimes, amoureux ou sexuels qui peuvent s’établir entre un étudiant et une personne ayant une influence sur le cheminement de ses études ». Ce code de conduite se retrouve dans d’autres professions, notamment les professions médicales. Il impose aux professeur·e·s de déclarer à un tiers (collègue, faculté) sa relation avec un·e étudiant·e, et permettra à l’administration d’instaurer les mesures nécessaires pour protéger l’élève et empêcher tous conflits d’intérêts (désignation d’un co-directeur de thèse par exemple).
Reste à voir si donner la responsabilité de la protection de l’élève au professeur s’avère efficace. De plus, d’autres envisagent d’aller plus loin en souhaitant l’interdiction totale de ces relations, comme sur certains campus américains. En parallèle, peut-être serait-il intéressant de tout bonnement repenser la structure de notre éducation et de la pédagogie au sein des établissements d’enseignement supérieur. Entre autres, ne devrait-on pas concevoir un autre moyen d’encadrer et supporter les travaux de recherche des masterant·e·s et doctorant·e·s, évitant ainsi cette relation dépendante et asymétrique ?


