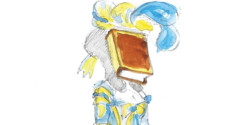L’histoire du Québec est ponctuée de mille et une péripéties, allant des référendums à la grève étudiante de 2012. Ces décisions et ces batailles collectives semblent aujourd’hui bien loin de notre quotidien, et pourtant notre histoire prend vie dans chacune de nos paroles. Hannah Arendt, exilée de sa mère patrie pendant la Seconde Guerre mondiale, déclara que la seule chose qui lui restait de l’Allemagne pré hitlérienne, c’est la langue. Et, bien que le Québec post-référendaire n’ait pas changé du tout au tout comme le fit l’Allemagne, il demeure que la langue française est le seul réel héritage qui puisse faire encore naître une nostalgie, consciente ou non, chez ses locutrices et locuteurs.
Ainsi Hannah Arendt, qui vécut l’exil plus d’une fois et dont la profession oblige presque la connaissance de plusieurs langues (dont l’anglais au moins), vit sa nostalgie patriotique à travers l’allemand. Elle estime qu’un individu se doit de garder sa langue maternelle intacte et vivante. Aux yeux d’Arendt, répondre aux exigences culturelles du pays d’accueil, du « sauveur », est un outrage et rend ceux qui tentent de l’oublier « bègues », une idée développée initialement par son premier mari, Günther Anders. Ce dernier explique que certains exilés finissent par devenir bègues autant dans leur langue maternelle que dans la langue du pays d’accueil et que la solution pour ne pas l’être (bien qu’il ne la qualifie pas de solution à proprement parler, mais qu’il en parle comme étant une manière de protéger le seul bien qui persiste suite à l’exil) est de se vouer fanatiquement à la langue maternelle.
En accordant cette importance à la langue, il me semble que l’on puisse l’aborder dans l’optique de la situation québécoise et canadienne : du point de vue du Québec, l’adoption de la loi 101 témoigne du désir d’éloignement linguistique des Québécois face au reste du pays ; du point de vue fédéral, la perspective des réfugiés souligne le choix déchirant qu’ils doivent faire entre devenir bègues dans les deux langues en se conformant aux désirs de la terre d’accueil, ou plutôt doivent-ils décider de se vouer à leur langue maternelle tout acceptant l’abandon des bénéfices socioéconomiques qu’apporte la connaissance de la langue hôte.
Exil symbolique
Les Québécois ont vécu leur propre exil au 20e siècle, l’exil tout d’abord volontaire du Canada, puis ensuite l’exil forcé par le gouvernement fédéral lors de la nuit des longs couteaux. Bien que la loi 101 existait avant ces évènements, reste que le Québec a vu l’importance de cette loi être confirmée par ces évènements. Il faut dire que certains instigateurs de la loi croyaient eux-mêmes se tirer une balle dans le pied en proposant ce projet de loi et savaient pertinemment qu’elle allait déclencher du grabuge chez les Québécois anglophones. Le Québec, poussé par un désir de perpétuer sa culture francophone fragile, a fait le choix du repli plutôt que de prendre le risque de devenir bègue.
Conflit de valeur
En tant que francophone, que l’on soit d’accord ou non avec cette loi, il faut essayer de comprendre la difficulté que représente la pratique d’une langue étrangère dans une province comme la nôtre. Le nombre de réfugiés et de personnes immigrantes en province augmentant de jour en jour, il est dur de comprendre à quel point la résidence dans une province législativement repliée sur elle-même doit être difficile pour des personnes de l’extérieur dialoguant dans une langue différente. Les exilés se trouvent, au Québec tout particulièrement, mis face à un choix déchirant, pour eux et pour leur famille, et la pensée d’Arendt, si elle se révèle effectivement vraie, rend l’assimilation beaucoup plus déchirante que ce que la culture populaire ne le laisse croire.