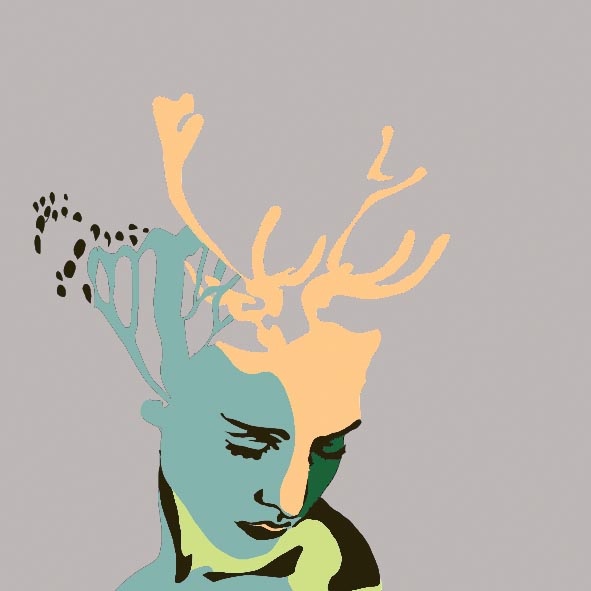Ce jeudi 5 avril a eu lieu le « projet imagination », l’évènement le plus important organisé par les élèves du club McGill Students for Santropol Roulant. Cette soirée regroupait de nombreux membres de l’association Santropol Roulant qui organise la vie en communauté d’une trentaine de personnes atteintes de maladies mentales telles que la schizophrénie ou encore la dépression. Au programme, exposition des œuvres de ces artistes atteint·e·s de maladies mentales et discussion ouverte sur les troubles mentaux afin de les déstigmatiser.
L’exposition
« Je fais des projets imaginaires. » C’est ainsi que George Harris qualifie ses œuvres, ces plans de maisons ou d’hôtels montréalais et new-yorkais qu’on pouvait admirer lors de l’exposition. Ancien architecte professionnel diplômé de Yale, sa carrière a été subitement interrompue lorsqu’il a développé une schizophrénie. Néanmoins, dessiner a toujours été pour lui un moyen de ranimer sa passion pour l’architecture, une façon de s’exprimer et de partager avec les autres membres de la communauté. Comme l’a expliqué Michel, vice-président (v.-p) aux Affaires externes du club McGill Students for Santropol Roulant, l’architecture est devenue sa raison de vivre, ce qui lui donne une raison de se lever chaque matin. Ainsi, si les élèves de McGill, et notamment Michel, ont décidé d’organiser cet évènement, c’est pour permettre à George Harris de réaliser un rêve : organiser sa propre exposition .Certain·e·s diraient qu’il s’agit d’une façon de déstigmatiser le handicap de ces personnes et de prouver que non, la maladie n’empêche pas d’accomplir ses rêves. Car comme l’a affirmé l’artiste à propos de son exposition « c’est ce que j’aurais fait dans les années 80 ».
Un peu plus loin dans l’exposition on pouvait admirer des visages dessinés sur de nombreuses serviettes de papier. Ottoni, artiste et ami de Goerge Harris, nous explique son processus de création : après une courte prière, il prend une serviette de table et gribouille dessus le plus rapidement possible. Puis, l’artiste contemple son dessin, tente d’y trouver un visage et trace les derniers traits qui donneront vie à ce gribouillis. « C’est complètement hors de contrôle et spontané. J’aime avoir une interférence la moins contrôlée possible », explique-t-il.
Regards de la société
Comme l’a souligné Sam, l’un des membres du club, « nous n’avons pas l’habitude d’aborder le sujet des maladies mentales, ou alors lorsque nous le faisons, nous ne l’abordons pas sous le bon angle. » Le but de la discussion ouverte sur la maladie mentale qui suivait l’exposition était donc de changer les mentalités vis-à-vis de cette question et de mettre terme à de nombreux préjugés.
Le premier préjugé que l’on peut avoir à l’égard de ces personnes est qu’elles sont malades, différentes de toutes les autres et pas complètement rattachées à notre réalité. Les deux artistes présents ont avoué qu’ils se sentaient rarement pris au sérieux, rabaissés à de simples esprits abrutis par la prise de médicaments. Ces personnes souffrent du regard méprisant des autres, ils se sentent perçus comme fainéants, violents. Ainsi, les gens dans la société ne font qu’agir comme un miroir, si bien que les malades finissent par se reconnaître dans ces préjugés.
Enfin, une critique a été ap- portée sur le système de santé. Henri Bars affirme qu’il trouve ce dernier beaucoup trop impersonnel : les médecins ne les écoutent pas, il n’y a pas de contact humain, or c’est de cela dont ces personnes ont besoin.
Ottoni a conclu sur cette phrase simple mais pourtant lourde de significations : « Je suis un humain ». donne une raison de vérifier que tout le monde va bien.