Quelques tableaux nous inspirent pour un véritable voyage écologique.
Le voyageur s’avance. Il monte à bord de ce qui sera sa demeure pour les quatre prochains jours, le Canadien, le train le menant de l’Est torontois jusqu’à ce Pacifique jamais atteint auparavant. La boîte longiligne s’active, les paysages défilent et le voyageur s’engage dans un nouveau périple. Une méditation du fer, de la longueur, de la patience, une méditation du voyage écologique.
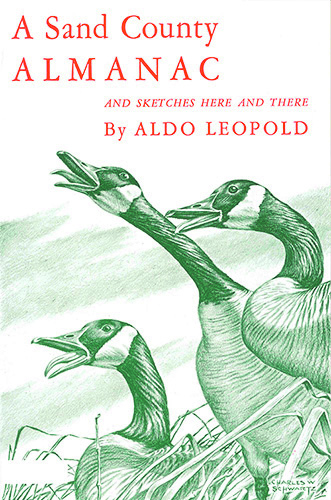
Les cieux opposés
Le matin du deuxième jour, le Canadien s’est enfoncé plus loin dans les terres et continue son lent cheminement vers l’Ouest, infatigable. Ici, en Ontario profonde, le vert des forêts ne cède son trône qu’au bleu des lacs, les deux seigneurs demeurant côte-à-côte, vivant côte-à-côte. À cette Terre fait face le Ciel, serein dans sa splendeur. Buses, huards, pélicans et cerfs viennent témoigner de leur présence au passage du train. Ce sont les citoyens sylvestres, petits seigneurs des bois. Le couchant couronne les cimes montagneuses d’une fine dorure, marque d’une contrée véritablement divine.
La présence humainese fait plutôt rare. Quelques maisons effacées, embarrassées de piétiner la
forêt. D’autres, moins gênées, sont clairement établies sur les bords de lac en chalets qu’elles sont. Le voyageur, ce citadin d’adoption ayant grandi au sein d’une nature de laquelle il ne s’est jamais senti fraternel, regarde la forêt d’un œil différent, la beauté de l’intouché l’émeu. La forêt non pas comme ville de repos, mais bien comme forêt, maître d’elle-même et pour elle-même. Le citadin voyageur, même s’il se sait étranger de passage au sein de ce royaume, s’endort paisiblement.
Dans son corridor sylvestre, le Canadien continue son chemin.
Les grandes plaines
Le matin du troisième jour, c’est le premier paysage véritablement inconnu, un nouvel horizon. Et quel horizon ! C’est le calme plat de la Saskatchewan. Les vents caressent les champs. Des vagues se forment dans ces mers de blé. Le Ciel et la Terre sont ici clairement distincts, en parfaite antithèse. Le plat du paysage y amène un sentiment du possible, de proximité même avec le lointain. Les animaux sont ici sous le joug de l’Homme pour la plupart. Bœufs Angus et bisons des Amériques en enclos regardent tranquillement le train filant à vive allure. Des veaux courent comme des enfants à la récréation. Des cerfs, libres des fers de l’Homme, galopent avec la vigueur de la vie sauvage. Coyotes et renards maraudent les champs. Aux mers de blé se substituent des étangs géants, véritables lacs miniatures, terrain de jeu des canards et autres oiseaux aquatiques. Un orage, le Ciel s’obscurcit jusqu’à se confondre avec la Terre. Puis l’éclaircie. Le soleil revient marquer
l’ascendant du Ciel sur la Terre, un tableau de la Renaissance rétablissant l’antithèse.
Ici se trouve également l’arrière-cour de la civilisation industrielle, la partie laide qui s’y accule. Les wagons-citernes et trains transportant des voitures neuves se multiplient, en mouvement ou stationnés. Les rails s’accumulent les uns à côté des autres, tissant une toile de fer. Le pétrole n’apparaît pas par magie, il est transporté en masse par les rails.
Voyant d’où il vient et regardant où il va, le Canadien continue son chemin. Ainsi soit-il, on prend toujours un train.
L’appel des montagnes
Le matin du quatrième jour, le paysage tant attendu des voyageurs se dévoile enfin. Les Montagnes Rocheuses percent l’horizon, véritables forteresses de roc. On sent que cette cordillère d’Amérique du Nord impose un respect des grandes choses. Le temps coule sur elles et celles-ci, en retour, s’épuisent dans le temps. Sur leurs flancs lézardés s’entrecroisent crevasses, granite et creux, tous des récits gravés dans une langue qui n’est autre que celle du temps. Non pas le temps des Hommes, mais bien celui de la Terre, ce temps où les siècles sont des secondes, ce temps qui a précédé les mortels et qui les dépassera. C’est un temps que l’on croirait, en s’efforçant bien peu, divin. Le gris clair des rochers se détache du ciel parsemé de nuages. La sagesse de la Terre veille sur le passage du Canadien. Du moins, se l’imagine-t-il.
Entre les Rocheuses serpentent lacs et rivières, dont l’eau turquoise digne des Caraïbes apaise par son évidente pureté. Enfantées par les glaciers, ces eaux laiteuses semblent protégées par les murailles rocailleuses, isolées du reste du monde. Dans la forêt, c’est le règne des conifères. Certains se dressent fiers sur les flancs montagneux, héritiers de leurs ancêtres ayant eu l’audace des hauteurs. Le traditionnel vert se décline également en rouge chez certains spécimens.
La Terre rejoint le Ciel, mais ne l’a jamais tout à fait atteint. Le Canadien continue son chemin.
Le matin du cinquième jour, le périple est achevé. 4 466 kilomètres de voies ferrées, quatre nuits, cinq matins, des dizaines de gares, cinq provinces, trois fuseaux horaires, la traversée d’un pays-continent d’Est en Ouest. Le serpent terrestre à l’époque des faucons aériens. Le voyageur s’éloigne, étrangement nostalgique de l’isolement du train. Le voyage lui a semblé à la fois long et court, la destination à la fois proche et lointaine. Il s’éloigne. Au retour, le Canadien continuera son chemin.
L’héritage de Léopold
Ce petit almanach des chemins de fer se veut un hommage au Sand County Almanach d’Aldo Leopold, pionnier conservationniste et génie de l’écologie qui appelait en 1949 à une véritable éthique de la terre (land ethic). Dans l’écologie léopoldienne, la terre (the land) doit être considérée non pas comme une simple propriété (ou, en terme moderne, un puits de ressources naturelles), mais comme l’élément incontournable d’une véritable éthique. Celle-ci, proprement écologique, concerne non seulement les relations qu’entretiennent les humains les uns avec les autres, mais aussi celles que ces derniers entretiennent avec les autres êtres vivants sur cette terre. L’être humain se doit d’apprendre à connaître et à vivre avec ses concitoyens – humains et non-humains –, formant un ensemble de parts interdépendantes. Car c’est bien lorsque l’on se reconnaît dans l’autre que l’on s’éprouve comme tiré en sa direction. Le land ethic appelle à cette compréhension des humains envers leurs communautés écologiques pour mieux vivre, non pas en seigneur séant au-dessus d’elles, mais bien en leur sein.
Ce petit almanach des chemins de fer se veut un hommage au Sand County Almanach d’Aldo Leopold, pionnier conservationniste et génie de l’écologie qui appelait en 1949 à une véritable éthique de la terre (land ethic).
Aldo Leopold se distingue autant par la sensibilité et la sincérité des images qu’il crée que par l’acuité de ces dernières. En effet, dans un passage particulièrement célèbre du Sand County Almanach, le philosophe de la terre – également chasseur de cerfs – décrit sa relation autrefois conflictuelle avec les loups de son comté. En effet, ceux-ci étaient généralement perçus comme des nuisances à la chasse au cerf, et furent exterminés pour cette raison. Toutefois, la population de cervidés, plutôt que d’augmenter comme le croyaient les humains du Sand County, a décliné en suivant celle des loups. Leopold en vient alors à considérer le loup comme figure gardienne de la montagne, préservant l’équilibre entre les carnivores, les herbivores, les végétaux et les sols.
Par ailleurs, la justesse du regard de l’auteur est corroborée par l’effet de cascade trophique de la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone. En effet, l’introduction de 14 spécimens a permis de contrôler non seulement la population de cerfs, mais également le déclin de la végétation causé par leur surpopulation. La vigueur retrouvée de la flore a elle-même encouragé les populations de castors et autres petits animaux, éprouvés par la compétition des cerfs. Cet exemple à la fois magnifique et banal illustre parfaitement le propos du penseur : les humains ne sont pas les propriétaires des terres, mais des citoyens parmi d’autres. L’appel de Leopold est celui venant de la terre.
Celui ou celle qui lit Leopold ne peut passer à côté de son profond attachement pour sa terre. Cet attachement puise dans les connaissances de sa terre, apprendre à connaître la terre où l’on vit comme l’on apprend à connaître ses voisins, tout cela pour véritablement habiter la terre. Toutefois, nul n’est obligé de rester en permanence en sa terre. Les échanges, les périples, la découverte de l’inconnu, tous sont des aspects nous permettant de développer différentes sensibilités à l’habitation. Ainsi, loin de plaider pour un statisme borné, nous pouvons envisager une extension de cette « éthique de la terre » aux voyagements, une « éthique du voyage écologique ».

Le voyage écologique
À l’heure de la mondialisation avancée, l’air du temps préconise davantage le nomadisme que l’enracinement. La multiplication des déplacements est délétère à bien des égards. L’aspect le plus évident à pointer est de nature matérielle. À titre d’échelle, le transport comptait pour 14% des émissions de GES émis annuellement dans le secteur du transport dans le monde en 2010, selon l’Agence de Protection de l’environnement des États-Unis (soit entre 3 et 5% du total des émissions).
Toutefois, le transport moderne est également délétère de par son apparente simplicité. La technologie rend les déplacements si simples – trop simples, même – que leurs implications s’en retrouvent voilées. Un écologiste scientifique parlerait d’une extériorisation des coûts (où le gain de temps est transformé en une quantité massive de GES, dégâts causés par de l’extraction des métaux rares, et j’en passe), un philosophe dirait peut-être que cette facilité réalise l’économie de l’attention. Un écologiste léopoldien parlerait quant à lui d’une déconnexion entre le voyageur et les terres parcourues. En effet, le voyage en avion fait l’économie des distances, si bien que l’on pourrait croire Paris voisine de Montréal. Voyager au sein des terres, et non pas au-dessus, n’est-ce pas là un déjà-vu ?
La technologie rend les déplacements si simples – trop simples, même – que leurs implications s’en retrouvent voilées.
Le voyage écologique idéal est celui fait à la marche ou à vélo. L’explication est inutile ici. Il n’est pas tourisme, car il est voyage. Toutefois, nous aimerions argumenter que le voyage ferroviaire représente aujourd’hui un beau compromis entre l’idéal léopoldien et les contraintes du monde moderne. En effet, si le train pollue, il le fait ridiculement moins que son équivalent routier ou aérien. En effet, pour une distance d’environ 541 km (Toronto-Montréal), Via Rail Canada calcule une empreinte de 14,79 kg de CO2 par siège. En comparaison, en prenant les chiffres du calculateur d’émissions Zerofootprint d’Air Canada, on arrive à environ 83 kg de CO2 par siège. Les émissions de la voiture sont à un niveau intermédiaire, soit environ 33 kg de CO2 par siège. Bien que les nombres peuvent varier selon les voyages, la différence reste notable.
Mais surtout, le voyage en train est plus écologique puisqu’il ne fait pas l’économie des biomes parcourus. Il parcourt plaines et champs, contourne et traverse montagnes et vallées, serpente le long des lacs et des ruisseaux ; il rend sensible. Un certain sens de la distance est ainsi vécu par le voyageur, de même qu’un sens de la nature sacrifiée pour le chemin de fer : des arbres ont été abattus, des montagnes ont été percées de tunnels, des rivières ont été affublées de ponts. Le voyageur ferroviaire a un plus grand contact avec ce qu’il cause, contrairement au voyageur aérien. La traversée du Canada prend quatre jours en train – comparativement à trois jours en voiture et six petites heures en avion. La méditation des paysages encourage l’attention, la patience et l’indifférence envers les retards. Qu’est-ce que cinq heures en quatre jours ?
Enfin, et peut-être est-ce le plus important, quel voyageur aérien aurait pu vivre l’expérience de ces tableaux ? Quelle sensibilité y a‑t-il dans un monde qui réalise l’économie de toutes les conditions de possibilité du regard ?
Erratum : Une version précédente du texte affirmait que les émissions de l’aviation comptaient pour 14% du total des émissions.



