Comme nous l’a prouvé le siècle dernier, George Grant (1918–1988) fut l’un des plus importants philosophes du Canada. Homme dont la famille a marqué la vie politique canadienne, il fut professeur de philosophie à l’Université Dalhousie et à l’Université McMaster ; son enseignement a laissé derrière lui de nombreux étudiants un peu plus près de leur provenance, un peu moins à mal des temps modernes. Nous lui devons des œuvres, non traduites en français, telles que Technology and Empire, Time as History, Technology and Justice et, bien sûr, Lament for a Nation, une méditation politique qui a causé de larges remous dans les années 1960 et 1970. Ces œuvres furent en tout point séminales dans notre compréhension de ce phénomène historique qu’a été le Canada – et, devons-nous l’ajouter, le Québec. Pourtant, malgré son importance, George Grant est à peu près tombé dans l’oubli.
S’il faut convier les nouvelles générations à la lecture de Grant, c’est en raison de la justesse de ses analyses et de l’originalité de certaines de ses thèses. Les plus vieux, comme le philosophe Charles Taylor, s’en souviennent : la publication, en 1965, de Lament for a Nation : The Defeat of Canadian Nationalism fut marquée par les controverses. Dans cette « méditation politique », Grant affirmait que les Canadiens anglais, en tant que peuple historiquement et culturellement constitué, étaient voués à disparaître dans un futur très proche. En fait, pour être plus juste, la spécificité canadienne-anglaise était déjà, à la publication de ce livre et pour le philosophe, en état de décomposition. Inutile de connaître tous les détails et le contexte de ces années pour savoir qu’une telle thèse suffit à faire braquer.
En 1965, Grant constatait que le Canada agissait d’ores et déjà en tant que premier vassal des États-Unis d’Amérique. La tolérance du Canada envers les horreurs commises par les Américains au Vietnam – ou, plus généralement, leurs velléités impérialistes – et la facilité avec laquelle il accepta – à l’exception notable de Diefenbaker – le déploiement d’armes nucléaires américaines sur son territoire furent pour lui le son de cloche d’un phénomène plus pernicieux, plus profond. Le crépuscule du Canada était entamé et ces symptômes ne faisaient que le confirmer.
La thèse centrale de Lament for a nation est que la nation canadienne a existé, mais très brièvement, et que sa disparition était une question de nécessité. Pour le philosophe, il s’agit dorénavant de faire un deuil, d’accepter cette tragédie pour ce qu’elle est, et d’en célébrer la mémoire. En d’autres termes, il s’agit de se remémorer le Canada pour la tentative politique qu’il fut, à savoir, un espoir ténu. Cette thèse s’appuie sur une interrogation tout aussi centrale : de quelles manières et pour quelles raisons les Canadiens auraient-ils le pouvoir et la volonté de maintenir une certaine indépendance culturelle vis-à-vis des États-Unis d’Amérique ?
Il n’est donc pas inopportun de nous souvenir des mots de l’un des grands philosophes du Canada, sachant la hargne de cette société qui veut nous plonger sans cesse dans le présent – preuve en est l’ignorance presque totale que nous avons de nos auteurs, de notre histoire littéraire et philosophique. Exception faite de quelques-uns, notre propre tradition nous est étrangère, étrangère à ceux qui devraient pourtant en être les dignes représentants, les dignes passeurs. Se souvenir de George Grant, c’est voir en face un philosophe conscient de la disparition de son héritage ; c’est, en fin de compte, appréhender l’oubli.
Que se cache-t-il sous la disparition du Canada ?
Sans nous rapporter exclusivement aux analyses dégagées dans Lament for a Nation, ce sont les motifs philosophiques sous-jacents à la genèse de cette œuvre (et de d’autres) sur lesquels il s’agit de tourner notre regard.
Car, en effet, ce qui pose essentiellement problème à Grant, derrière le théâtre des événements rapportés dans sa « méditation politique », c’est la disparition pure et simple des Canadiens anglais, en tant que communauté de corps et d’esprit. En l’occurrence, c’est la constitutionnalité même d’une communauté qui le préoccupe. Ce motif ne cesse de traverser chacune de ses œuvres.
On aurait assurément tort de contredire Grant sur ce point, sachant très bien que le premier mandat de Justin Trudeau, en 2015, a été marqué par cette phrase du premier ministre voulant que le Canada n’ait pas d’identité profonde, puisqu’il est « le premier État post-national ». Or, le caractère « post-national » du Canada, n’en déplaise au premier ministre, est en tout point conforme à notre intégration dans ce vaste projet technique qu’incarne l’Amérique des États-Unis. À cet égard, c’est justement parce que le Canada a cessé d’être une société distincte qu’il peut se revendiquer comme « post-national» ; en outre, c’est parce que ce ne sont plus ses propres racines qui mènent et orientent son destin politique et culturel qu’il peut y prétendre. Et pourtant, en dépit de caractère tout à fait nouveau, le Canada n’a pas cessé d’être un État. Tous peuvent le constater. Et pourtant, le Canada n’est plus.
« La nation canadienne a existé, mais très brièvement, et sa disparition était une question de nécessité »
C’est sous ce prétexte que Grant nous amène à admettre que si le Canada n’existe plus en tant que société distincte, quelque chose doit néanmoins en maintenir l’existence formelle. À la source de ce maintien, l’on repère le cadre civilisationnel américain. En d’autres termes, c’est à partir des sources américaines que le Canada en vient désormais à se penser, à convenir de son destin. Un tel État, on le comprend, peut certes revendiquer une indépendance politique, car, après tout, qui voudrait le contester ?
Mais, s’empresse-t-on de demander, quel est ce cadre civilisationnel américain ? De quoi est-il le nom ? Pour Grant, la réponse est relativement simple et s’appuie sur les sources philosophiques qui furent celles des Pères fondateurs, à savoir le libéralisme anglais de Locke et Smith, et le rejet hobbesien et rousseauiste d’une nature humaine telle qu’on la concevait jusqu’alors en des termes aristotéliciens. Comme Grant l’affirme dès les premières pages de Lament for a Nation : « Être Canadien consistait à construire, à côté des Français, une société plus ordonnée et stable que celle issue de l’expérience libérale des États-Unis. »
C’est à partir du libéralisme que Grant comprend et interprète les États-Unis. En dépit du fait qu’à ses premières heures, le libéralisme était une critique du vieil ordre établi, il est depuis des siècles, chez nos voisins du Sud, la voix de l’« establishment ». Ce libéralisme se définit, selon lui, par une conception particulière de la communauté, de la nature humaine et de ce qui constitue le bien vers lequel cette nature peut tendre. Au cœur de ce libéralisme, la liberté de l’homme est conçue comme son essence même. Assurément, personne n’oserait contester l’importance de la liberté – sinon Grant.
Pour lui, évidemment, la liberté ne pose pas de facto un problème. Il serait absurde d’avancer pareille chose. C’est plutôt dans la manière dont s’est déployée historiquement cette conception de l’homme que Grant trouve matière à s’inquiéter. Pour s’en faire une idée, l’on a qu’à analyser les procédés et méthodes par lesquels cette liberté a été conquise – et donc ce qu’elle signifie véritablement ; l’on découvrira qu’il s’agit d’une conquête de l’homme de la nature, d’une entreprise technique sans fin. En outre, l’on verra que « la suprématie américaine est identifiable à la croyance voulant que les questions relatives à l’excellence humaine peuvent être résolues par la technique ».
Le problème fondamental du libéralisme n’est donc pas qu’il permette à tout un chacun le libre exercice de ses choix, qu’il permette une pluralité des goûts. Ce qui pose décidément problème, dans le libéralisme, ce sont les conséquences d’un monde où il est lui-même la mesure de toutes choses, un monde où il a aboli tous les autres critères, où il n’est plus que le seul étalon. Dans un tel monde – le nôtre, doit-on le retenir – règne une démesure. C’est un monde où les hommes « font ce qu’ils veulent », un monde où chaque chose qui soit est susceptible de devenir un objet de désir et de consommation – et c’est précisément pour cette raison-là que libéralisme s’entend si admirablement avec capitalisme. Qui plus est, un tel monde réfute que des critères limitant son appétit puissent être naturellement valables, car le libre exercice des choix relève du jugement de valeur, de ce qui est donc subjectif. Dans un tel monde, la fin des terres elle-même ne saurait retenir son expansion. Le libéralisme, une fois totalisé, laisse place à l’exploitation de masse et à la destruction planifiée de l’environnement, à la plus pure des dévastations.
C’est pourquoi, considération faite de ce qui précède, le pluralisme dont le libéralisme a la prétention est fictif. Pourtant, comme on le sait très bien, notre époque connaît une production discursive tout à fait monumentale à l’égard de cette prétention. C’est un discours que l’on rencontre presque partout : l’on nous dit que le libéralisme est l’avenue idoine du pluralisme. Mais ce pluralisme, de quoi est-il le nom ? Dit un peu grossièrement, de la consommation. La plupart d’entre nous croient – à tort, selon Grant – être libres ; mais l’image de cette liberté, nous la voyons dans ce que nous consommons, dans ces choses dans lesquelles nous croyons nous voir. En dépit de cette croyance, ces choses nous façonnent bien davantage que nous voulons bien le croire. À bien des égards, les sociétés modernes sont plus homogènes et monolithiques que l’étaient les sociétés dites « traditionnelles », sinon antérieures au vaste déploiement de la modernité. C’est ce qui amena Grant à affirmer, dans Technology and Empire, de manière certes polémique, que « les directeurs de General Motors et les disciples du Professeur Marcuse naviguent sur la même rivière dans des bateaux différents ». Qui plus est, loin des prétentions sans assises des discours cosmopolitiques sur la paix perpétuelle censée advenir par l’avènement du libéralisme et du pluralisme dont il se réclame, nous avons plutôt assisté à une gigantesque entreprise d’homogénéisation des cultures et des peuples. C’est sur ce sol que pousse ce que Grant nommait naguère un « monism of meaninglessness », là où la prétention pluraliste du libéralisme semble triompher.
« Ce qui pose décidément problème, dans le libéralisme, ce sont les conséquences d’un monde où il est lui-même la mesure de toutes choses, un monde où il a aboli tous les autres critères, où il n’est plus que le seul étalon. Dans un tel monde – le nôtre, doit-on le retenir, – règne une démesure »
C’est à raison de ce libéralisme, on le comprend mieux, qu’il est en effet tout à fait plausible pour notre premier ministre, Justin Trudeau, d’affirmer joyeusement que le Canada est le premier État « post-national ». Or, le Canada ne sera pas le seul vassal de cet empire ; d’autres le rejoignent et continueront à le joindre. Car une civilisation articulée à partir du prisme du libéralisme « rend toutes les cultures locales anachroniques ».
Ne prêtons-nous pas au libéralisme des moyens et un pouvoir démesurés ? On peut légitimement le demander. À vrai dire, le pouvoir du libéralisme a quelque chose d’étonnant, quelque chose qui dépasse les catégories utilisées couramment en philosophie politique. Le libéralisme présente à la fois un attrait particulièrement fort et s’appuie sur des modalités discursives très efficaces. Pour nous enjoindre à la vérité de son projet, il déploie par exemple une lecture progressiste de l’histoire, où notre société représente un aboutissement inégalé, mais tout à fait piètre par rapport au destin où notre entreprise technique nous conduira. Ainsi, contrairement à cette période historique qu’il qualifie de medium ævum, âge du milieu, moyen âge, il s’appréhende lui-même comme l’âge du progrès. Or, lorsque nous sommes face au « progrès », nous ne sommes pas seulement face au caractère strictement descriptif du terme, puisqu’il est aussi et surtout prescriptif, c’est-à-dire qu’il affirme : « C’était pire avant. » Et même : « La référence au passé est douteuse, voire obscurantiste. » Dès lors, impossible de comprendre d’où nous venons, où nous sommes, et où nous allons. Tout est circoncis par le « progrès », dont la définition même interdit la remise en question.
Que s’est-il donc passé avec le Canada ? Eh bien, rien – s’il faut en croire le progrès dans l’histoire. Les Canadiens anglais, en tant que société distincte, en tant que communauté constituée dans l’histoire, ont cessé d’être, puisqu’ils se sont évanouis dans le seul cours possible de l’histoire, dans la vaste entreprise américaine et dans son projet technique sous-jacent.
Un conservatisme philosophique
Le caractère tragique de Grant, si l’on peut dire, repose sur ce que nous avons volontairement tu jusqu’à présent : il était, de façon authentique, un conservateur. Le conservatisme, on le sait, n’est pas une qualité ou un programme politiques respectables. On le sait. Par contre, étonnamment, peu sont ceux qui savent définir ce qu’est le conservatisme. Dans l’œuvre de Grant, il prend un sens très précis qu’il nous semblera pertinent de montrer, car il est urgent de réhabiliter, nous semble-t-il, le caractère fondamental de la conservation, au-delà des faux conservateurs, au-delà de l’impossibilité même du conservatisme dans les temps modernes.
Le conflit moderne entre conservatisme et libéralisme politiques surgit à l’occasion d’un différend fondamental concernant ce qu’est la « vie bonne » et les institutions sociales par lesquelles celle-ci doit advenir. Comme nous l’avons indiqué, dans les suites de Grant, la « vie bonne », telle que définie par le libéralisme et son programme technique, repose sur une définition particulière de la liberté, dont il affirme qu’elle est l’essence véritable de l’homme. En d’autres termes, le libéralisme détermine l’homme à raison d’une certaine interprétation de ce qu’il est.
« L’horizon de l’œuvre philosophique de Grant, en cohérence avec son conservatisme et le souci qu’il sous-entend, fut de méditer la possibilité même de la « vie bonne » dans une civilisation conduite et dirigée de toute part en la figure tutélaire de la technique et de ses différents dispositifs »
La conception conservatrice est en tout point différente. Elle affirme, quant à elle, une autre interprétation de la constitutionnalité des hommes, postulant qu’une part considérable de notre constitution et de celle de nos communautés repose sur les légalités historiques qui sont nôtres.
Aux fondations du conservatisme réside la thèse selon laquelle les critères de la « vie bonne » peuvent être trouvés et cette dernière fondée par eux – et cela, par une méditation de ce que nous recevons en héritage, ce que des gens plus sages et prudents que nous ont pu penser. Cette thèse affirme du même coup que des choses telles que les vertus sont possibles, souhaitables – ce serait en elles que repose la possibilité de l’excellence de l’homme. En égard à cela, le conservatisme suppose un souci, là où le libéralisme suppose des désirs. En quelque sorte, le premier relativise la volonté actuelle, dirigée vers la satisfaction immédiate, de ce que nous désirons. Car, dans sa méditation de l’héritage et ce qu’il doit lui-même transmettre, il admet l’existence de « contraintes sacrées », sinon l’existence du sacré. Il retient et préserve donc l’idée que l’existence de l’homme peut être livrée à de hautes significations.
Il s’agit, par conséquent, de comprendre le conservatisme en la posture qu’il suggère, dans la méditation historique qu’il propose, dans l’entente qu’il souhaite entre les hommes. Ce qu’il a de décidément antémoderne, c’est qu’il affirme, de manière descriptive, que la constitution de nos communautés réside, non pas au sein des appareils techniques censés garantir sa continuité historique – par exemple, la Constitution du Canada – mais ailleurs. Ce que l’on peut déterminer comme étant la « vie bonne » puise son autorité et sa normativité en dehors des appareils législatifs et juridiques. Elle prétend qu’un poète, dans son atelier, œuvre plus profondément à la constitution d’un peuple que des lois et des règlements adoptés au parlement. Cette prérogative relative à l’expression publique correspond à ce que certains ont nommé maladroitement le « droit de la tradition », dont l’herméneutique a été admirablement présentée par Gadamer dans Vérité et Méthode.

Nonobstant cette description assez superficielle du conservatisme, nous devons relever quelque chose de décisif : l’horizon de l’œuvre philosophique de Grant, en cohérence avec son conservatisme et le souci qu’il sous-entend, fut de méditer la possibilité même de la « vie bonne » dans une civilisation conduite et dirigée de toute part en la figure tutélaire de la technique et de ses différents dispositifs. Sa conclusion philosophique fut pourtant sans appel : il existe, en raison du large déploiement du projet technique et de son libéralisme, une impossibilité du conservatisme, de la conservation. C’est sous ce prétexte qu’il soutint par exemple que l’impossibilité du conservatisme dans les temps modernes est l’impossibilité du Canada lui-même.
De quelle manière ? L’une des conséquences du libéralisme n’est autre que l’impossibilité du conservatisme en tant qu’attitude et positionnement politique à notre époque, parce que l’adhésion et le consentement au grand projet moderne de la technique ne permettent pas la conservation : « L’impossibilité du conservatisme à notre époque est visible dans le fait que ceux qui en adoptent le titre ne peuvent être rien de plus que les défenseurs des quelconques structures qui sont, à un moment donné, nécessaires au progrès technique. […] Ils ne sont pas des conservateurs, au sens de ceux qui sont les gardiens de quelque chose qui ne peut pas changer. » Puisque le libéralisme n’envisage l’histoire que sous l’angle du « progrès », les enseignements du passé n’ont aucune valeur, ni droit de cité. Au mieux, ils peuvent trouver refuge dans les musées, dans les bibliothèques, fasciner les antiquaires. La vertu n’est donc rien : « Une philosophie politique qui est centrée sur la vertu ne peut être qu’une voix obscure et sombre dans une civilisation technique. »
À vrai dire, cette impossibilité n’est en rien nouvelle, elle n’est pas un phénomène du 21e siècle, ni même du 20e siècle. Comme le remarque Grant dans Lament for a Nation, le conservatisme était une force largement fatiguée et épuisée dès le tournant du 19e siècle, de sorte qu’il est forcément fautif de reconnaître comme « conservateurs » les politiciens et intellectuels s’en étant réclamés un siècle plus tard. C’est à ce propos que le philosophe s’en prend aux « faux conservateurs », ceux qui, en tout état de cause, sont impropres au souci de la conservation, ceux qui se réclament du conservatisme afin de défendre des droits de propriété, un chauvinisme. Ceux-là ne sont pas de véritables conservateurs. C’est pour cette raison que les « conservateurs » américains sont pour Grant des libéraux old-fashioned, et non de véritables conservateurs, au sens qu’eut autrefois ce terme. Ces faux conservateurs, il est vrai, peuvent avoir quelques réserves par rapport à la modernité, mais ils adhèrent tout entiers au projet technologique qui le suppose – et donc, en un sens déterminant, à son libéralisme. Ainsi, lorsque nous prenons connaissance, au Canada, des discours et des propositions du Parti conservateur du Canada (et que dire de celui du Québec!), ce n’est jamais à un souci que nous avons affaire. La cause de ce « conservatisme », c’est celle des libéraux qui ont perdu au jeu, contre d’autres, plus rusés. Ils ne tiennent à rien, sinon à la satisfaction de désirs différents des élus du Parti libéral du Canada – et leurs électeurs n’y échappent guère, cela est évident.
« Ce que Grant a de décidément antémoderne, c’est qu’il affirme, de manière descriptive, que la constitution de nos communautés réside, non pas au sein des appareils techniques censés garantir sa continuité historique, par exemple la Constitution du Canada, mais ailleurs »
L’impossibilité de la conservation à notre époque a des effets tout à fait tangibles, auxquels les tenants de ce souci dont nous parlons seront confrontés jusqu’à leurs dernières heures : « L’homme est par nature un animal politique, et savoir que la citoyenneté est une impossibilité en revient à être coupé de l’une des formes les plus hautes de l’existence. » L’impossibilité de la citoyenneté, c’est cette impossibilité que le conservateur, tel que nous l’avons décrit, ressent au plus profond de lui-même – ce décalage, ce fossé existential qui le sépare de ses contemporains modernes. Ceux ayant croisé, par accident, des âmes de cette trempe, savent bien ce dont il est question. Cette non-citoyenneté du conservateur, c’est-à-dire son intempestivité, relève de ce qui a été perdu, des eaux qui le séparent de l’héritage reçu, de l’impossibilité de la transmission.
La chose est remarquablement décrite par Grant dans Technology and Empire : « Nous pouvons retenir dans nos esprits les bénéfices énormes de la société technique, mais nous ne pouvons si aisément retenir les chemins dont elle pourrait nous avoir privé, parce que la technique est ce que nous sommes nous-mêmes. » Cette « privation », ou plutôt cette « perte », si l’on lui préfère le terme qui en désigne le caractère proprement eschatologique, définit en son essence l’impossibilité de la conservation à l’âge du progrès, en raison de nos grammaires et de nos discursivités modernes. Tous les discours et les grammaires servant à décrire le souci en quelque chose de plus haut que nous-mêmes ont été systématiquement attaqués, rabaissés, et trainés dans la boue, de sorte qu’il est impossible d’articuler adéquatement, comme nous le rappelait Grant, la suggestion d’une « perte ». La perte de quoi, nous presse-t-on ? De rien, encore une fois. Car, faut-il le rappeler, n’est que ce qui correspond au mouvement « naturel » de l’histoire, à son « progrès », à l’actualité à laquelle il nous condamne.
Néanmoins, le conservatisme fait valoir, dans cette impossibilité, une proposition tragique. Disons, à la manière grandiloquente de Cyrano de Bergerac : « Mais on ne se bat pas dans l’espoir du succès ! Non ! non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! » C’est un peu, nous semble-t-il, le sens caché du titre de Lament for a Nation, un sens aux conséquences lourdes mais nécessaires.
C’est qu’en effet, le conservatisme a quelque chose à faire valoir, parce qu’il tient à dire quelque chose du « bien », au sens de Platon. Relativement à cela, il faudrait plutôt parler d’un conservatisme « culturel » ou « philosophique » – à défaut d’un terme plus adéquat. Ce conservatisme, dans le sens radical et originaire que nous lui attribuons, suppose un engagement intellectuel et spirituel dont très peu s’accoutument. Il faut avoir une très haute idée de la tâche de l’homme dans sa propre histoire civilisationnelle et du dialogue « nationel » qu’il doit établir avec les autres civilisations pour en venir à soutenir et faire l’épreuve d’un tel engagement. Un tel engagement, il s’ensuit, n’a rien à voir avec la très basse idée qu’ont les « conservateurs » politiques de cette tâche et de ce dialogue. Ceci étant dit, cela suppose une méditation soutenue de notre histoire, de notre provenance.
En philosophie politique – et, pourquoi pas, en philosophie –, c’est une posture véritablement conservatrice qui permet d’envisager le passé avec révérence. Cependant, comme nous le rappelle sans cesse l’état du « scholarship » depuis quelques décennies, l’intérêt porté vers les œuvres du passé relève trop souvent de la passion d’un antiquaire, de sorte qu’il est trop rare d’étudier les Anciens tout en étant entièrement ouvert à la possibilité que leurs leçons puissent nous apprendre des vérités disparues, oubliées ou dissimulées. La chose est rare, parce que nous sommes nombreux à partir du postulat qui est celui du « progrès » : nous aurions dépassé les préjugés des Anciens et progressé au-delà de leurs erreurs. Il est, dès lors, extrêmement difficile d’admettre qu’ils pouvaient avoir raison, et nous, tort.
« Nous pouvons retenir dans nos esprits les bénéfices énormes de la société technique, mais nous ne pouvons si aisément retenir les chemins dont elle pourrait nous avoir privé, parce que la technique est ce que nous sommes nous-mêmes »
George Grant
Cela fait certainement écho à l’une des thèses caractéristiques de la philosophie politique de Leo Strauss, auquel Grant se réfère abondamment. L’enseignement suppose conjointement l’autorité d’un auteur et l’apprentissage d’un interprétant. Si la tension entre les deux postures peut être amenée à subir des modifications, c’est cette tension qui demeure acceptée tout au long de la lecture d’un texte. L’enseignement a le mérite de potentiellement sortir de l’actuel, c’est-à-dire de ce qui est condamné à passer, afin d’envisager ce qui ne relève aucunement de la mode ou encore des préjugés du moment. Il suppose donc une doctrine qui se veut vraie, du moins qui en est la recherche. En cela, « les philosophes du passé prétendaient avoir trouvé la vérité, et non pas seulement la vérité de leur temps », car, comme en atteste Strauss dans Droit naturel et histoire, la seule chose qui soit variable en ce domaine, ce n’est guère la vérité, mais l’opinion. C’est donc par prudence et discernement que nous devons nous souvenir de ceci : « La plupart de nos idées sont des résumés ou des survivances de la pensée d’autres hommes, nos maîtres (au sens le plus large du terme) et les maîtres de nos maîtres […].»
Si la lecture d’une œuvre du passé signifie la reconnaissance d’une autorité, la lecture n’entend toutefois jamais s’y soumettre aveuglément – en cela, la posture conservatrice ne témoigne que de la réception de l’héritage, de l’acceptation de celui-ci. La possibilité de l’enseignement repose sur l’une des prémisses de la philosophie politique, plus précisément l’idée selon laquelle certaines questions sont fondamentales et essentiellement transhistoriques, exigeant de nous que nous en fassions l’examen constant. L’enseignement réfère ainsi à une formation, là où la lecture forme de manière à ce que nous ne cherchions pas sans cesse à nous trouver nous-mêmes dans un texte. En ce sens, le conservatisme philosophique dont nous faisons ici l’esquisse exige, et c’est le mot juste, un engagement singulier, décisif, sans appel.
Enfin, autre chose différencie ce conservatisme « culturel » ou « philosophique » de son enfant pauvre, à savoir la répudiation du discours des « valeurs ». Au Québec, l’on s’en souviendra, les disputes houleuses autour de la Charte des valeurs québécoises et le dépôt du projet de loi 60 par le gouvernement Marois le 7 novembre 2013, ou, plus récemment encore, la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21) du gouvernement Legault, reprenaient à leur compte ce discours des « valeurs» ; l’on faisait valoir que le Québec devait affirmer, vis-à-vis des populations immigrantes, des valeurs explicitement reconnues par l’État et devant être sanctionnées et appliquées par lui – c’était, nous disait-on, l’expression d’une souveraineté populaire qui affirmait enfin son identité propre. Or, cet engouement des valeurs et le discours moral qu’il présuppose témoignent d’ores et déjà d’une communauté en déliquescence, le symptôme d’un mal profond, d’un peuple fatigué, l’expression tardive d’une affliction. C’est justement parce que la communauté n’arrive plus à se suffire, parce qu’elle n’a plus la vitalité de sa fierté et de ses arts, qu’elle doit imposer. De manière comparable, c’est une France tout bonnement réactionnaire, incapable de comprendre le rejet des fondements de la République par certaines populations immigrantes, qui en vient à chercher par tous les moyens à réaffirmer la validité desdits fondements. Ce que cette France ne comprend pas, et elle ratisse de la droite du Rassemblement national, en passant par la République en marche, jusqu’à la France insoumise, c’est que la République ne sait plus appeler à elle, qu’elle n’a plus le lustre d’antan, qu’elle n’a plus rien qui puisse susciter la ferveur – la révérence ! C’est pourquoi elle recourt, elle aussi, au discours des « valeurs », car elle n’a rien d’autre à faire valoir. Mais nous savons combien sont artificielles et sans assises crédibles de telles valeurs – car un peuple reposant véritablement dans son histoire et dans ses prestiges n’a jamais besoin de nommer ses valeurs et de les imposer du poids de l’État.
Le conservatisme qui nous intéresse, on doit le comprendre, suppose au contraire que la responsabilité à l’égard de l’entretien de l’héritage ne repose que sur les épaules seules des garants de cet héritage. En d’autres termes, dans le cas de l’héritage, les nouveaux arrivants ne devraient jamais être tenus responsables de la vitalité spirituelle de la communauté politique et culturelle qu’ils rejoignent. C’est aux garants seuls de l’héritage de voir à la conservation de ce qu’ils ont reçu et doivent transmettre, c’est aux garants seuls de montrer à ces nouveaux arrivants et à leurs enfants la grandeur de celui-ci, la beauté de son caractère distinct, l’amour de son séjour du monde. Partant de cette déclaration, nul besoin de nous étendre davantage, car il suffit désormais de dire que ce sont ces garants à qui incombent de tendre la main vers l’autre. Un tel conservatisme, manifestement, n’a rien de réactionnaire ni de chauvin. Son engagement est par-delà le présent, tendu du passé au futur.

En l’occurrence, nous trouvons une critique tout à fait comparable du discours des « valeurs » dans l’œuvre de Grant. Il était manifeste pour le philosophe que lorsque l’on emploie pareil discours, pareil langage, nous avons affaire à une modernité en mal de sa provenance, incapable de recourir à autre chose qu’à des moyens techniques afin de rassembler autour d’elle. En référence au « dernier homme » prophétisé par le Zarathustra de Nietzsche, Grant voyait dans les « valeurs » l’ultime lieu sûr où le petit, le médiocre aurait sa marque. L’«âge du progrès » y trouve, d’aucuns le comprendront, son grain.
On conclura sur ce point avec un passage de Grant laissant à songer : « What is worth doing in the midst of this barren twilight is the incredibly difficult question. »
Notes sur le Québec et les Premières Nations
Ces quelques brèves remarques sont d’un intérêt premier pour le destin du Québec et celui des Premières Nations. Afin de conclure ce portrait, osons nous porter vers ce que le conservatisme philosophique dirait du destin propre à ceux-ci.
Tel que les propos de Grant l’ont explicité, le prisme américain tend à homogénéiser toutes les particularités et distinctions culturelles, à intégrer sous un même projet technique toutes les nations de la Terre. Pour certains des membres des Premières Nations et du Québec, du moins pour ceux cultivant le souci de la conservation, cette fatalité qui doit s’abattre de son long sur leur « identité nationale » respective a de quoi inquiéter. Après tout, le caractère distinct des Canadiens anglais s’est à peu près complètement effacé dans les dernières décennies, de sorte qu’un Américain et un Canadien anglais peuvent être comparés sur presque tous les plans. La survie culturelle des Canadiens anglais, argue Grant, « a toujours demandé la victoire d’un courage politique sur les avantages économiques individuels et immédiats ». Car, autrement, comment résister à l’appel du dollar américain ? Ce courage politique, l’histoire du Canada le montre, a terriblement failli.
À propos du Québec, nous pourrions demander où réside un tel courage. À bien des égards, l’héritage de la Révolution tranquille, pour laquelle l’on a que les plus plates louanges répétées, est un héritage américain. Grant s’amusait par ailleurs de la phrase de Robert Bourassa qui disait, à l’occasion d’un discours à New York le 24 janvier 1973, que le Québec était cette rencontre de la « technique américaine et de la culture française », ce qui supposerait que la technique soit quelque chose d’extérieur et non l’esprit lui-même d’une culture. Or, pour Grant, il est évident, suivant en cela les enseignements de Martin Heidegger, que la technique est la « métaphysique des temps modernes ».
Que reste-t-il de ce Québec à défendre ? Que reste-t-il de ce Québec bourgeois et confortable, de ce parfait « colon » qu’est le Québécois francophone d’ascendance canadienne-française, de ce Québec des banlieues ordinaires et homogènes ? Pas grand-chose, pour tout vous dire. Enfin, objectera-t-on, vous ne pouvez tout de même pas dire cela ! Tout de même ! La loi 101, tout de même, n’est-elle pas le symbole d’autre chose ? Ne représente-t-elle pas l’auto-affirmation d’un peuple ? Tout de même, vous devez le voir !
À propos de la survivance de la culture canadienne-française au Québec, Grant mentionnait dans Lament for a Nation deux stratégies ayant été mises en œuvre afin d’en assurer le prolongement. La première stratégie est associée avec Duplessis, et elle dépendait de l’autonomie de la province au sein du Canada – de nos jours, le premier ministre du Québec, François Legault, est le porteur d’une telle stratégie. Cette dernière misait (et mise) sur l’autonomie du Québec afin de maintenir, par l’intermédiaire de certains pouvoirs et de certaines institutions, un sens de la tradition, nommément le catholicisme et l’attachement à la terre. La seconde stratégie, celle associée à Lévesque, a consisté à bâtir une société semi-socialiste qui puisse garantir que l’élite dirigeante soit de culture française, de manière à ce que le contrôle de l’économie et de son avenir passe par les mains des francophones. Néanmoins, ces deux stratégies ont irrémédiablement échoué – il n’y a qu’à voir la conception de la culture et de l’héritage que se font les élus de la Coalition Avenir Québec pour comprendre la très basse idée qu’ils en ont, comment l’attachement à la terre de l’Union nationale s’est transformé en un attachement aux privilèges et au confort des banlieues.
Et la stratégie de Lévesque et du Parti québécois n’échappe guère à un tel échec. La Charte de la langue française a bel et bien confirmé et entériné le caractère commun de la langue française comme langue de communication, mais, comme le disait Grant avec l’affront de l’aristocrate déchu, « c’est sûrement davantage qu’une langue que Lévesque souhaite préserver dans sa propre nation ». En l’occurrence, une langue est censée être davantage qu’un moyen de communication : c’est, devons-nous le rappeler, une manière d’habiter le monde, d’en constituer le séjour. Certaines des œuvres de Martin Heidegger, Gaston Bachelard, Simone Weil, Arne Næss, Hannah Arendt, Pierre Boutang et George Steiner sont d’autant de rappels de cela.
« La survie culturelle des Canadiens anglais a toujours demandé la victoire d’un courage politique sur les avantages économiques individuels et immédiats »
George Grant
Le problème fondamental de la Charte sur la langue française, c’est qu’elle a offert aux Québécois d’ascendance canadienne-française l’illusion d’une garantie, un faux confort linguistique, la croyance que la survie du français en tant que langue de communication équivaut à la survie en tant que peuple. En cela, le discours des « valeurs » de la Charte des valeurs québécoises a son antécédent politique dans l’illusion de la Charte sur la langue française. Car, s’il est vrai, de nos jours, qu’une majorité de Québécois parlent et vivent en français, leur mode de vie est irrémédiablement américain. Ils sont dorénavant d’essence et de destin des Américains – et les poètes sont en fuite.
L’histoire a eu tôt fait d’oublier cette citation de Henri Bourassa de 1918 : « Notre tâche à nous, Canadiens-français, c’est de prolonger en Amérique l’effort de la France chrétienne ; c’est de défendre contre tout venant, le fallût-il contre la France elle-même, notre patrimoine religieux et national. Ce patrimoine, il n’est pas à nous seulement : il appartient à toute l’Amérique catholique, dont il est le foyer inspirateur et rayonnant ; il appartient à toute l’Église, dont il est le principal point d’appui dans cette partie du monde ; il appartient à toute la civilisation française, dont il est l’unique port de refuge et d’attache dans cette mer immense de l’américaine saxonisant. » Or, comme l’anglais de Grant l’exprime de manière laconique, « this was a wasting and tragic dream ».
Ce qui devait distinguer le Canada des États-Unis, notre régime parlementaire du régime présidentiel américain, en d’autres termes ce qui devait distinguer notre confédération des peuples fondateurs de la république des pères fondateurs, c’était la primauté du droit des peuples sur les droits des individus. Or, pour que puissent primer les droits des peuples, encore faut-il reconnaître l’existence et le caractère fondamental de la tradition, de ce qui peut être reçu. Ce qui devait distinguer la Confédération de la « Grande république », culturellement, était la conservation d’héritages pluriels, ceux des peuples fondateurs. Or, les temps modernes montrent l’impossibilité radicale de la conservation, du Canada. Pour le libéralisme, l’on ne saurait souffrir du « bien commun » et de sa conservation, car il ne saurait y avoir de « bien » qui soit « commun », cela est évident.
Il est juste de dire que les Canadiens français n’ont pas rejoint la Confédération afin de protéger les droits individuels mais les droits collectifs, davantage qu’une langue. Les mots du fondateur du Devoir contre l’«américanisme saxonisant » nous le rappellent bien. En revanche, ils n’ont rien su protéger qui soit véritablement fondamental, car c’est de plein gré qu’ils ont offert leur corps et leur âme au projet technique de l’empire américain. Enfin, peut-être que tout était déjà perdu d’avance.
Ce continent ne pouvait jamais être le nôtre tel que l’a été l’Europe, car jamais nous n’avons été ses autochtones. Les mots de Grant à ce propos sont particulièrement forts : « Cette relation de conquête au lieu a laissé des traces profondes en nous. Lorsque nous allons dans les Rocheuses, nous pouvons avoir le sentiment que des dieux sont là. Mais si oui, ils ne peuvent aucunement se manifester à nous comme les nôtres. Ce sont les dieux d’un autre peuple, et nous ne pouvons les connaître en raison de qui nous sommes, en raison de ce que nous avons fait. Rien ne peut être immémorial pour nous, sinon l’environnement en tant qu’objet. Même nos villes sont des installations provisoires sur la route vers la suprématie économique. »
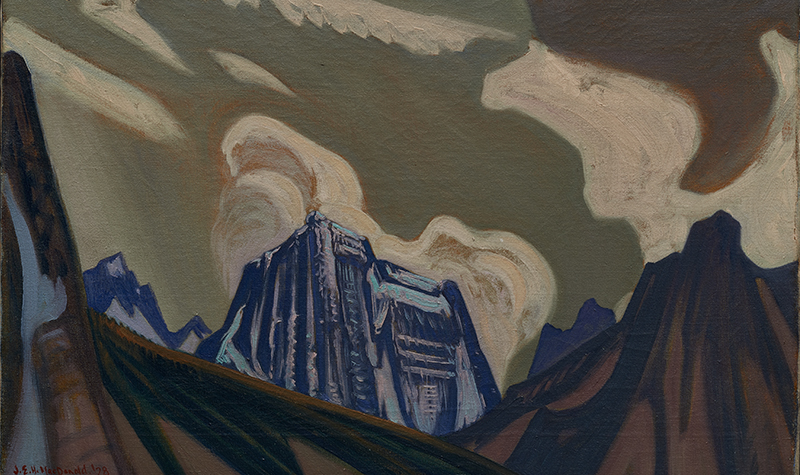
Ce que les Français et les Anglais ont fait de ces terres, il n’y a pas de quoi s’en réjouir. Dans l’histoire universelle des peuples, le Canada occupe certes une plage tout à fait privilégiée, mais dont le privilège n’a rien de noble. Ce que nous avons fait de ces terres a consisté en une méthodique et systématique entreprise d’effacement et d’oubli : nous avons sapé les fondations des peuples autochtones, nous les avons séparés au mieux de notre pouvoir de leurs sources, nous avons construit une nation sur l’extraction et l’exploitation, sur le rapt, sur la mort, et cela ne nous a pas échappé d’appliquer ces mêmes exactions vers nous-mêmes. Car, il faut le dire, si tout nous a réussi sur le plan strictement matériel, le Canada est aussi pour nous une histoire d’oubli, aussi bien pour les Canadiens-anglais que pour les Canadiens-français. On n’a qu’à consulter les cursus éducatifs des écoles publiques et privées au travers de ce vaste territoire pour s’en rendre compte : notre histoire nous échappe entièrement. À cela, rajoutons : notre destin nous échappe de toute part.
Peut-être que le seul espoir de ce pays et de ces terres en ce siècle réside dans les Premières Nations et les puissantes voix qui se sont éveillées en elles. Si nous voulons prêter un peu de bois à ce feu qu’il est plus que temps de soutenir, encore nous faudra-t-il suivre une nouvelle direction juridique, admettre une nouvelle tradition du droit et de la constitutionnalité dans notre herméneutique juridique. Vers cette aspiration, nous trouvons les noms de John Borrows et d’Aaron Mills.
En cela, les revendications tout à fait légitimes et sincères des Premières Nations à l’égard d’une reconnaissance et d’un droit à l’épanouissement de leur culture, en vertu de leur caractère inaliénable de peuples fondateurs de ce territoire et de cette nation, au même titre que les Canadiens anglais et Canadiens français, relève d’une lutte non pas seulement similaire, mais indistinguable. Si le conservatisme est impossible en cette ère, il est néanmoins de notre devoir de nous assurer de contredire cette sentence, de nous écarter de nos échecs afin de nourrir les succès de d’autres. Car, ne soyons pas dupes, leurs revendications relèvent du souci de la conservation.
Tâchons de retenir que Lament for a nation se termine sur un vers de l’Énéide de Virgile, un vers appelant à une certaine espérance dans les lieux les plus sombres et inquiétants : «[Suppliants], ils tendaient les mains, dans leur désir de l’autre rive » (Tendebantque manus ripae ulterioris amore).



