Entre artiste, intellectuel et employé non-syndiqué avec bénéfices et impôts, l’écrivain-professeur-de-littérature semble avoir trouvé l’équilibre idéal. Cet hiver, nous avons voulu examiner cet équilibre en interrogeant deux écrivains et une écrivaine qui nourrissent un rapport avec cette performance hybride. Qu’est-ce qui se perd et qui se gagne dans cette entreprise ? Est-ce possible de travailler et de faire œuvre simultanément ? Quel est l’avenir du livre dans un monde qui va de plus en plus vite ? Cet article s’inscrit dans une suite d’entrevues.
En plus d’être directeur des études de premier cycle, Alain Farah est professeur de création littéraire et de littérature française contemporaine à l’Université McGill. Il est l’auteur du recueil de poésie Quelque chose se détache du port (2004) ainsi que deux romans et une bande dessinée, Matamore no 29 (2008), Pourquoi Bologne (2013) et La ligne la plus sombre (2016). Son troisième roman, Mille secrets, mille dangers, paraîtra prochainement chez Le Quartanier.
Le Délit (LD): Dans Pourquoi Bologne, votre protagoniste Alain Farah est écrivain et professeur à McGill. Il écrit « un roman dans lequel un homme mandate une femme pour écrire un roman à sa place, lui ne pouvant bien sûr pas, son esprit étant contrôlé par les services secrets ». Votre expérience en tant que professeur et tout ce qu’elle permet est-elle une source d’inspiration pour votre écriture ? Comment conciliez-vous ce métier avec votre « mandat » d’auteur, qui demande tout autant de temps et de travail, si ce n’est plus ?
Alain Farah (AF): Je crois que la première chose à aborder, c’est justement la notion de travail. Selon moi, elle est souvent liée au tempérament de la personne au boulot. Il y a plusieurs sortes d’écrivains, plusieurs façons d’écrire. Certains se mettent à la table et envisagent le travail littéraire comme de la « production de pages » journalières. Cette attitude, je la trouve personnellement un peu statique, elle ne me convient pas. Si on m’y obligeait, je pourrais l’endurer pour deux jours peut-être ; après, je n’écrirais plus une autre ligne de ma vie. Je suis quelqu’un d’agité, de nerveux, je dois faire beaucoup de choses en même temps. Cette situation-là me rend malheureux parfois parce que j’ai à la fois l’impression de faire plein de choses et de ne rien faire. Mais, en même temps, je suis content de ne pas céder à la tentation de publier quelque chose qui n’aurait pas suffisamment mûri. Le processus de création est long parce que ma vie ne me permet pas qu’il soit rapide, mais il est complet parce que les heures qui sont accordées à l’œuvre restent les mêmes, en fin de compte.
C’est le cas de mon prochain roman, qui reprend le même narrateur que dans Pourquoi Bologne. Ç’a été un long chantier consacré à des questions d’origines, d’immigration, du racisme qu’on s’inflige à nous même, de l’autovolonté de s’assimiler. Je nomme pour la première fois mon rapport au Moyen-Orient. Il a fallu trouver une place, dans ma vie, pour ce chantier qui m’a obsédé pendant plus de huit ans, à cause de mon tempérament justement, et de la vie que je mène.
LD : N’y a‑t-il pas un danger à laisser trop mûrir l’œuvre ? Un risque qu’une certaine procrastination éternelle s’installe insidieusement dans le processus d’écriture ?
AF : En ce qui concerne la procrastination, j’ai remarqué deux choses. J’ai vu des gens parler des œuvres qu’ils comptaient faire et sur lesquelles ils travaillaient, mais qui ne les ont jamais menées à terme. Mais j’ai aussi vu des gens qui ont écrit des œuvres avec un sentiment d’urgence, comme je l’avais fait avec Pourquoi Bologne. Même si ce livre a connu une bonne fortune, je me suis dit qu’il ne fallait pas, pour le prochain, entrer dans un processus d’écriture aussi rapide ni dans quelque chose fait de la même manière, avec la même temporalité.
J’ai envie de vous parler du livre que j’écris depuis huit ans. On est hanté par l’écriture d’un projet qui se déploie dans une temporalité si longue. C’est un long voyage, mais ce qui m’étonne, c’est le caractère circulaire de l’évolution du chantier : l’intention première évolue au fil du temps et revient vers ce qu’elle a été au tout début. Mille secrets, mille dangers va naître d’un processus créatif qui est contraire à la procrastination, même si je sens qu’il m’a pris un temps fou à écrire. C’est une obstination à ne pas mettre les mots au monde tant qu’ils ne sont pas prêts ou qu’ils n’ont pas la puissance que je recherche. Ç’a l’air vaniteux, mais ça fait partie du délire, de fantasmer une puissance des mots. Ce projet a été tout un apprentissage, un vrai roman. Et comme tous les apprentissages, il faut laisser une place importante au temps qui passe, et au temps perdu.
Il y a deux choses sacrées pour moi : le travail d’écriture, de fabrication du livre dont je viens de parler, et l’enseignement. Contrairement à l’écriture d’une œuvre, l’enseignement ne peut être étendu dans le temps. Quand c’est l’heure du cours, il faut le donner, prêt pas prêt ! Sans parler du fait que c’est le travail de professeur qui permet de payer le loyer. La pandémie m’a donné envie de donner un maximum de temps à mes étudiants. L’écriture est un métier d’ignorance, comme disait Jean-Marie Gleize, citant Royet-Journoud. Je me demande si ce n’est pas la même chose avec l’enseignement de la création littéraire, s’il s’agit moins d’une histoire de connaissances que d’une capacité à inventer un lien fort qui permet aux étudiants d’inventer des textes à leur tour. Comment donc enseigner un métier d’ignorance ?
« Le fait d’être artiste s’approche plus de l’état que du métier, selon moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu’il faut, qui ont l’expérience de vie pour être artiste. La souffrance, en partie. J’ai développé cet aspect de création dans ma vie à la fin de mon adolescence. Je ne pense pas que c’est inné pour personne »
Alain Farah
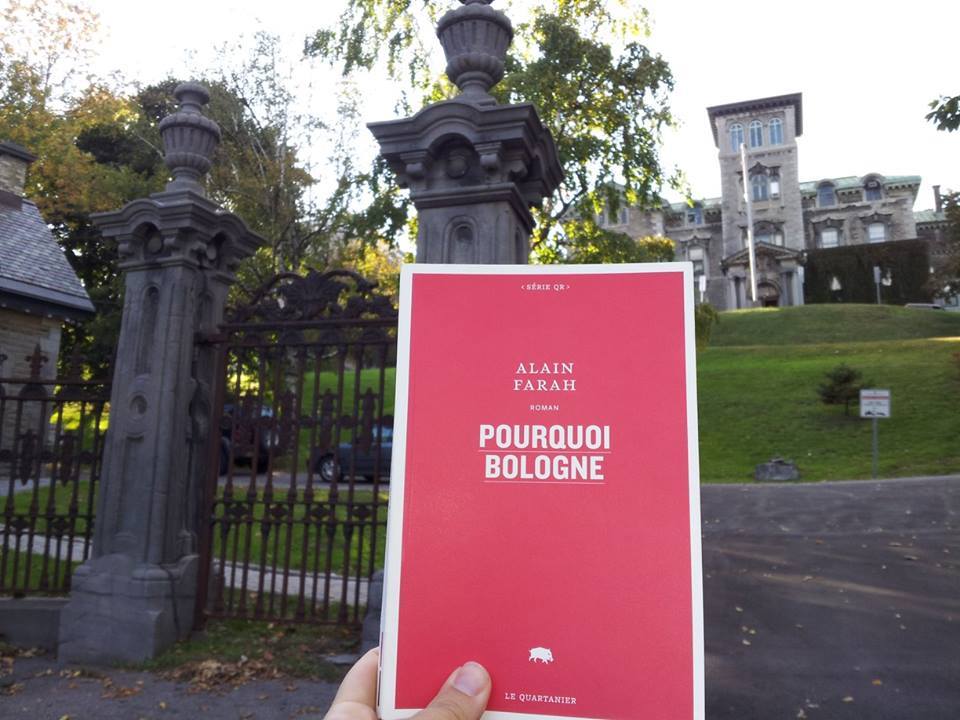
LD : Est-ce qu’il y a d’autres privilèges au métier d’enseignant hormis cette stabilité financière qui permet ce travail plus profond intrinsèque au processus de création de l’œuvre d’art ?
AF : Je crois que le carburant que représentent les échanges avec les étudiants en est très certainement un. La dernière chose que je souhaiterais devenir, c’est un vieillard sourd — non pas en termes d’âge, mais au sens de sourd à ce dialogue constant, cet apprentissage réciproque avec les étudiants. Récemment, mon fils me demande de jouer à Fortnite avec son meilleur ami et lui. Je m’installe et je commence à jouer, mais ça va beaucoup trop vite pour moi. Je dois toujours leur dire : « mais laissez-moi le temps ! » Même chose avec mes classes sur Zoom lorsque j’enseigne à McGill. Quelqu’un demande s’il y a un groupchat et je lui réponds : « il y a l’option “discussion” qui est disponible sur MyCourses ». Je crois que tout ça, même si ça me dépasse quelquefois, me garde en vie et que le privilège est là aussi, dans une sorte d’apprentissage, de dialogue et de mise à niveau constante. Il faut rester curieux, approcher ces changements avec le sourire.
LD : Vous faites la différence entre le geste d’écriture et la fabrication du livre qui se fait aussi en dehors du geste d’écrire, selon vous. L’écrivain sort-il un jour de son métier ou continue-t-il toujours d’écrire de façon sous-jacente ? Faites-vous une distinction, dans la vie de tous les jours, entre votre rôle d’écrivain et votre rôle de professeur ?
AF : On peut penser au cloisonnement de ces deux rôles en termes de consubstantialité, comme de multiples états qui cohabitent, qui partagent leur substance. On peut vouloir une séparation plus nette, radicale, mais ça prendrait un effort énorme, et je trouve que cela dénaturerait l’entreprise du vivant dans l’écriture. Je pense donc que nous n’avons pas le choix de tendre vers un cloisonnement minimal, qui prend forme plutôt dans l’organisation du temps. Après tout, il faut préparer ses cours, donner ses séances sur Zoom, amener son fils au taekwondo, s’occuper du souper.
Le fait d’être artiste s’approche plus de l’état que du métier, selon moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu’il faut, qui ont l’expérience de vie pour être artiste. La souffrance, en partie. J’ai développé cet aspect de création dans ma vie à la fin de mon adolescence. Je ne pense pas que c’est inné pour personne. C’est un apprentissage. Sans vouloir être dans la vulgate de l’artiste au cœur saignant, j’ai l’impression qu’être artiste est une réponse à la souffrance par le travail des formes. Comme Barthes, je crois que le style est biologique.
Je pense que l’écriture sera toujours un geste conscient, un effort de pensée. Mais elle s’ouvre à un espace souterrain, à ce qui se passe sous les courants. C’est un amalgame qui est une sorte de matière vivante. Le livre deviendra en lui-même une matière vivante. Je vois difficilement comment séparer les choses, même si j’en ai déjà eu le fantasme, en me créant un personnage par exemple.
Il y a eu des moments très durs dans le processus d’écriture de mon dernier livre où je me suis dit : je n’y arriverai pas. J’étais très proche de laisser ce projet inachevé, j’ai même songé à prendre ma retraite du monde de la création de façon définitive, comme ces athlètes professionnels dont le corps ne performe plus aussi bien à 40 ans. Je me suis dit qu’une fois retraité, je pourrais simplement enseigner et transmettre ma passion, devenir coach. Heureusement, j’ai persévéré si bien que je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, si je participerai aux prochaines olympiades.
LD : Vous sentez-vous privilégié de votre statut de professeur comparé à d’autres artistes qui vivent peut-être une précarité économique et sociale, ou bien le diktat universitaire amène-t-il aussi son lot de pressions qui entache votre temps et votre santé ?
AF : Il n’y a aucun doute quant à la question du privilège, surtout à l’université. C’est un privilège qu’on acquiert parce qu’on a eu d’autres privilèges, dont celui de pouvoir étudier longtemps ou d’avoir fait les bonnes rencontres.
« La lecture est un rituel. Ça prend des dispositions, une certaine position physique, du temps. Si on n’apprend pas aux gens à le faire ou qu’on leur apprend de la mauvaise manière, ils ne le feront pas »
Alain Farah
LD : Le ludisme surréaliste de Pourquoi Bologne n’empêche pas pour autant d’en faire une lecture psychanalytique. Ces services secrets qui cherchent à contrôler le protagoniste, que symbolisent-ils ? Quelles sont les dynamiques de pouvoir qui pèsent sur l’écrivain ?
AF : Je ne fonctionne pas avec des symboles. Il y a des phénomènes qui apparaissent dans mon livre et ils sont le symptôme du délire, le délire de pensées qui s’incarnent dans des représentations. Dans Pourquoi Bologne, c’est la tension entre le désir de contrôle et ce qui est incontrôlable. Dans le temps, je pensais vraiment qu’il y avait des forces externes oppressives qui s’exerçaient sur moi, comme le sentiment de devoir me conformer à l’image de ce qu’était un professeur à McGill. Ce qui se passait dans la rue en 2012, les manifestations, m’influençait aussi. Après, il y a les guerres qui traversent mon passé et le passé de mon passé.
Aujourd’hui, je réalise que, dans les faits, c’était la trace d’une oppression que je m’imposais à moi-même pour répondre à une demande qui ne venait pas de l’extérieur. Le bon vieil ennemi intérieur, the ghost in the shell. Pourquoi Bologne exprime comment, malgré cette tension vers le conformisme, le moi s’échappe tout le temps. À la fin, on se rend compte que le protagoniste fait un avec son propre bourreau. C’était déjà travaillé dans le texte, mais je ne le réalisais pas encore.
LD : La pandémie a engendré de plus en plus d’engouement pour les formes plus longues ou celles qui demandent plus de temps et de lenteur. Quel est l’avenir de l’écriture telle qu’on la connaît après le retour à la vie normale ?
AF : Pour plusieurs et pour les jeunes adultes surtout, la pandémie aura peut-être été une première expérience de lenteur. La lecture est un rituel. Ça prend des dispositions, une certaine position physique, du temps. Si on n’apprend pas aux gens à le faire ou qu’on leur apprend de la mauvaise manière, ils ne le feront pas. Pourquoi lire un livre réaliste du 19e siècle quand on peut regarder des séries ou être dans un jeu immersif ? C’est une question légitime. Les formes ne sont pas éternelles, mais les formes du passé ont des choses à nous apprendre. Si on laisse la lecture de côté, il y a des choses qu’on n’apprendra jamais, notamment par rapport au temps qui passe, au temps qu’il faut traverser pour apprendre des choses.
Il est trop tôt pour moi de juger du sort de la lecture après cette crise. La pandémie, au moins, aura créé des rencontres. Mais on n’a pas besoin d’attendre une autre pandémie pour profiter du cinéma de Tarkovski ou lire du Spinoza. Il faut créer de l’espace pour ça. Certains auront appris à pratiquer ces formes-là. Je crains que le rythme ne devienne encore plus fou après la pandémie. Mais je ne suis inquiet ni pour l’écriture ni pour l’objet-livre. Ça va simplement prendre les bonnes dispositions pour leur offrir la place qu’ils doivent occuper dans nos vies.
« Certains, comme les professeurs, sont plus privilégiés que d’autres, car leur travail connexe n’est pas absurde et est en lien avec leur pratique de l’art. Mais même dans leur privilège, le travail demeure long et ardu. L’art d’écrire semble donc constamment condamné à la marge et est généralement sans possibilité réelle d’en faire un métier autre que par l’amalgame d’un autre »
Note des éditeurs
Conclusion et note des éditeurs
L’entreprise que nous avons tentée en montant ce cahier d’entrevues avec des auteurs et autrice qui enseignent, tant au cégep qu’à l’université, était de se questionner sur la notion de travail et de création. Le but était de savoir s’il existait ou non une forme de cloisonnement entre les deux pratiques et ce que le besoin de performer dans une discipline connexe venait dire sur le métier d’écrivain. Il s’agissait de disséquer cette double performance que la société actuelle exige de l’artiste. Notre entreprise était de prendre ce que nous considérons comme le meilleur des cas possibles, c’est-à-dire la figure d’écrivain-professeur, et de mettre au jour son processus d’écriture en la questionnant sur la possibilité pour ce processus d’être entaché par le temps investi dans son autre métier. Les professeurs et la professeure que nous avons questionnés nous ont confié qu’ils ne sentaient pas que leur écriture était pervertie, car elle était, en fin de compte, menée à terme quand l’œuvre était prête. Mais sans être dénaturé, le métier de lenteur qu’est l’écriture demande un temps que la société accorde de moins en moins.
Force est d’admettre que ce métier de lenteur n’est plus en phase avec notre type de société de performance et qu’il faut s’efforcer de suivre celle-ci dans le monde physique tout en gardant la lenteur dans un espace hors de la matérialité du monde. Il s’agit, en fait, du dernier acte de résistance métaphysique qu’il nous reste vis-à-vis la rapidité du monde : un acte de lenteur sous forme de hantise artistique sporadique. On pratique l’art de manière épisodique et l’absurdité, de manière constante. Mais cet acte, il faut être en mesure de le faire et de le mettre à terme. Pour cela, certains, comme les professeurs, sont plus privilégiés que d’autres, car leur travail connexe n’est pas absurde et est en lien avec leur pratique de l’art. Mais même dans leur privilège, le travail demeure long et ardu. L’art d’écrire semble donc constamment condamné à la marge et est généralement sans possibilité réelle d’en faire un métier outre que par l’amalgame d’un autre. Tout cela vient mettre le doigt sur le caractère non-essentiel et indigne d’intérêt de l’art et indigne d’intérêt présent dans l’inconscient collectif général et l’inaptitude de notre société à considérer l’écrivain comme un professionnel à part entière. Une prise de conscience collective ainsi qu’une réforme du statut d’écrivain seraient donc à espérer pour faire en sorte que ceux qui n’ont pas le privilège d’avoir un travail comme celui de l’enseignant, qui apporte la stabilité financière, puissent mener leur art à terme.
→ Voir aussi les entrevues avec Geneviève Blais et Hector Ruiz.



