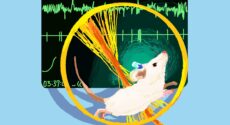« Ainsi il n’y a rien d’inculte, de stérile, de mort dans l’univers, point de chaos, point de confusion qu’en apparence. […] On voit par là que chaque corps vivant a une entéléchie dominante qui est l’âme dans l’animal ; mais les membres de ce corps vivant sont pleins d’autres vivants, plantes, animaux, dont chacun a encore son entéléchie ou son âme dominante »
Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, 1765
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) a écrit de nombreuses œuvres portant sur la métaphysique, la philosophie et les mathématiques au cours de sa vie. Il est considéré, de nos jours, comme l’un des philosophes et mathématiciens les plus influents, du fait de ses intuitions philosophiques modernes et de son apport scientifique majeur : le calcul intégral. Sa théorie métaphysique des « monades », qui tentait d’expliquer l’existence de l’univers, sa structure, sa cause et son but, est l’un des grands ajouts à la philosophie du 17e siècle. Derrière la pensée métaphysique de Leibniz, qu’il tentait de concilier avec le matérialisme, et derrière son idée d’harmonie universelle et de monades en lien avec la volonté des êtres vivants de se conserver, de changer ou encore d’évoluer, se cachaient peut-être les premiers balbutiements d’une éthique animale et d’une vision antispéciste. Il s’agira donc de traiter de l’antispécisme à l’aide des concepts philosophiques de la pensée de Leibniz. Ceux-ci mettront en lumière l’aspect moral intrinsèque du fait de considérer toutes les espèces animales comme étant, ultimement, égales en ce qui concerne leur droit à la vie et à l’évolution.
L’hydre hybride de Leibniz
Pour bien comprendre le concept de « monades » de Leibniz, il faut avant toute chose comprendre pourquoi une telle idée lui est venue à l’esprit. Il invente les monades car il n’est pas satisfait avec le concept matérialiste et mécanique de ses contemporains. Hobbes et Spinoza, entre autres, croyaient en un univers matériel qui se suffit à lui-même et qui n’aurait pas besoin d’un élément métaphysique pour le créer et le guider. Avec le concept de monades, Leibniz tente de concilier le matérialisme et la métaphysique en faisant en sorte que les monades incarnent à la fois l’idée de matière et de substance métaphysique. Elles sont, en quelque sorte, une tentative de réponse au deux grands concepts paradoxaux liés à la création et la structure de l’univers que sont le matérialisme et la métaphysique : la monade est une sorte d’énergie immatérielle, l’inconscient de la matière. Dans ses Nouveaux Essais sur L’entendement Humain, le philosophe donne à lire à propos de la Monade divine, qu’il y a « en Dieu la puissance, qui est la source de tout, puis la connaissance, qui contient le détail des idées, et enfin la volonté, qui fait les changements ou productions selon le principe du meilleur ». Les monades créées par la Monade divine seraient donc des imitations imparfaites de celle-ci, mais possèderaient intrinsèquement ce même triptyque puissance-connaissance-volonté.
Leibniz, insatisfait du matérialisme, n’est donc pas non plus satisfait par les idées d’essences énoncées par les penseurs scolastiques et croit qu’il est nécessaire de réformer ces concepts en les associant à l’idée de matière. Ces « essences » constituaient, en soi, un concept métaphysique flou et paradoxal, se montrant donc inapte à expliquer la matière. Ainsi, Leibniz est en partie d’accord avec Hobbes lorsque celui-ci critique les essences abstraites, même si ce dernier est un matérialiste convaincu. Dans le Leviathan, Hobbes donne à lire une critique acerbe de la métaphysique des « essences » ainsi que de tout ce qui est hors du matérialisme et de la conception mécanique de l’univers. Dieu ne peut pas, selon lui, être à la fois une substance créatrice et faire partie de la création ; il doit être extérieur à la matière créée. Leibniz pense autrement ; il croit que la philosophie de la matière en mouvement n’est pas suffisante pour expliquer les causes de la création de l’univers. Leibniz se questionne sur la problématique suivante : qu’arrive-t-il lorsque la matière n’est plus et que tout mouvement cesse ? Il tente de donner une ébauche de réponse avec son idée de « monades ».
La Monadologie défend le postulat selon lequel la seule vraie substance est non-spatiale et non-matérielle, même si elle est invariablement associée à la matière. Leibniz associe la matière et l’espace à des phénomènes qualitatifs plutôt qu’à de la matière quantitative. C’est là que son concept de monades vient jouer un rôle primordial. La Monade suprême (la plus haute monade dans la pyramide hiérarchique du vivant et, donc, écrite avec une majuscule) et les autres monades (celles qui en dérivent) représentent donc une conciliation entre métaphysique et matérialisme. Elles répondent à la question d’un but à atteindre pour l’être vivant en incarnant une idée de « force » intrinsèque à leur essence. Toujours dans ses Nouveaux essais, Leibniz écrit :
« Ainsi, quoique chaque Monade créée représente tout l’univers, elle représente plus distinctement le corps qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l’entéléchie et comme ce corps exprime tout l’univers par la connexion de toute la matière dans le plein, l’âme représente aussi tout l’univers en représentant ce corps qui lui appartient d’une manière particulière. […] Ainsi chaque corps organique d’un vivant est une espèce de machine divine ou un automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels parce qu’une machine faite par l’art de l’homme n’est pas machine dans chacune de ses parties »
Leibniz croit donc à une nécessité métaphysique, à un dieu qui serait, en partie, à l’intérieur de sa création ; c’est-à-dire une entité dont l’essence même serait d’exister, car une chose qui existe doit forcément provenir d’une autre chose qui existe. Or, ce concept devient raisonnement circulaire et paradoxal si, selon lui, on n’attribue pas la création à une substance métaphysique.
Le philosophe mentionne également l’erreur cartésienne d’un dualisme entre le corps et l’esprit, accordant plutôt la primauté à un parallélisme voulant que, comme le nom l’indique, le corps et l’esprit soient en harmonie parallèle, mais sans connexion outre l’harmonie préétablie par Dieu : « c’est en quoi les cartésiens ont fort manqué, ayant compté pour rien les perceptions dont on ne s’aperçoit pas. C’est aussi ce qui les a fait croire que les seuls esprits étaient des monades, et qu’il n’y avait point d’âmes des bêtes ou d’autres entéléchies, et qu’ils ont confondu avec le vulgaire un long étourdissement avec une mort à la rigueur ». Pour les cartésiens, l’âme est donc séparée du corps tandis que pour Leibniz, il y a un parallélisme insécable entre l’âme et la substance matérielle. Ces concepts sont primordiaux pour comprendre l’harmonie universelle et l’idée de conservation, de changement et d’évolution incarnée par la Monade indestructible.
La justice universelle et spécifique
Le concept d’harmonie universelle dépend des monades, car chacune d’entre elles est porteuse d’une force, d’une volonté qui la fulgurent et la dirigent vers le but ultime de l’existence. Leibniz insiste sur le fait qu’une substance est capable d’actions et peut initier un changement. On peut entendre, par cette idée, que Leibniz croit que la matière, capable d’action et de changement par sa monade dominante, possède la « force » nécessaire, et qu’elle a une volonté intrinsèque, pour accéder à une forme d’évolution. Donc, selon lui, même si Dieu a en effet créé une multitude de matières, cela n’empêche en rien le fait que cette matière possède, elle aussi, une volonté d’action et de changement. Dieu n’est donc pas la seule force dirigeant la matière, mais aurait agi en concert avec la prescience que chaque monade allait évoluer, par degré, toujours dans le but d’atteindre une suprême harmonie selon un principe interne (l’appétition). Cette substance capable d’action est, selon Leibniz, une « force primitive » qu’Aristote appelait des « entéléchies ».
Leibniz, dans ses Nouveaux essais, en arrive alors à décrire son concept d’harmonie universelle en lien direct avec la thèse de l’antispécisme :
« Il faut reconnaître qu’il s’opère dans tout l’univers un certain progrès continuel et très-libre qui en améliore l’état de plus en plus. C’est ainsi qu’une partie de notre globe reçoit aujourd’hui une culture qui s’augmentera de jour en jour. Et bien qu’il soit vrai que quelquefois certaines parties redeviennent sauvages ou se bouleversent et se dépriment, il faut entendre cela comme nous venons d’interpréter l’affliction. […] Il résulte cependant de la division du contenu à l’infini qu’il reste toujours dans l’abîme des choses des parties endormies qui doivent s’éveiller, se développer, s’améliorer et s’élever pour ainsi dire à un degré de culture plus parfait »
Or, si l’on considère les « parties endormies » et les monades d’âmes animales comme étant inférieures à nos propres monades d’êtres humains, et que l’on fait parfois en sorte, en tant que monades dominantes sur terre, de nuire à la capacité évolutive des autres monades (par exemple, par les nombreuses extinctions animales causées par la présence de l’homme), on est en droit de se demander si le concept « d’harmonie universelle » de Leibniz, du moins à l’échelle de la terre, est encore d’actualité. Car, si l’homme abuse de sa « force » pour arriver à une domination presque complète sur toutes les autres formes de monades dans son environnement immédiat, il se retrouvera dans un environnement peu diversifié où les monades des autres formes de vies, subjuguées par l’homme, se verront effacées dans leur droit à leur propre extension et, donc, à leur propre quête de but et de plénitude.
On serait également en droit de se questionner sur l’aspect moral de la chose : étant donné le degré de rationalité supérieur de l’homme et sa prise de conscience de l’axiome de justice préalablement établi, l’homme se doit de faire tout en son possible pour éviter un tel déclin, et ce, concernant tout organisme possédant une sorte de « sur-moi » ou de volonté de puissance évolutive. L’homme se retrouverait dans l’obligation morale, par exemple, de ne plus faire l’élevage systématique d’animaux dans le seul but de les consommer, ainsi mettant un frein à leur évolution naturelle. C’est en effet l’intervention humaine qui plonge ces formes de vie dans une situation artificielle sans aucun espoir de changement ou de progrès, car l’homme, désirant une « version » spécifique de l’animal, fera tout en son pouvoir pour le conserver dans cet état génétique afin d’assouvir ses propres désirs d’évolution humaine.
Une objection serait de dire que, dans la nature, certains prédateurs consomment également d’autres animaux à une échelle plus ou moins grande et, ainsi, empêchent aussi ces formes de monades d’évoluer de par leur propre égoïsme évolutif. Or, du point de vue du monde animal, il semble tout de même y avoir une certaine balance (ou une moindre démesure) naturelle qui s’assure que ces pratiques prédatrices ne virent pas en excès. De plus, les prédateurs qui font usage de ces pratiques, contrairement à l’homme, n’ont pas un degré de conscience suffisamment élevé pour faire autrement. Georges Friedmann, dans son ouvrage Leibniz et Spinoza, argumente :
« La Nature est un Tout, dont chaque élément participe de la même substance. Les monades tiennent de Dieu seul leur réalité. C’est lui qui les fait passer à l’existence selon le mécanisme métaphysique. C’est lui qui les fulgure à partir de sa propre substance. […] Partout où il y a monade, il y a, en dernière analyse, pensée plus ou moins confuse, esprit plus ou moins enveloppé ou développé. Partout où il y a monade, il y a Dieu »
Le Milan noir, un oiseau qui prend des branches enflammées dans son bec lors de feux de forêt et qui les dépose ailleurs pour propager le feu afin de mieux pouvoir chasser les animaux qui sortent de leurs tanières, est un de ces animaux qui représente le mieux le concept d’harmonie universelle, car même si cette technique paraît, a priori, démesurément nuisible, il en ressort finalement une sorte de nivelage dans la nature. Car, les feux de forêt sont très importants à l’enrichissement des sols et au renouvellement de la faune et de la flore.
Cependant, en ce qui concerne l’homme, il n’est pas seulement question de démesure dans la consommation d’organismes possédant un désir d’évoluer, mais également en ce qui concerne toutes les autres façons de nuire à leur évolution jusqu’à leur possible anéantissement (par exemple, le braconnage, le réchauffement climatique, l’altération des écosystèmes, etc.). Sur cette problématique, Leibniz répond que les « monstruosités » (voulant dire, les inégalités apparentes du monde) et les souffrances font partie de l’ordre universel et qu’il est mieux d’admettre ces monstruosités comme faisant partie de l’univers plutôt que de nier ses lois générales. Cet argument, malgré sa froideur et son manque flagrant d’empathie, est un bon argument en ce qui concerne la généralité de l’univers, mais, encore une fois, fait abstraction totale de considérations éthiques. Certes, les souffrances et monstruosités de la vie font partie d’un certain ordre des choses, et l’homme doit les admettre comme faisant partie intégrante de l’univers, mais il se doit également d’agir en leur défaveur lorsqu’il le peut, c’est-à-dire qu’il a la responsabilité morale d’empêcher, tant que faire se peut, la souffrance et les actes monstrueux envers les formes de vies similaires à la sienne. L’homme ne peut se contenter de rester dans l’immobilisme face à ce genre d’injustices car, poussé par une morale certes discordante avec le but général que tente d’atteindre l’univers, il doit être sensibilisé à protéger le potentiel évolutif de chaque être vivant dans un esprit de justice et de balance. En somme, si l’homme a atteint un degré de conscience monadique plus élevé et qu’il prend conscience de cela, il serait injuste de sa part de freiner ou d’empêcher qu’une conscience d’un degré inférieur à la sienne puisse accéder à ce meilleur état de conscience.
Sur l’antispécisme
L’antispécisme consiste donc en un rejet des théories selon lesquelles une espèce animale serait inégale en termes de droit à la vie. Souvent, l’erreur des spécistes consiste en une hiérarchisation des formes de vies en une échelle d’infériorité et de supériorité de raisonnement. Selon eux, cela rendrait légitime leur façon de traiter les autres formes de vies comme étant inférieures. Dans une optique similaire, Leibniz met de l’avant, dans ses Nouveaux essais, que « la connaissance des vérités nécessaires et éternelles est ce qui nous distingue des simples animaux et nous fait avoir la raison et les sciences, en nous élevant à la connaissance de nous-mêmes et de Dieu ; et c’est ce qu’on appelle en nous âme raisonnable ou esprit ». Leibniz différencie la monade d’âme et la monade d’esprit. Il accorde donc un statut différent aux hommes qu’aux autre animaux sous le prétexte erroné que les autres animaux n’ont pas, selon lui, accès à la raison et aux sciences.
Or, certains animaux et organismes possèdent une raison supérieure à d’autres et ont même développé des sciences primitives et des raisonnements inconscients outrepassant le domaine de l’empirisme, de la simple habitude ou du hasard. Le dauphin, par exemple, a certainement dû faire preuve de raisonnement lorsqu’il a eu l’idée, au cours de son évolution, de se frotter le ventre contre le fond marin en soulevant le sable et autres agrégats minéraux pour ainsi former une colonne courbée de débris et attirer les poissons dans l’angle de la courbe pour plus aisément les manger. Même si ces comportements ne représentent pas le même degré de raisonnement scientifique que celui qu’emploient les humains dans les mathématiques ou la physique, par exemple, on peut y observer les premiers balbutiements d’un raisonnement qui tend vers le nôtre. En ce sens, les monades d’âmes animales ne devraient pas être distinguées si radicalement des monades d’esprits que possèdent les humains. Toute monade, dans la nature, semble faire preuve d’un raisonnement plus ou moins conscient afin de se conserver ou d’évoluer vers un « meilleur » qui n’est vraiment pas si lointain du nôtre.
Leibniz se contredit donc quelque peu lui-même. Si d’un côté, il affirme que chaque monade possède un libre arbitre à l’intérieur d’une harmonie préétablie (c’est-à-dire une capacité de changement par une action préalablement raisonnée), de l’autre côté, il postule que les monades d’âmes animales ne sont pas capables de raisonner ou, du moins, pas suffisamment, et n’ont pas la même conscience d’eux-mêmes que les monades d’esprits humaines. Leibniz rejoint donc Hobbes sur ce sujet dans une sorte d’autocontradiction étrange. Dans le Leviathan, Hobbes explique que les abeilles et les fourmis, malgré une forte cohésion sociale, ne sont pas dotées de raisonnement et que leurs instincts ne sont qu’hasardeux, qu’il n’y aurait aucune « volonté » derrière leurs actions. Affirmer que les fourmis et les abeilles ne possèdent aucune force directrice autre que leurs jugements et désirs et aucun sens de raisonnement est un peu hâtif. Lors de l’inondation de leur fourmilière, en effet, certaines fourmis se sacrifient pendant l’évacuation en formant, avec leur corps, une sorte de radeau de fortune. Ce radeau, transportant le reste de la colonie, est vite formé des cadavres des fourmis sacrifiées. Ce comportement est bien trop complexe pour être le fruit d’une simple évolution hasardeuse et, même si elle l’était, sa cause devrait partir d’un raisonnement, d’une volonté d’évoluer plus ou moins forte, même si celle-ci est inconsciente. Il existerait ainsi une sorte d’inconscient génétique, une volonté intrinsèque à l’existence même des monades, qui alimenterait le processus d’évolution. De plus, l’idée de Hobbes vient nier la possibilité que chaque être vivant puisse avoir la possibilité, par le processus normal d’évolution, d’obtenir la capacité de raisonnement dont Hobbes semble dissocier, a priori, des créatures moins complexes que l’homme.
Ce rapprochement entre la pensée de Leibniz et Hobbes est étrange et déstabilisant : à quoi sert-il, pour Leibniz, de faire une échelle par degrés de différents niveaux de conscience, ou de « non-étourdissement » (Leibniz considérait que la monade dominante d’une roche était « endormie » ou « étourdie »), s’il en vient à nier complètement un raisonnement par degrés derrière la monade d’âme ? Car, chaque monade possède intrinsèquement une essence réflective formant au fil du temps un agrégat de matière qui peut, lui aussi, développer une capacité de réflexion plus ou moins grande. Encore une fois, il s’agit là d’une question de degré. Comme le met en lumière Georges Friedman dans Leibniz et Spinoza en citant Ivan Jagodinsky : « Les existences, qu’elles soient nécessaires ou contingentes, ont cela de commun qu’elles possèdent plus de raison que les autres qu’on serait tenté de leur substituer. Si une existence parvient à exister, c’est qu’elle a plus de raisons d’exister que de ne pas exister : d’où le principe “Chaque chose a sa raison d’être”, qui découle de l’Harmonie universelle ». On observe donc, dans ce passage, la pensée selon laquelle il s’agirait peut-être d’une erreur que de croire en une hiérarchie de degré de raisonnement si distant entre chaque échelon de monades.
Probablement que Leibniz, s’il avait eu accès aux visions darwinistes modernes, n’aurait pas considéré les animaux comme étant si différents au point de vue de la temporalité évolutive et aurait compris que l’Homo Sapiens partage un ancêtre avec les autres primates. Pourtant, il affirme tout de même dans la Théodicée que les animaux, ne réfléchissant pas comme nous, ne peuvent ressentir ni la joie qui accompagne le plaisir ni le deuil qui accompagne la souffrance. Or, le comportement des éléphants entre en contradiction avec cette affirmation. On peut souvent observer les éléphants en rituel de deuil lorsque l’un de leurs semblables meurt ; ils montent doucement et systématiquement sur le corps inerte de l’animal décédé, touchent ses défenses en signe de respect ou encore, de manière plus impressionnante, peuvent même revenir à l’endroit où l’un de leurs semblables est mort, il y a plusieurs années, et y rester longuement comme pour se recueillir, tel un homme devant une tombe. Donc, si Leibniz associe la réflexion au deuil, on en conclut que l’éléphant, d’une certaine manière, raisonne. Dans ses Nouveaux essais sur l’entendement humain, Leibniz décrit ce qu’il appelle l’état « d’étourdissement ». Il s’agit pour lui du degré de forme vivante le moins conscient et le moins raisonné qui soit :
« Je consens que le nom général de monades et d’entéléchies suffise aux substances simples qui n’auront que cela, et qu’on appelle âmes seulement celles dont la perception est plus distincte et accompagnée de mémoire. […] L’on voit par là que si nous n’avions rien de distingué, et pour ainsi dire de relevé et d’un plus haut goût dans nos perceptions, nous serions toujours dans l’étourdissement. C’est l’état des monades toutes nues »
On constate que l’âme animale n’est pas dans un état d’étourdissement et a la possibilité d’évoluer pour devenir un être aux monades supérieures, tout comme l’homme. Certains animaux se rapprochent déjà d’un niveau de conscience que l’on ne peut plus ignorer. Il ne s’agit donc plus aujourd’hui d’essayer de hiérarchiser moralement les animaux par rapport à l’homme et par rapport à une échelle de raisonnement ou de conscience. Il ne s’agit pas de hiérarchiser l’importance de la vie d’un primate en voie d’extinction par rapport à l’importance de la vie d’une personne atteinte de trisomie, celle d’un chien sauveteur par rapport à un général ayant commis des crimes de guerre ou toute autre démonstration insipides que l’on retrouve dans certains « problèmes du tramway ». Il s’agit plutôt d’accorder une importance égale à toute forme de vie ayant une capacité évolutive et de ne pas nuire à cette capacité évolutive, tant que faire se peut, et ce, sans causer de souffrances inutiles.
Il ne s’agit pas non plus de comparer les plantes aux animaux et de conclure qu’étant donné qu’ils ont la même capacité monadique évolutive, on ne peut pas non plus manger de plantes. Plutôt, il s’agit de comprendre l’intention évolutive des monades de plantes et d’en conclure qu’une grande partie d’entre elles (contrairement aux animaux) ont évolué presque dans l’unique but d’être consommées par les autres vivants. En un mot, et grossièrement dit, c’est un peu leur façon de se reproduire. Une sorte de sélection naturelle inversée (passive) s’opère où l’espèce de plantes qui survit et s’adapte le mieux est celle qui se fait consommer davantage par les autres vivants. Presque tous les fruits, légumes, graines et légumineuses que nous, et d’autres animaux, consommons proviennent de ce genre d’arbres et de plantes. Et même si certaines espèces de plantes « se défendent » par le biais de toxines, pics et autres moyens de défense, elles semblent tout de même tendre vers ce processus de reproduction collaboratif et passif. Les animaux (mais aussi certaines plantes carnivores) sont davantage dans une intention évolutive de dominance et une sélection naturelle alimentaire « active ». L’humain est rendu hors de cette intention évolutive de dominance alimentaire. C’est, en partie, justement ce qui le rend plus humain : sa capacité de choisir entre les fruits des plantes (collaborant avec l’idée de sélection naturelle passive) et la chair des animaux (régressant dans un concept de dominance active). L’humain est, en général et tant que faire se peut, capable de faire ce choix éthique, et ce, davantage pour des raisons d’ordre logique que de hiérarchisation de consciences.
Le végétarisme ou le véganisme se montrent donc comme des alternatives qui cadrent bien avec l’éthique animale et le respect de la volonté monadique. L’homme occidental moyen est, depuis longtemps, hors de la chaine alimentaire de la nécessité, en ce sens qu’il est en mesure d’avoir des réflexions éthiques sur ce qu’il mange et n’est plus tellement contraint par des enjeux sociaux-économiques de subsistance. Cependant, l’on constate que même des changements alimentaires personnels et des réflexions collectives ne semblent pas être en mesure de changer les mentalités générales concernant la hiérarchisation du vivant. L’on peut peut-être encore se consoler avec l’idée de Monade indestructible de Leibniz, qui affirme dans ses Essais philosophiques que la machine naturelle ne peut jamais être absolument détruite ni ne peut avoir de réel commencement. Elle ne fait que décroître et croître, mais préserve toujours sa substance. Peu importe comment elle se transforme, la Nature préservera donc toujours un certain degré de vie.