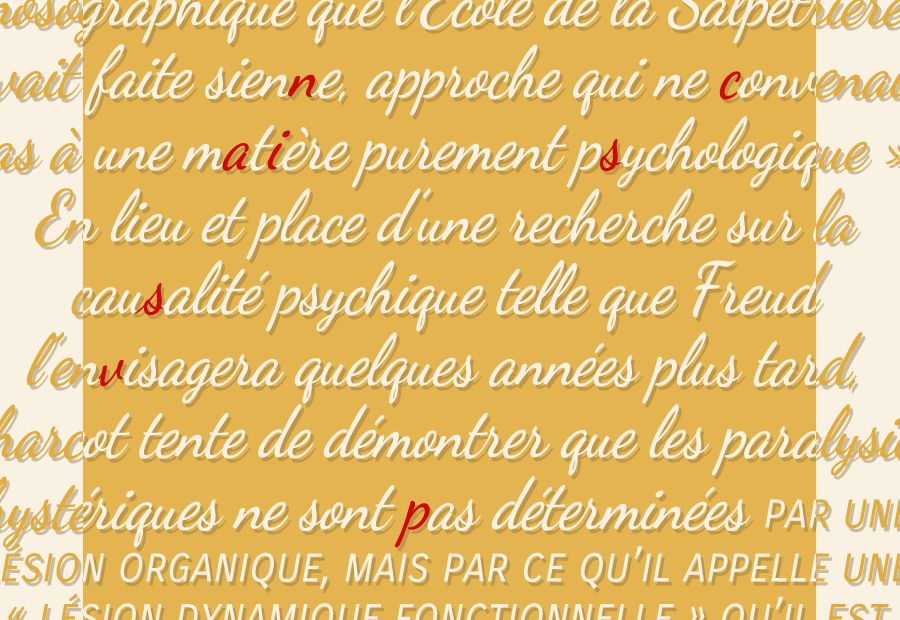Le Québec peut se vanter d’être la seule province officiellement et véritablement francophone du Canada — muni de maintes lois et chartes visant à protéger l’intégrité de sa langue officielle. Le français est mis de l’avant comme un pilier de sa culture fondatrice, de ses institutions et de ses services : comment se porte-t-il réellement ? En vérité, tous ces efforts législatifs semblent se buter à un inexorable déclin de l’utilisation du français comme langue principale au travail et dans les milieux académiques, tous groupes d’âges confondus. Cette détérioration de la langue nationale est sans doute attribuable à une pléthore de facteurs complexes que la présente enquête ne prétend pas identifier, préférant se concentrer sur des enjeux plus pertinents au quotidien des étudiants francophones mcgillois. L’Université McGill, microcosme anglophone au statut protégé, est tenue d’assurer la protection des droits de ses étudiants francophones de naissance, composant le cinquième de sa population inscrite, toutes facultés confondues. Elle redouble d’initiatives et de campagnes publicitaires, faisant la promotion d’activités valorisant la francophonie ou bien l’usage du français sur le campus — efforts louables dont Le Délit est un des principaux bénéficiaires.
Cette enquête passe outre les engagements parascolaires de l’Université et se penche davantage sur l’expérience académique concrète de ceux qui font le choix de remettre leurs travaux universitaires en français. Cette option, un droit acquis et protégé par la Charte de l’Université, est-elle réellement garantie ? Les professeurs (et autres professionnels du milieu académique) engagés par McGill sont-ils réellement capables de fournir une correction paritaire, peu importe la langue utilisée par l’étudiant ? La Faculté des arts — ses quelque 8 000 étudiants en faisant la plus fréquentée — est le point focal de cette enquête, choisie pour la diversité des disciplines qui y sont enseignées et pour l’importance de la rédaction dans la remise de travaux académiques. Le statut d’université de prestige qu’arbore fièrement l’Université McGill la rend particulièrement attrayante pour les étudiants internationaux, alors que plus de 150 pays sont représentés au sein de sa population étudiante. Cette diversité s’étend à son corps professoral, qui attire des académiciens des quatre coins du monde, permettant une richesse d’expertise inégalable bonifiant certainement l’enseignement offert. Malgré son statut bien défini d’institution unilingue, le recrutement de professionnels hors Québec expose la Faculté des arts à un dilemme quant à sa promesse de parité linguistique de correction.
Le corps professoral se prononce
Considérant la responsabilité de McGill quant à l’embauche d’employés capables d’assurer la correction (ou du moins une supervision de la correction) de travaux en français aussi qualitative qu’en anglais, quelles sont les attentes de l’institution quant au niveau linguistique initial de ses professeurs ? Alain Farah, professeur agrégé du Département de littérature française, affirme que « le processus d’embauche n’exige pas du candidat de maîtriser le français — ni l’anglais ! » Lui-même professeur de certains des rares cours pouvant exiger la soumission d’un travail dans une langue spécifique, il déclare ne pas se considérer suffisamment compétent en anglais pour corriger des travaux en cette langue à un niveau universitaire. C’est une chose de comprendre une langue et d’en avoir des compétences conversationnelles, mais c’en est clairement une autre d’analyser la pertinence d’un raisonnement complexe dans un domaine souvent très précis. Il révèle que, dans bien des cas, les professeurs sont unilingues anglophones, évidemment incapables de réaliser une quelconque correction autonome d’un travail en français. Sachant cela, quelles sont les ressources mises à la disposition de ces sommités par l’Université pour assurer un respect des mesures sur la protection des droits des francophones du Québec et d’ailleurs ? Professeur Farah dit ne pas être au courant d’un tel système, et il n’est pas le seul.
« La question est de savoir si les travaux en français seront corrigés avec la même compétence et considération que leur contrepartie anglophone »
Dr Judith Szapor, professeure agrégée du Département d’histoire, abonde en ce sens. Citant les exigences du contenu de chaque programme de cours de la Faculté des arts, elle insiste sur le fait que la remise de travaux en français est un droit accordé aux étudiants par l’intermède d’une politique interne obligatoire. Cette déclaration, vous la trouverez formellement dans tout document de ce type transmis aux étudiants par les professeurs — qu’en est-il de son application ? Bien qu’elle soit elle-même francophone de naissance, elle affirme ne « plus pouvoir corriger de travaux en français au même niveau qu’en anglais », faisant par exemple ses commentaires de correction en anglais sur les copies francophones. Elle nie cependant un quelconque laxisme quant à la correction, affirmant s’armer « d’un dictionnaire et d’outils grammaticaux lorsqu’elle ne comprend pas certaines tournures de phrase » — travail exemplaire dont elle est très fière. Cette fierté professionnelle et académique, me dit-elle, devrait être le standard du corps professoral, mais elle comprend que sa maîtrise du français n’est pas partagée par l’ensemble de ses collègues. De surcroît, elle n’a pas connaissance d’un centre d’aide à la correction pour les professeurs ou les auxiliaires d’enseignement unilingues et cite une problématique supplémentaire encore plus criante. En effet, dans des cours de niveau 300, 400 et 500, le sujet se raffine, la méthodologie individuelle d’enseignement se précise et les perspectives peuvent changer radicalement selon le chargé de cours. Comment alors déléguer la correction et assurer non pas uniquement une bonne compréhension du français, mais simplement une bonne compréhension du sujet ?
Une conformité imparfaite
La question de la parité refait surface dans la barrière que peut causer la langue dans l’accès direct au professeur expert. Si les étudiants savent pertinemment que le professeur ne maîtrise pas le français, vont-ils réellement prendre le risque de soumettre leurs travaux en cette langue ? Leurs droits sont-ils bafoués non pas par une mauvaise correction, mais plutôt par la seule crainte d’un manque de parité ? Selon la Charte de McGill, le droit pour les étudiants d’être unilingues francophones serait protégé par leur droit de remise en français — aucune mention n’est faite des mécanismes pouvant assurer le respect de ce droit fondamental. Il en va de même pour la Charte de la langue française du Québec, qui prévoit aux articles 45–47 des mesures qui empêchent la mise en danger du français dans les processus d’embauche, sans pour autant garantir les droits des francophones. C’est cette nuance qui crée une zone grise, garantissant par exemple qu’on ne peut pas engager quelqu’un sur la seule base de la maîtrise de l’anglais, mais n’exigeant pas qu’elle sache s’exprimer en français — surtout dans une institution anglophone comme McGill.
Dans ces conversations avec les professeurs de différents départements, difficile d’ignorer la tendance du « don’t ask, don’t tell [ne pose pas des questions, ne dit rien, ndlr] » — alors que Dr Szapor avoue ne pas vraiment savoir comment ses collègues unilingues accomplissent une correction paritaire des travaux reçus. Professeur Farah est encore plus sceptique, sans pour autant mettre en question l’intégrité du corps professoral, alors qu’il affirme ne pas connaître à McGill une quelconque instance assurant une correction paritaire. Personne ne semble savoir ni vouloir s’informer sur les pratiques de ses collègues. Après tout, la correction et le contrôle de la qualité de celle-ci relèvent uniquement du professeur titulaire du cours, m’explique Dr Szapor : le silence règne dans les couloirs de la Faculté. La correction paritaire du français n’est pas un sujet de discussion entre collègues. On ne veut pas froisser ou offusquer, en questionnant la compétence d’un professeur, d’un ami.
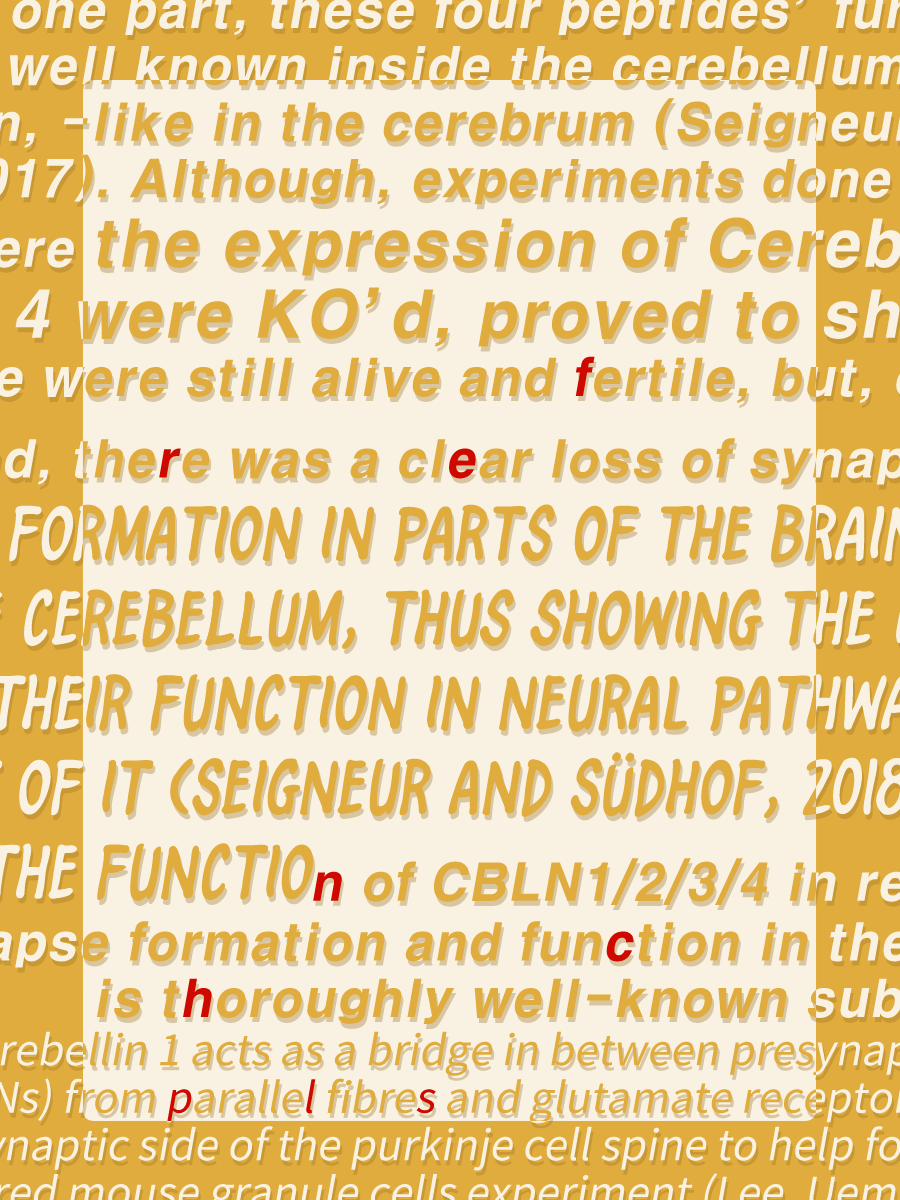
L’expérience francophone étudiante à McGill
Outre les témoignages des professeurs, une recherche de la base de services confirme l’absence d’une quelconque instance rendue directement accessible par les chargés de cours des différentes facultés. On relève l’existence des Services linguistiques de McGill — œuvrant dans la correction et la révision de textes en français —, mais une lecture approfondie montre que ce service s’adresse principalement à l’administration pour ses mémos institutionnels et autres documents officiels. Encore une fois, rien n’est rendu disponible aux étudiants ou aux professeurs pour assurer une correction réellement paritaire lorsque le français est utilisé. Malgré l’absence d’un quelconque système d’encadrement de la correction ou d’une vérification de la compétence linguistique des professeurs, certains étudiants persistent à remettre leurs travaux en français.
Éloïse, étudiante de troisième année en sciences politiques, est de ces irréductibles : Le Délit a donc voulu chercher à connaître son expérience quant à la correction de ses travaux. Il n’est pas question pour elle de juger de la capacité des professeurs à comprendre et à corriger en français : elle n’a aucune attente envers ceux-ci, étant donné leur présence dans une institution anglophone. Elle reconnaît également la variabilité indue causée par les différents professeurs, leurs différents barèmes de correction et les autres modalités de leurs cours. Essentiellement, il semble très difficile selon elle d’évaluer proprement le niveau de français du professeur ou de ses auxiliaires. Éloïse défend l’opinion selon laquelle cette correction en français est un droit qui ne lui est jamais refusé ; elle se questionne cependant sur les méthodes utilisées pour assurer le respect de ce droit. Elle ajoute : « je ne serais pas du tout étonnée si les professeurs ou leurs TAs [auxiliaires d’enseignement, ndlr] utilisent Google Translate (ou une autre plateforme similaire) pour faciliter la correction » — relevant une fois de plus la subtilité de l’enjeu dont cette enquête fait état. La question n’est pas de savoir si les travaux en français seront corrigés, mais bien s’ils seront corrigés avec la même compétence et considération que leur contrepartie anglophone. La correction est faite, la note est acceptée par l’étudiant et le cours est complété : justice est-elle donc rendue ? Éloïse affirme n’avoir jamais eu de réel problème avec la correction de ses travaux ; pourtant, l’utilisation potentielle d’un logiciel de traduction n’est-elle pas un signe d’iniquité ? Cette affirmation fait écho au message des professeurs Szapor et Farah, comme quoi aucune réelle ressource professionnelle n’est mise à la disposition des membres unilingues anglophones du corps professoral.
Comment prétendre à la parité de la correction si une pluralité de professeurs ne peut corriger ou superviser des travaux en français au niveau universitaire et que l’Université ne possède aucune exigence de maîtrise du français à l’embauche ? Il semble donc que, malgré une multitude de politiques mises en place pour assurer le respect des droits des étudiants francophones, ceux-ci sont bien souvent soumis à des conditions de correction inégalitaires. Cela dit, le témoignage d’Éloïse ne se veut pas accusateur ni n’a‑t-il pour objectif de se plaindre : sa perception d’étudiante ne décèle pas l’inégalité recensée par les professeurs interrogés. Pas surprenant, selon Dr Szapor, étant donné l’opacité omniprésente au sein du corps professoral quant aux méthodes utilisées pour la correction : il serait difficile de percevoir une inégalité si l’on n’a même pas conscience du système qui la sous-tend.
« Je ne serais pas du tout étonnée si les professeurs ou leurs auxiliaires d’enseignement utilisent Google Translate pour faciliter la correction »
— Éloïse, étudiante de troisième année
Comment responsabiliser l’institution
Que doit retenir la communauté francophone de cette enquête sur la réelle parité des services linguistiques rendus par McGill ? Selon Professeur Farah, il faut chercher à plonger plus profondément dans le système et à exiger davantage de comptes des professeurs et de leurs assistants. Le réel problème en soi n’est pas l’intégrité ou le professionnalisme ; il s’agit simplement d’inciter l’Université à fournir toutes les ressources nécessaires pour faire appliquer les politiques qu’elle rend obligatoires. Comme l’affirme le Dr Szapor, si l’Université et sa Faculté des arts obligent les professeurs à inclure ce droit fondamental dans leur programme de cours, elle doit contribuer à son application. Elle croit fermement que c’est la richesse linguistique — pas seulement du bilinguisme mcgillois — qui donne toute sa valeur à l’Université : il s’agit simplement de laisser tous les étudiants s’exprimer et être considérés équitablement.
Il existe tout de même différentes manières de faire valoir les droits des francophones à McGill. Les étudiants peuvent bien sûr, comme conseillé par Professeur Farah, assurer un suivi plus poussé de leurs travaux remis en français, surtout lorsqu’on « ne sait pas exactement qui corrige la copie », comme le souligne Éloïse. Si cette première mesure s’avère insatisfaisante, l’étudiant peut se tourner vers la Commission des affaires francophones (CAF) et plaider sa cause envers cet organe visant à faire valoir les enjeux de la francophonie sur le campus mcgillois. Bien que la population francophone soit minoritaire, la CAF s’assure qu’elle ne soit pas invisible et que ses intérêts soient défendus — incluant bien entendu la promesse de parité linguistique présente à l’article 19 de la Charte constitutive de McGill.
Cette enquête expose la principale faille des promesses faites par McGill à sa population étudiante francophone, mais montre également le bon vouloir de l’Université à assurer la survie du français en ses murs. Il s’agira simplement de rendre plus accessibles des ressources pour assister les professeurs dans leurs corrections et, surtout, d’imposer davantage de transparence quant aux processus individuels de correction. Le français, comme le dit Éloïse, est un droit. Pas une option, pas un privilège, mais bien un droit pour quiconque est inscrit au sein de cette Université — ceux qui l’utilisent ne devraient pas voir leurs résultats être déterminés arbitrairement ou différemment des autres. Comment protéger ce droit sans pour autant heurter l’immense richesse d’expertise contenue dans la Faculté ? À vous de jouer, McGill…