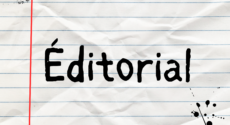En cette belle province d’irréductibles francophones, on se laisse aisément gagner par le sentiment que la langue française est menacée par ceux qui ne la parlent pas. À observer les dernières « perles » des élus français, force nous est de constater que la langue de Molière se porte le moins bien entre les mains de ceux qu’elle a bercés depuis leur tendre enfance.
En vérité, qu’elle soit française ou autre, la langue subit un massacre progressif, que nombreux ont attribué aux effets des nouvelles communications. Cela rend d’autant plus suprenant le manque de soin que nous sommes de plus en plus enclins à souligner chez les élus. On a certes depuis longtemps dépassé l’époque où la maîtrise impeccable de la langue devait s’accompagner de l’art de la rhétorique chez ceux qui aspiraient à un statut quelconque d’orateur public. Ces temps sont révolus et reviendront peut-être. En attendant, les politiciens d’ici et d’ailleurs nous transportent au gré de leur grammaire bancale et de leur syntaxe appauvrie. Et ceux qui ont vibré à la lecture des discours politiques des temps jadis n’ont guère que leurs points-virgule pour pleurer.
Le décorticage grammatical du discours politique semble ainsi devenir une pratique courante dans les médias, dont on sait la rapacité. Dans cet esprit, le New York Times consacrait, le mois dernier, un article d’opinion à l’analyse des bourdes d’un Obama assez fraîchement élu. Les auteurs se livraient à un argumentaire détaillé fustigeant la manie du président d’utiliser le pronom « I » au lieu de « me ». Baptisant le sacrilège pronounitis, le Times rappelait les inexactitudes du même calibre proférées par les occupants de la Maison Blanche, qui présentent vraisemblablement, pour la plupart, des symptômes de cette pathologie.
Pour en revenir au très saint français, le quotidien Le Parisien −celui qu’il vaut mieux avoir en journal− profitait de la Semaine de la langue française pour se délecter des barbarismes et « bulldozages » grammaticaux auxquels un Sarkozy, que nous savons loquace, s’adonne assidûment. Le Parisien s’est donc penché sur le cas Sarkozy en nous livrant une énumération savoureuse des catastrophes verbales du président dont les expressions vont à vau‑l’eau, d’un innosent « ch’ais pas » à « On se demande c’est à quoi ça leur a servi ? », en passant par l’incontournable « casse-toi pauv’ con ! »
En effet, c’est à se demander si ce bon roi n’aurait pas mieux fait de suivre le modèle de ses prédecesseurs en prenant la voie dite royale de l’École Nationale d’Administration, une de ces machines à fabriquer du technocrate syntaxiquement correct telle que l’Hexagone seul sait en produire.
Évidemment, le problème n’est pas là, et les Chirac et les Mitterand outre atlantique ont aussi commis leurs bourdes. Et après que la candidate à la présidence Ségolène Royal nous eût démontré sa « bravitude », le doute a cessé de planer sur l’extinction du politicien-orateur en France. Aux dernières nouvelles, les élus québécois actuels ne sont pas non plus des galvaniseurs de foules.
On dit que pour être politicien, aujourd’hui il faut faire « peuple », parler comme l’homme de la rue. Mais à date, aucune corrélation n’a semble-t-il été établie entre l’érosion de la langue et les suffrages avantageux. Alors un peu de tenue.